L’énergie de l’État, une conversation avec Jean-François Bayart
« L'État, c'est effectivement de l'énergie : un événement et non une essence. » Avec Olivier Vallée, Jean-François Bayart et revenu sur sa somme parue chez La Découverte cette année, L'énergie de l'État.
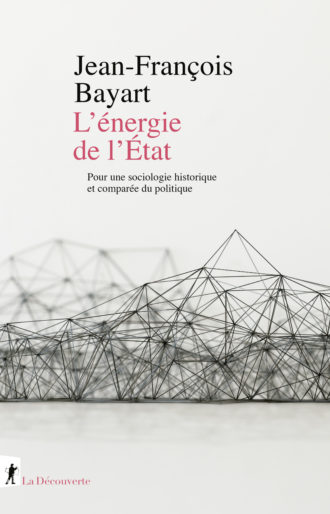
Votre dernier livre L’énergie de l’État, pour une sociologie historique et comparée du politique, reprend bon nombre des thèmes évoqués dans vos précédents ouvrages. J’aimerais savoir qu’est-ce que l’énergie pour parler de l’État ?
Je reprends l’expression et le concept de Bergson, un auteur qui m’a beaucoup aidé à problématiser l’historicité de l’État en évitant les pièges de l’évolutionnisme et de la périodisation. Cette dernière découpe l’histoire en tranches et a l’inconvénient de nous rabattre vers une conception très occidentalo-centrée ou religioso-centrée de l’histoire : « avant Jésus Christ » ou « après Jésus Christ », « après l’Hégire », etc…
Le concept d’énergie de l’État nous renvoie, d’une part, vers la problématique foucaldienne de la subjectivation et, d’autre part, vers une conception du politique en termes de production, donc une conception post-hégélienne et surtout peut-être plus marxienne que hégélienne. D’un côté, la subjectivation politique : Foucault mais aussi Deleuze, avec ses plans d’immanence. Et de l’autre la production de l’Etat en pensant celui-ci comme un “événement” et non pas comme une “essence”, de la même manière qu’il faut penser l’événement de l’identification politique religieuse etc… plutôt que la prétendue “essence” de l’identité.
Ce terme d’énergie de l’État est congruent avec mes penchants conceptuels déjà assez anciens. Je lis très largement Bergson à travers les lunettes de Foucault et de Deleuze, ce que certains philosophes contesteront d’ailleurs. J’ai relu systématiquement l’œuvre de Bergson avant d’entrer dans l’écriture de ce livre car, au fond, cela faisait quelques années que je parlais d’imbrication des durées, en particulier pour appréhender l’État en Afrique. Bien sûr cette « imbrication » est la « compénétration des durées » dont parle Bergson. En y consacrant des pages remarquables, je crois que Bergson nous aide aussi à comprendre ce qu’il nomme le souvenir du présent ou la fausse reconnaissance, comme un sentiment de déjà vu qui peut éventuellement, dans certaines pathologies, investir la conscience immédiate du sujet. La mémoire traumatique de la Shoah, chez les Juifs, ou celle du génocide de 1915, chez les Arméniens, en sont des exemples classiques. Du point de vue de l’analyse du politique, et en particulier du point de vue de l’analyse du politique en Afrique, dans les Antilles, en Amérique latine, dans les pays arabo-musulmans ou en Asie, en bref dans toutes les sociétés post-coloniales et post-esclavagistes, cette idée de fausse reconnaissance ou de souvenir du présent nous permet de mieux comprendre les mémoires traumatiques de la servitude ou de l’occupation étrangère et raciale.
La remarque ou la perspective s’applique aussi bien à l’Europe. Je me souviens d’une rumeur qu’il y avait eu, il y a quelques années, dans la vallée de la Somme, en proie à une crue sévère. Selon cette rumeur, le gouvernement français déversait l’eau de la Seine dans la Somme pour éviter une grande inondation à Paris. Nul n’a jamais trouvé de preuve de cela, et pour cause ! Cela était matériellement impossible. Les historiens se sont demandés quelles étaient les logiques sous-jacentes à cette rumeur et ont avancé l’hypothèse selon laquelle cette dernière était l’expression d’une mémoire traumatique, en particulier des terribles destructions de la Première Guerre mondiale et de l’insuffisance, aux yeux des habitants, de l’effort de l’État dans la reconstruction de la région.
Si on prend ce qui se passe actuellement en Ukraine, on voit bien comment la compénétration des durées permet de comprendre la conscience politique « immédiate » des acteurs dans le « passage » d’un monde d’empires (celui des Romanov et des Ottomans, celui de l’URSS et plus fugacement, mais aussi plus tragiquement encore, celui du IIIe Reich) à un monde d’États-nations, ceux, antagoniques, de Poutine et de Zelensky. Les deux camps ont d’ailleurs recours au terme de génocide, sur fond de Shoah, de Grande Guerre patriotique – avec ses 26 millions de morts – et de famine liée à la collectivisation de l’agriculture en Ukraine. Zelensky parle de « génocide » à propos de l’invasion russe, là où il serait juridiquement plus exact de parler de crimes de guerre ou de crimes contre l’humanité – et Emmanuel Macron a sans doute raison d’être plus avare de ses mots que Joe Biden. Poutine dénonce le « génocide » dont seraient victimes les Russes dans une Ukraine « néo-nazie ».
Cette perspective bergsonienne, si je puis dire, était d’autant plus importante pour moi que l’un des thèmes du livre, notamment dans sa dimension critique de la domination politique contemporaine, vise à remplacer la conscience identitariste, qui s’est imposée comme conscience politique majeure depuis depuis deux siècles, par une conscience historique, une conscience politique d’ordre historique.
Il était donc crucial, à mes yeux, de mieux comprendre la compénétration des durées dans les sociétés politiques, y compris du point de vue de l’une des thématiques fortes de l’ouvrage : ce passage de l’empire à l’État-Nation. On ne peut pas raisonner en termes de transition ou de succession, parce que l’Etat-Nation naît au sein même de l’empire et que ce dernier reste présent dans l’État-nation qui émerge de ses ruines, comme par exemple chez Poutine et Erdogan. Ces derniers mobilisent l’imaginaire impérial pour renforcer l’État-nation, nonobstant les différences radicales entre les deux types de domination. L’empire gouverne indirectement son pluralisme, l’État-nation centralise et uniformise.
Il y a dans les faits une compénétration des durées impériale et statonationales, comme l’ont démontré Xavier Bougarel à propos de la Bosnie et Béatrice Hibou et Mohamed Tozy au sujet du Maroc. Ce terme de passage, on doit l’entendre au sens de Walter Benjamin, et non pas comme une succession ou un remplacement de l’un par l’autre.
La thématique de la compénétration des durées est au centre de la sociologie historique et comparée du politique dont je me réclame. Je pense que c’est précisément cette problématique qui manque aux études post-coloniales que j’ai étrillées dans mon Les Études postcoloniales, un carnaval académique (Karthala, 2010). Les auteurs de cette obédience n’ont pas lu (ou relu) Bergson. Pourtant ce dernier les aurait très certainement aidés à sortir de leur espèce de calvinisme tropical, à ne pas raisonner en termes de surdétermination, voire de prédestination, mais bien en termes d’énergie.
Est-ce que vous faites une exception pour Souleymane Bachir Diagne dont vous citez le Bergson post-colonial ?
Je ne sais pas s’il s’agit d’une exception car Bachir ne s’inscrit pas réellement dans les études postcoloniales dont il est assez critique.
En quoi est-il proche de vous sur les études post-coloniales tout en ayant d’autres champs ? D’une certaine façon, par rapport à l’Europe, il y a une césure que toute une partie du monde peut mesurer, celle du post-colonial, même si le post-colonial est bien cette concaténation de temporalités, ce feuilleté des durées, et l’utilisation également d’un certain nombre de triangulations. Il n’en demeure pas moins qu’il y a l’avant-colonisation et la post-colonisation alors que nous n’avons pas en Europe réellement ce type de coupure, à moins que vous ne puissiez en distinguer une.
Il est bien possible que ce soit ma lecture de Souleymane Bachir Diagne qui m’ait poussé à reprendre Bergson. Au fond, ce qui est intéressant est la manière dont Bachir Diagne nous rappelle que Senghor était un grand bergsonien, après tout comme tous les intellectuels d’expression française de son temps. Bergson occupe d’une certaine manière en France la place de Nietzsche en Allemagne.
En 1968, Bergson était encore au programme de terminale en philosophie.
C’est la raison pour laquelle je dis bien relire Bergson, je l’avais partiellement lu au lycée, comme tout adolescent du secondaire. Naturellement j’en ai aujourd’hui un usage et une lecture très différentes. Ce qui a été neuf pour moi était la manière dont Bachir Diagne exhumait ce dialogue entre le philosophe indien musulman Iqbal et Bergson. Il y a eu une sorte de dialogue pour ainsi dire tricontinental, fascinant, et qui n’a rien pour nous dérouter d’un point de vue théorique. J’ai toujours pensé que l’universalisation procédait par réinvention de la différence et que la condition sine qua non de l’universalité est la reconnaissance de l’historicité propre des sociétés. J’étais dans des eaux qui m’étaient largement compréhensibles, même si mon collègue philosophe m’amenait à reprendre un vieux classique de la philosophie française que beaucoup considéraient comme poussiéreux. Cette manière de procéder m’amène toujours à réfléchir ce que je crois comprendre des sociétés extra-occidentales, en l’occurrence l’Afrique, sur laquelle j’ai beaucoup travaillé, mais également l’Iran, la Turquie etc., afin d’essayer de rapatrier l’expérience historique de ces sociétés vers l’expérience historique de l’Occident pour mieux l’appréhender et, en quelque sorte, la « provincialiser » si l’on veut absolument citer Chakrabarty.
L’une des erreurs, à mon avis, des études post-coloniales est d’essentialiser la colonialité – le terme est parfois utilisé -, de ne pas comprendre l’historicité des situations coloniales, et donc leur singularité, et au fond d’exotiser – paradoxalement, car c’est en contradiction avec leurs prémices théoriques – la situation coloniale ou la situation d’esclavage. Cette opération de réverbération de l’expérience historique, par exemple de l’Afrique vers l’Europe, nous permet de relire autrement l’histoire de celle-ci. Les premiers esclaves en Europe étaient des blancs. Par exemple dans la Grèce antique ou dans l’Empire romain. Il pouvait bien sûr y avoir des noirs, mais nombre d’esclaves, sans doute la majorité d’entre eux, étaient, nous dirions aujourd’hui, Caucasiens. Caucasiens, ils le seront d’ailleurs au sens géographique du terme dans l’Empire ottioman : les fameux Mamelouks, le plus souvent capturés dans la chaîne du Caucase. Les Slaves furent un réservoir d’esclaves dont l’on faisait commerce, notamment sur l’un des quais de Venise sur lequel déambulent aujourd’hui les touristes. L’Andalousie, dont on a volontiers une idée très bisounours, pratiquait le commerce d’esclaves dont quelques-uns des principaux opérateurs étaient juifs et les importaient du monde baltique ou russe, via Verdun et la vallée du Rhône. Il y a toute une histoire de l’esclavage interne à l’historicité des sociétés européennes. De la même manière, le premier empire colonial, dans l’une des acceptions du terme, celle de l’historien de l’Antiquité Finley, c’est-à-dire la domination de territoires ultramarins par une administration métropolitaine, fut l’Empire de Venise, en Méditerranée orientale. De même que le modèle des plantations sera inventé initialement en Méditerranée orientale, en particulier à Chypre, avant d’être exporté dans les premières îles atlantiques qui vont tomber sous la coupe du Portugal et de l’Espagne, pour ensuite se développer dans le Nouveau Monde, en Afrique et en Asie. La périodisation coloniale que promeuvent les études postcoloniales laisse à désirer car elle est idéologico- et ethnocentrée.
La démarche comparative que j’essaye de suivre permet également des-éxotiser des empires comme celui des Ottomans. L’Empire ottoman, n’en déplaise à Perry Anderson, était une puissance européenne à part entière qui ne s’est étendue au Moyen-Orient qu’après avoir conquis une bonne partie des Balkans. Continuer à percevoir l’Empire ottoman comme un phénomène étranger, au bout de six ou huit siècles de domination au sens weberien du terme, amène à se demander à partir de quand on devient un « autochtone ». On part là sur un terrain assez glissant : l’Empire ottoman n’aurait pas été « européen » parce qu’il était « islamique », quand bien même « islamique » il ne le fut pas tant que cela…
Surtout qu’il était le symptôme de la maladie, on l’appelait l’homme malade. C’était quand même sa reconnaissance identitaire européenne dans un État dégradé.
Par cette démarche comparative j’ai essayé de problématiser en dehors de tout exotisme ce processus historique de passage de l’Empire à l’État-nation. De ce point de vue, j’ai construit mon raisonnement initialement sur l’Empire ottoman, à la suite d’une question que m’avait posée l’Agence française de développement. Celle-ci envisageait de supprimer son département Moyen-Orient Afrique du Nord (MENA), en se conformant au précédent de la Banque mondiale. Comment définir, comment caractériser ce fameux MENA ? J’avais essayé d’expliquer que nous ne pouvions en avoir une définition essentialiste, d’ordre géographique, religieux, culturel, économique – et encore moins politique ! En réalité, ce qui fait la cohérence cachée, refoulée, indicible du MENA, c’est le sang versé lors du passage d’un monde d’empires, essentiellement l’Empire ottoman, mais aussi les empires des Romanov et des Habsbourg, à un monde d’États-nations successeurs. Un passage dont l’ingénierie a été la purification ethnique, selon des versions hard – le génocide des Arméniens et des Yézidis – ou très relativement soft sur le mode de l’expulsion ou de l’exode au prix de massacres incitateurs : par exemple dans les Balkans ou en Algérie, au moment de l’indépendance. Comme l’a bien montré Xavier Bougarel à propos de la Bosnie, il s’agit souvent de tuer suffisamment pour rendre impossible la coexistence et irréversible la purification ethnique. Les conflits contemporains de la région MENA (mais aussi des Balkans ou de l’espace russo-ukrainien) sont des conflits liés à ce passage d’un monde d’empires à un monde d’États-nations. C’est vrai du Liban, d’Israël et de la Palestine, de l’Irak, de la question kurde, etc… Et chacun sait que l’affaire de la Bosnie n’est pas close, pas plus que celle du Kosovo.
Une fois que l’on construit cette interprétation du MENA, on s’aperçoit qu’au fond l’historicité de l’Europe du XXème siècle est exactement de la même encre, ou peut-être devrions nous dire du même sang. Par exemple, l’Europe post-habsbourgienne, avec les questions de la Ruthénie et de la Galice, à l’interface de l’Ukraine, de la Pologne, de la Hongrie. La Moldavie et la Transnitrie, dont nous parlons beaucoup aujourd’hui, ce sont l’ancienne Bessarabie qui nous donnait des maux de tête quand, lycéens, nous apprenions la « question d’Orient » dans nos manuels d’histoire. Le cas de l’empire des Romanov est plus compliqué, avec son avatar soviétique. L’expression « d’empire soviétique » est une métaphore qui n’est pas complètement inappropriée. L’URSS a très largement procédé par cooptation, comme les empires, mais a aussi nourri en son sein les logiques de la définition stalinienne des nationalités qui va se traduire par toute une série de déportations et exterminations de peuples supposés suspects ou ennemis, notamment dans le contexte de la collectivisation et de la Seconde Guerre mondiale. Le Reich allemand, lui, va procéder au génocide des juifs, à la Shoah. Ensuite, d’une certaine manière, la division de l’Europe entre les « empires » américain et soviétique, dans le contexte de la Guerre Froide, va se traduire par une gigantesque opération de purification ethnique plus ou moins refoulée de nos consciences politiques : la purification de l’Europe centrale et balkanique de sa part allemande, mais aussi l’échange coercitif de populations entre la Pologne et l’Ukraine.
Cette réflexion sur le MENA m’a amené à reconsidérer l’histoire de l’Europe qui est tout à fait comparable, au sens de Paul Veyne, avec l’histoire de l’Empire ottoman, mais également celle des empires coloniaux. Mon raisonnement, distinct de celui des études post-coloniales, banalise d’une certaine manière les empires coloniaux en tant qu’empires. Certes, ce sont des empires coloniaux. Ils ont une spécificité qui est la racialisation du sujet, en l’occurrence du colonisé, mais cette spécificité est relative. Les empires coloniaux, comme les empires classiques – ceux des Ottomans, des Habsbourg, des Moghol, des Safavides puis des Qajar, des Qing – gouvernent la différence, et par la différence, par la reconnaissance de la différence et de l’hétérogénéité des peuples conquis : par l’administration indirecte, l’Indirect Rule britannique (et de ce point de vue les modèles britannique et français sont plus proches qu’on ne l’a longtemps postulé.) L’ethnicité en Afrique, le communalisme en Inde, le confessionnalisme au Liban sont des consciences politiques nées du gouvernement colonial de la différence.
Les empires coloniaux ont une autre particularité, relative, car la plupart des empires classiques se sont retrouvés dans la même situation. Les empires coloniaux se sont encastrés, au gré de la conquête, dans des formes impériales antérieures, comme les grands empires ouest-africains, ou l’Empire Moghol en Inde, dont le Raj britannique victorien a largement repris la domination. La colonisation de l’Indochine par les Français a épousé les formes impériales établies : celles du Cambodge, du Vietnam – lequel avait d’ailleurs colonisé le premier. Je parle alors de combinatoires impériales – derechef, la guerre d’Ukraine doit se lire ainsi.
Empires coloniaux ou pas, le passage d’un monde d’empires à un monde d’États-nations est médiatisé, si je puis dire, par des logiques de purification ethnique, par échange ou déportation ou extermination de populations, ou encore par assimilation coercitive, comme dans le cas des Kurdes. L’actualité internationale demeure hantée par ce basculement. L’affaire des Rohingya en Birmanie, le code de la nationalité dans l’Inde de Narendra Modi, les convulsions politiques du Sri Lanka ou du Pakistan relèvent de ce paradigme.
Si on revient en arrière et si on utilise les notions qui sont reprises dans cet ouvrage, il y a celle de compromis disjonctif, avec une figure que vous suivez à plusieurs reprises : Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké. Vous avez une jolie formule à propos du Sénégal : vous parlez d’une République confrérique. Il faudrait que vous nous expliquiez ce compromis disjonctif entre Cheikh Ahmadou Bamba Mbacké et l’État colonial français, un Cheikh Ahmadou Bamba qui incarne toutes les dimensions de ce compromis et de la disjonction, par exemple quand, détenu au Gabon, il refuse sa ration de sucre. C’est très intéressant quand on sait qu’aujourd’hui l’État, dans une République laïque comme celle du Sénégal, offre une boîte de sucre en morceaux Saint-Louis au début du Ramadan… Comment ce compromis disjonctif fonctionne-t-il ?
L’idée de l’imbrication des durées que j’ai reformulée en termes bergsoniens de compénétration des durées m’est venue précisément en analysant la société politique sénégalaise. Après une période de suspicion à l’encontre de l’Islam, qui culmine avec la déportation de Cheikh Ahmadou Bamba, l’administration coloniale se résoud à coopter dans son État les confréries, essentiellement celles des Mourides et des Tidjanes. Ce compromis continue d’être la colonne vertébrale de l’État sénégalais postcolonial bien que celui-ci se définisse comme laïc et que la majeure partie de ses citoyens, musulmans, disciples pour nombre d’entre eux d’une confrérie, ne remet pas en cause ce principe de la laïcité. Bourdieu aurait dit que la laïcité fait partie de la « problématique légitime du politique » au Sénégal.
Un premier paradoxe est que la République française noue ce compromis avec l’Islam au moment même où, en métropole, elle instaure la séparation des cultes et de l’État. Il y a déjà là un beau sujet d’imbrication de durées ou d’agendas politiques disparates. Une construction politique baroque, très éloignée de l’idée « salafiste » de la laïcité chez un Manuel Valls ou un Jean-Michel Blanquer. Or la logique politique pertinente de ce compromis est qu’il intervient sur une disjonction. Il est possible précisément parce que les deux principaux acteurs se situent dans des espaces/temps hétérogènes.
D’un côté, l’administration coloniale cherche à administrer le Sénégal à moindre coût et meilleur profit, et elle se rend compte que sa tentative de compromis avec l’aristocratie wolof est politiquement décevante. Elle veut également garder le contrôle de sujets musulmans qui pourraient répondre à un appel à la guerre sainte du sultan-caliphe ottoman, perspective d’autant plus menaçante que le déclenchement de la guerre avec l’Allemagne et l’alliance de cette dernière avec l’Empire ottoman devenaient de plus en plus probables. Soit dit en passant, cette hantise d’un futur proche offre un autre exemple d’imbrication des durées, constitutive de l’action politique.
Certains acteurs mourides se situent au demeurant plus ou moins dans la même temporalité que le colonisateur : parce qu’ils veulent envoyer à la Chambre des députés Blaise Diagne, qui est des leurs ; parce qu’ils convoitent le foncier dans la nouvelle capitale, Dakar, et à l’intérieur des terres, pour profiter du boom arachidier.
D’un autre côté, on ne peut rien faire sans Cheikh Ahmadou Bamba qui, lui, est dans une temporalité autre, liée à l’Éternité comme pourraient le dire les catholiques. Son agenda c’est Dieu, c’est celui du service de l’Islam. Il est un mystique de haute volée, très grand lettré et poète comme la plupart des djihadistes de l’Afrique occidentale au XIXe siècle, Usman dan Fodio, Umar Tall. Ce n’étaient pas des types avec pantalons mi-mollet qui habillaient leur prisonniers avec des tenues Guantanamo, mais de vrais savants religieux. Cheikh Ahmadou Bamba est également un fils de famille. Son lignage, depuis deux siècles, portait la parole de Dieu dans l’espace sénégambien, dans un système régional de royaumes wolof dont la piété n’était pas la qualité première, et dont les guerriers étaient intempérants. Par ailleurs, ces royaumes wolof commettaient un péché majeur au regard des commandements de l’Islam en mettant en captivité et en vendant comme esclaves des musulmans. Ce lignage des Mbacké, dont Ahmadou Bamba est l’héritier, pérégrinait depuis le début du XVIIIème siècle dans la région afin d’essayer d’édifier les rois wolof tout en gardant son quant-à-soi. Leurs prédicateurs évitaient de s’installer dans les villes royales et préféraient établir leur campement à quelques kilomètres de ces dernières pour marquer leur distance par rapport aux turpitudes du politique. Ce qui nous rappelle au passage que l’Islam a toujours distingué le politique du religieux, quoi qu’en disent les crétins qui pérorent à longueur d’antennes sur l’Islam et voient dans cette prétendue confusion l’incapacité des musulmans à comprendre la République et l’idée laïque. L’exemple du lignage des Mbacké le démontre. Au cœur même de leur représentation religieuse du monde, il y avait bel et bien cette réserve, cette distanciation par rapport à la cité. Cheikh Ahmadou Bamba n’a, au fond, jamais été l’agitateur qu’une partie de l’administration coloniale, d’ailleurs sous l’effet d’intrigues de l’aristocratie wolof, a bien voulu voir. Il a toujours refusé la violence, même lorsqu’il fut arrêté. Il écrit d’ailleurs que le comportement méprisant du gouverneur lui a un moment inspiré un sentiment de colère et de violence, mais qu’il l’a refoulé car son djihad est celui de l’âme et de l’élevation religieuse, morale et philosophique.
Comment arrive-t-on de ce compromis dans la contradiction à la contradiction sans compromis ?
Justement, le compromis est rendu possible par la disjonction. Cette dernière crée une confusion et des malentendus, mais après un certain temps une autre partie de l’administration française comprend qu’au fond, une large fraction des forces confrériques en Afrique occidentale est prête à accepter la domination des blancs car celle-ci est inévitable et pas plus mauvaise que celle des royaumes impies. Aux yeux des croyants, le pouvoir est relatif et corrompu, presque par définition. Il faut faire avec, l’essentiel étant ailleurs. C’est bel et bien cette distinction des ordres, comme dirait Blaise Pascal, qui rend possible le compromis car il n’y a pas un jeu à somme nulle entre les deux sphères. Le compromis va se réaliser sur un plan politique, militaire, et sur un plan économique. Il offre aux mourides l’accès au foncier et la création dans l’hinterland d’une ville sainte, Touba, hétérotopie défiscalisée qui permet une administration indirecte du royaume de Dieu sur terre. Le colonisateur n’y voit que des avantages puisque la discipline spirituelle de cette confrérie des mourides repose sur le travail. Les disciples/talibés – même racine que les talibans, soit dit en passant – vont cultiver l’arachide au nom de Dieu pour le plus grand bonheur de l’administration coloniale et des intérêts capitalistes de Marseille. On a donc un compromis qui marche très bien. Vont s’en suivre de nombreuses transactions collusives entre le colonisateur et les mourides.
Autre effet de recomposition et de compromis : la confrérie elle-même va se bureaucratiser et adopter le modèle de l’administration coloniale en se dotant d’un calife-général. Les anthropologues, comme les viticulteurs, diraient qu’il s’agit d’un assemblage. C’est complètement baroque. On prend un titre musulman, qu’on ravit au nez et à la barbe du calife ottoman, et pour faire bonne mesure on ajoute général dans le sens colonial du terme : le général des troupes, le conseil général, le gouverneur général. Il va y avoir une espèce de bureaucratisation de la confrérie mouride, ce qui fait dire à un très grand historien de l’Islam en Afrique de l’Ouest, Jean-Louis Triaud, que l’idée même de confrérie est une invention coloniale. Il en va de même de l’ethnicité qui est une invention coloniale, non pas du colonisateur, mais du moment colonial, par une espèce de transaction hégémonique entre le colonisateur et le colonisé.
Cerise sur le gâteau, la confrérie va encourager et faciliter la conscription, par le truchement du député Blaise Diagne. Il y a donc toute une interaction qui finalement va conduire à l’institutionnalisation, à l’époque de la colonisation et au lendemain de l’indépendance, de ce que je qualifie ironiquement de République confrérique. Une République néanmoins laïque, car l’idée de la laïcité au Sénégal n’est pas simplement le fruit de la greffe du modèle français de l’État, mais aussi le produit dérivé d’une pratique pluriséculaire de l’Islam, singulièrement de la part des Mbacké qui se tenaient toujours à distance de la cité, au sens politique du terme.
Ma problématisation en termes de compromis disjonctif ayant pour toile de fond la compénétration des durées montre comment la laïcité au Sénégal est le produit, simultanément, de la greffe de l’Etat occidental, pour aller vite, lors du moment colonial, et de l’héritage d’une histoire de beaucoup plus longue durée, ce qui fait bien entendu, à mes yeux, sa force par rapport, en particulier, à d’autres situations en Afrique ou ailleurs.
Mais vous parlez aussi d’un État de distorsion. Comment est-on passé justement de cette compénétration à ce qui ressemble plutôt à une diffraction des espaces temps ?
L’État de distorsion est le prix à payer de cette compénétration des durées. La condition de ce raisonnement est de sortir de la périodisation pré-coloniale, coloniale, post-coloniale.
L’État de distorsion est un come-back ?
L’État de distorsion est un fait de conscience politique dont les Africains d’aujourd’hui sont tributaires. De manière schématique, et selon une formulation évidemment très contestable, pour ne pas dire erronée, ils sont habités par la mémoire des anciens royaumes et empires ou des sociétés lignagères, la mémoire coloniale – un point pour les études post-coloniales, sauf que celles-ci sont comme moi lorsque je faisais des mathématiques au lycée : elles arrivent à un résultat assez juste, mais leur démonstration est complètement fausse –, et la mémoire d’une période post-coloniale maintenant longue de plusieurs décennies et elle-même riche en événements. Michel de Certeau parlait du feuilletage du temps. S’il faut rester dans la métaphore culinaire je préférerais parler d’une mousse, d’une crème ou mieux peut-être d’un sabayon. L’histoire est un sabayon, et le sabayon devrait être le dessert préféré des adeptes de la sociologie historique et comparée de l’État !
Les Africains contemporains, dans leur conscience politique, sont en tension permanente entre ces mémoires historiques de durées diverses. La compénétration des durées est la force positive qui permet de comprendre la construction baroque de leur conscience politique. On a toujours le mixage de répertoires, de genres discursifs du politique qui sont hétérogènes. On peut être laïque, s’inscrire dans l’histoire de l’Islam, de tel ou tel empire, même médieval ou de l’âge classique, dans la mémoire traumatique de l’esclavage, dans la mémoire de la lutte anti-coloniale et éventuellement du mouvement communiste international, etc.
Évidemment, beaucoup d’Européens ont tendance à sourire de cela, en y voyant une preuve supplémentaire du caractère enfantin ou je ne sais quoi des Africains. Mais si on procède à cette opération de réverbération ou de retour sur image, et si on regarde nos sociétés européennes avec ce décalage mental que permet la sociologie historique et comparée du politique, on constate exactement la même chose. Par exemple, Emmanuel Macron, qui de manière très maladroite, car cela va se retourner contre lui, a essayé de flirter avec la mémoire de la monarchie dont les Français n’auraient pas fait le deuil – à ceci près que les Français ont coupé la tête du roi et que personne (ou bien peu) n’a jamais songé à la recoller. Le mouvement des Gilets jaunes va lui renvoyer cette conscience ou cette mémoire révolutionnaire en érigeant des guillotines sur des ronds-points et en faisant de Brigitte Macron, d’une manière extrêmement déplaisante, une nouvelle Marie-Antoinette, en se montrant aussi ordurier à l’égard de Brigitte Macron que les sans culotte le furent vis-à-vis de Marie Antoinette.
Ces effets de compénétration des durées, on les vit avec les mémoires coloniales. Par exemple l’hypothèse de Benjamin Stora selon laquelle le Front National serait en quelque sorte un retour du refoulé, le refoulé de la colonisation mais aussi des atrocités de la guerre d’Algérie. Il ne faut pas oublier que des dizaines de milliers de jeunes Français, qui n’avaient aucune expérience ni de la guerre ni de l’étranger, entre dix-huit et vingt-deux ans, se sont retrouvés en tant que conscrits confrontés aux horreurs de la guerre : celles qu’ils commettaient et celles que commettait le FLN. Tout cela a été refoulé dans la mémoire historique de la société française, mais ne reste sans doute pas sans symptômes.
Le style vestimentaire apparaît dans votre livre comme une pratique sociale à travers laquelle se posent un certain nombre de problématiques. Que dit ce style vestimentaire du gilet jaune, qui est à la fois un signe de la rupture mais aussi un vêtement de sécurité quasiment uniforme ? Est-ce que c’est celui de la singularité ou celui au contraire de la massification ? Comment à la fin se conjugue ou se disjoncte le style vestimentaire et l’énergie de l’État ?
L’État est une abstraction. C’est même une double abstraction. C’est d’abord un concept. C’est une abstraction qui ne dit pas une essence, mais un événement, pour reprendre la mise en garde de Deleuze. Précisément ce concept d’État désigne un événement historique, un processus historique, un processus d’abstraction du réel hétérogène, essentiellement par le biais de la domination bureaucratique, rationnel-légale au sens weberien du terme, qui passe par toute une série d’effets d’abstraction de ce réel hétérogène. Le gouvernement par les nombres dont on parle beaucoup aujourd’hui, les algorithmes, etc. L’abstraction du territoire, l’abstraction du peuple que l’on invente pour pouvoir le dominer, l’abstraction de la réforme administrative, fiscale, économique mais aussi religieuse – le fondamentalisme, en tant que réforme religieuse, est un processus d’abstraction du vécu socialement complexe de la foi.
La réforme est aujourd’hui une figure de style obligée. C’est devenu un mot valise, vous n’avez pas un seul candidat qui ne prétende faire des réformes. Or la réforme est la mise en abstraction d’un réel hétérogène, de manière normative, en termes de politiques publiques. Ce peut être aussi la réforme musicale. J’ai essayé de montrer comment le passage de l’empire à l’État-nation, en Turquie, passe par une réforme musicale inspirée de celles de l’Europe centrale. On fait venir Bartok, et Atatürk lui demande, en quelque sorte, de créer une musique populaire turque à partir du réel hétérogène musical de l’Anatolie. La formation de l’État-nation est également passée par une réforme de la langue, par sa standardisation : dans l’Empire ottoman, avant même le changement d’alphabet qu’Atatürk décrète, mais aussi en Iran, en Chine.
Mais insistons sur la réforme religieuse. En effet l’émergence de l’État-nation est concomitant d’un grand siècle religieux, fait qu’on a trop oublié. À nos yeux, le XIXème siècle, c’est le positivisme, le progrès, la révolution industrielle etc. Certes. Mais n’oublions pas que la catégorie même de religion, au sens où on l’entend aujourd’hui, est une création du début du XIXème siècle, et le produit du désenchâssement réciproque des champs politique, économique, culturel et religieux dont parle un Karl Polanyi. La thématique de la réforme religieuse est omniprésente tout au long du XIXème siècle : le méthodisme chez les protestants, l’invention de l’hindouisme sur un modèle écclesial, la Nahda dans le monde musulman, les transformations de l’Église catholique. Je le répète, les fondamentalismes, musulman, chrétien, hindouiste, sont des effets d’abstraction. C’est l’abstraction d’une religion, du retour à une religion originelle, primitive qui n’existe que dans la tête de ses concepteurs. Il en est ainsi des représentations du christianisme primitif de l’Antiquité, ou de l’islam de Médine chez les salafistes. C’est ce en quoi Manuel Valls est un fondamentaliste. Il s’invente sa petite Troisième République qui n’existe que dans son imaginaire. Il ne faut tout de même pas oublier que la laïcité, aujourd’hui supposée défendre les femmes contre l’Islam, ne reconnaissait pas le droit de vote aux Françaises, suspectées de sympathies coupables pour l’Église catholique. Le substantif ne figure d’ailleurs pas dans la loi de 1905 – il n’apparaît dans la langue française qu’entre les deux guerres – et la République française n’est constitutionnellement laïque que depuis 1945.
L’État est donc ce processus d’abstraction du réel hétérogène dont on peut se demander s’il n’est pas également en affinité avec l’abstraction technique, scientifique et artistique, s’il n’y a pas des affinités électives entre ces différents phénomènes qui sont contemporains. Si on accepte que l’État est un effet d’abstraction, on comprend mieux que sa domination est médiatisée par des styles. Un style, c’est une abstraction. Ce peut-être un style d’éloquence, comme les historiens l’ont montré au sujet de l’Antiquité. Ce peut être une gestuelle. Et, pour revenir à la question, il est vrai que le vêtement est en effet l’une des grandes médiations politiques sous-jacentes à des styles de domination. C’est quelque chose de compréhensible dans notre vie quotidienne. Le patron, par exemple, pour dominer ses salariés ou convaincre son banquier, se montrera dans son armure, c’est-à-dire son costume cravate. Ou en jean et polo pour rappeler qu’il est humain et bon père de famille.
La guerre d’Ukraine est un peu l’affrontement de deux conceptions différentes de la domination politique. Cela illustre bien notre propos car survient ici, nous l’avons vu, un processus de passage d’un monde d’empires à un monde d’États-nations. Un processus d’autant plus fascinant qu’il survient dans une zone de confins d’empires. Nous sommes sur les confins de ruines d’empires, d’une combinatoire impériale. Avec deux manières différentes de passer de l’un à l’autre : d’un côté, Poutine qui essaye d’inventer un État-nation Grand Russe sur les débris de l’empire soviétique et qui, à mon avis, entretient avec l’empire des Romanov le même genre de rapports qu’Erdogan avec l’Empire ottoman. Je ne pense pas que l’un et l’autre soient assez fous pour s’imaginer reconstituer un empire ni qu’ils aient envie de ce genre de domination. Simplement, il y a compénétration des durées, dans l’ordre de l’imaginaire mais aussi dans celui de la manipulation politique : l’empire des Romanov et l’empire soviétique vont fournir des figures imaginaires de domination. De son côté, Zelensky est en train d’inventer, grâce à la contribution involontaire de Poutine, un État-nation ukrainien que la Russie renforce au fur et à mesure qu’elle le détruit, puisque même les russophones se sentent aujourd’hui quelque peu mal à l’aise par rapport au Kremlin. L’Église orthodoxe ukrainienne, qui dépend du patriarcat de Moscou, se sent à son tour de plus en plus gênée et divisée. La représentation de la cité que se fait Zelensky est très différente de celle de Poutine, et serait plutôt d’ordre démocratique. Or cet affrontement de deux conceptions de la domination politique, sur les mêmes décombres impériaux, est médiatisée, mise en forme par un affrontement de style vestimentaire. D’un côté, Poutine, imberbe, dans son éternel costume noir cravate rouge, à environ trois-cents mètres de ses interlocuteurs, au bout de sa grande table blanche. De l’autre, Zelensky, mal rasé, en t-shirt kaki, ayant un style non seulement vestimentaire mais aussi oratoire et gestuel complètement différent de l’absence de style gestuel de Poutine qui malheureusement ne connaît de geste que celui de tirer sur un tigre ou de « buter les terroristes dans les chiottes ». Il y a là un extraordinaire effet d’abstraction, tant vestimentaire que gestuel et discursif, et aussi dans la mise en scène, dans la théâtralité de l’exercice du pouvoir.
Autre exemple : les Gilets jaunes. C’est vraiment la force du politique « par le bas ». Voilà un mouvement complètement amorphe, sans leader, sans parti, et qui invente de manière spontanée un imaginaire politique propre et redoutablement éloquent – ce en quoi il a comporté une dimension « Mai-1968 » que beaucoup de mes collègues n’ont pas voulu voir, mais qui me paraît assez indéniable. Ce mouvement populaire amorphe invente donc des modes d’action et une expressivité politique, ou une abstraction politique, extraordinairement efficaces. Des manifestations sur les rond-points qui symbolisent au fond la modernité de la société française et l’événement de la société et du paysage français de la seconde moitié du XXe siècle, par la périurbanisation, le bétonnage etc. Ce lieu, ce non-lieu pourrait-on dire, c’est une trouvaille symboliquement formidable, et très efficace car par définition les gens empruntent tous les jours des rond-points. C’est comme le système nerveux ou sanguin de la société automobile contemporaine. Donc c’est également une puissante idée stratégique.
Chez les Gilets jaunes il y a eu une intelligence stratégique et symbolique collective. Sans même parler du gilet jaune lui-même qu’un nombre croissant de gens portent : la société française moderne a transformé la nation en une nation d’éboueurs. Tout le monde a son gilet de sécurité. Cela a été l’une de ces petites mesures presque vexatoires imposée par l’État que d’avoir dans sa voiture autant de gilets jaunes que de passagers. On est à la fois dans l’obligation réglementaire, sous peine de contravention, et de transgression systématique, car rares sont les voitures avec autant de gilets. Avec une intelligence presque démoniaque, les Gilets jaunes, reflets d’une société civile « primitive et gélatineuse », pour citer Gramsci, inventent une espèce inédite de mouvement, en bref une énergie de l’État : une énergie populaire, une intelligence populaire impressionnante, quoi que l’on pense de ses modalités ou de ses revendications. Et une forme abstraite qui va faire florès.
L’État, pour reprendre une distinction classique chez moi, et que j’emprunte à deux historiens du Kenya, John Lonsdale et Bruce Berman, c’est la construction de l’État par les détenteurs du pouvoir politique, mais c’est aussi la formation de l’État par le bas, y compris par la production, par l’énergie d’un imaginaire dont les idéologues n’ont pas le monopole et qui est très largement produit par les « en bas du bas », comme on dirait en Côte d’Ivoire. De ce point de vue le mouvement des Gilets jaunes est intéressant à analyser, parce que c’est effectivement un moment d’imagination constituante dont l’efficacité politique a été remarquable : les Gilets jaunes ont obtenu très rapidement au moins une partie de ce qu’ils réclamaient et de ce qui avait été refusé aux syndicats. Tout comme d’ailleurs, récemment, les lycéens corses, en une ou deux journées d’émeutes, ont obtenu de l’État français ce qui avait été refusé aux élus légitimes, à savoir la reconnaissance de l’autonomie.
On retrouve, comme dans une espèce de coupe géologique, l’imaginaire national français avec sa dimension girondine – les affreux Parisiens, l’investissement sur un mode presque sans culotte de Paris, y compris de ses beaux quartiers, une transgression majeure qui amènera le préfet Lallemant à répondre de la manière qu’on lui connaît -, tout cet imaginaire révolutionnaire qu’avait réactivé de manière très imprudente Emmanuel Macron en avouant son incapacité à faire le deuil de Louis XVI, sa nostalgie intime plus que celle des Français et qui fait pendant à l’attachement viscéral de Jean-Luc Mélenchon à la Révolution, non sans flirter de manière subliminale avec les miasmes du roman national et de la Contre-Révolution qu’incarne un Eric Zemmour, tout à son fantasme de réconcilier Pétain et de Gaulle. Il est fascinant de voir comment Emmanuel Macron va faire ses dévotions à la pucelle d’Orléans, est un fan du Puy du Fou, et va réveiller la vieille bête révolutionnaire.
On retombe sur la triangulation qui est l’épine dorsale de mon livre. Depuis le XIXe siècle on observe simultanément les logiques d’intégration du monde comme premier sommet du triangle, celles de l’universalisation de l’État-Nation comme deuxième sommet, et la généralisation de consciences identitaristes dans l’imaginaire politique comme troisième sommet. Les Gilets jaunes sont à la confluence de ces trois sommets, soit pour les assumer soit pour les récuser, et non sans hésitations, sans négociations de leur part. Leur mouvement nous a rappelé que l’État, c’est effectivement de l’énergie : un événement et non une essence.

