Un portrait d’immigrés kurdes en Allemagne
Dans Dschinns [Djinns] Fatma Aydemir, 26 ans, d’origine turque et née à Karlsruhe, raconte la vie d’une famille d’immigrés kurdes en Allemagne. À travers trois générations, elle décrit comment parents, enfants et petits-enfants portent ce destin en eux et comment ils essaient le plus dignement possible de vivre avec. Un portrait à multiples facettes d’une grande intelligence et finesse psychologique.
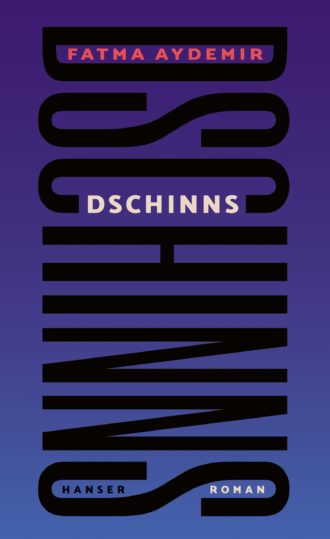
« Qu’est-ce qu’un Djinn ? » demande Ümit, le benjamin de la famille à sa sœur Peri. « Peri sent le froid pénétrer sa peau. Comme toute personne ayant grandi dans un foyer musulman et qui entend ce mot. (…) Est-ce que c’est comme un fantôme ? demande-t-il ? Oui, dit Peri, ou non, pas tout à fait. N’est-ce pas comme avec la mort ? Le Djinn, c’est le vague, l’incertain, l’obscur qui fait peur aux gens parce que ce n’est pas une chose tangible et parce qu’ils doivent le remplir de leurs propres fantasmes ».
Des Djinns et des morts, il y en a beaucoup dans ce roman dans lequel Fatma Aydemir dresse le portrait d’une famille kurde immigrée en Allemagne peu après le coup d’État de 1971 en Turquie.
Le premier à mourir dans cette histoire, c’est Hüseyin, le père. Il meurt d’abord au sens figuré, à 25 ans à peine, lorsqu’il entre dans l’armée turque qui l’oblige à combattre son propre peuple, les Kurdes, là-haut dans les montagnes, là où Hüseyin a grandi, là où il a rencontré sa femme Emine. Les Kurdes, dont Hüseyin, cessent alors de parler leur langue car « à l’armée, on nous a appris que les Kurdes n’existent pas et qu’il n’y a que les Turcs qui vivent dans ce pays ».
Puis Hüseyin meurt au sens propre, dès les premières pages de ce roman, lorsqu’il rentre à Istanbul. Il venait d’y acheter l’appartement de ses rêves, pour enfin profiter de sa retraite après avoir trimé toute sa vie dans une usine de métallurgie en Allemagne. Sa femme et ses enfants n’auront pas eu le temps de le rejoindre qu’il s’écroule tout seul dans sa cuisine flambant neuve.
Réunie à Istanbul, la famille est sous le choc. Certes, cela faisait longtemps qu’Hüseyin avait mal partout, son dos, ses genoux « étaient foutus à cause du travail », mais son cœur semblait solide pourtant. Ce cœur enfin un peu soulagé de tant de souffrances, dont la famille n’apercevait qu’une infime partie, car comme beaucoup d’hommes de sa génération, Hüseyin ne parlait pas. Quelque part, entre l’usine le matin et la télé le soir, il avait perdu son identité et sa langue.
Et c’est ainsi que sa famille vit dans le silence, le non-dit et le faux-semblant. Perdue entre deux pays, discriminée partout, Kurdes en Turquie, « Scheiβkanacken » (métèques de merde) en Allemagne, nulle part à sa place. « Dans cette famille, on ne se dispute jamais à voix haute, on se bat toujours avec des regards lourds de sens. Le silence, c’était l’arme de mon père » remarque Hakan, le fils ainé, prêt à tout pour ne pas devenir « un pauvre travailleur immigré » comme son père. « Hakan sait qu’il y a 1000 façons de gagner sa vie plus facilement que de trimer dans une usine et de se soumettre aux ordres d’un quelconque contremaître à la con ». Hakan, lui, ne se laisse pas faire. Il rêve de devenir acteur, puis rappeur et même s’il finit par trafiquer des voitures d’occasion, « peu importe, car l’essentiel c’est de prendre des risques et de vivre sa vie ». C’est pourquoi il refuse également de jouer le rôle du fils ainé et de devenir « un homme un vrai », comme l’attendait tant son père. Il en a marre de « toutes ces conneries » dont souffre encore plus son petit frère Ümit qui va consulter un psy pour avoir eu le malheur de tomber éperdument amoureux de son meilleur ami Jonas.
Élevés à la dure, ce ne sont pas les hommes qui s’en sortent le mieux dans ce roman, même si c’est autrement plus difficile pour les filles. Notamment pour Sevda, l’ainée qui grandit dans le village kurde de ses grands-parents avant de rejoindre sa famille en Allemagne à l’âge de 15 ans et à qui sa mère compte réserver le même sort que le sien. Privée d’école, Sevda n’a pas d’autre choix que de se marier et de faire des enfants. Mais elle finit par quitter son mari et par reprendre une pizzeria en bas de son appartement où elle élève seule ses deux enfants. À la dure aussi en faisant d’eux, à leur tour, des petits immigrés exemplaires pour qu’ils aient toutes les chances de réussir dans cette vie. Pourvue du caractère définitivement le plus fort de ce roman, c’est elle aussi qui va rompre le silence en mettant sa mère, incapable de se rebeller, face à ses responsabilités, provoquant ainsi un séisme dont Emine ne sortira pas vivante.
Reste Peri, la petite sœur, née en Allemagne, « qui ne doit pas tourner le dos à sa famille pour s’émanciper » et qui depuis toujours fait « tout le contraire de ce qu’on attend d’elle » : elle étudie la germanistique à Francfort, s’intéresse à Nietzsche et aux théories féministes, écoute du hip-hop, refuse de se marier, décide d’avorter et tente – en vain – d’emmener sa mère chez le psy. Libre d’être elle-même, elle est capable de prendre de la hauteur et de placer sa situation familiale dans un contexte socio-culturel.
Peri, c’est très probablement l’alter ego de Fatma Aydemir, également née en Allemagne où elle se bat, elle aussi, contre les stéréotypes. En tant qu’auteure (Dschinns est son deuxième roman) et en tant que journaliste. Comme beaucoup de jeunes auteures de sa génération issues de l’immigration telles Deniz Ohde et Ronya Othmann, Fatma Aydemir écrit des chroniques pour la TAZ, quotidien alternatif de gauche qui donne une voix à cette nouvelle génération, capable d’aborder des thèmes comme l’immigration et le racisme en connaissance de cause, sans tabou, souvent la rage au ventre. Lucides par rapport à leurs pays d’origine et par rapport à leur pays d’accueil, elles ont le courage de se battre contre le politiquement correct, ce qui leur vaut – à juste titre – beaucoup d’attention actuellement en Allemagne.
Ce même ton implacable, on le retrouve dans Dschinns, dans lequel quatre enfants issus de l’immigration prennent enfin la parole pour dire stop. Stop au racisme ambiant avec lequel ils sont confrontés en Allemagne où les foyers d’immigrés brûlent (l’auteure fait ainsi référence aux attentats de Hoyerswerda de 1991) et où les travailleurs immigrés continuent d’être maltraités. Mais ils disent stop également au mutisme de leurs parents et à leurs valeurs traditionalistes, souvent machistes, misogynes et homophobes, qui les empêchent de s’intégrer dans leur pays d’adoption. Un roman qui se bat contre toute sorte de victimisation et qui aborde la question du choix et de la responsabilité de tout un chacun avec beaucoup de force et de courage.

