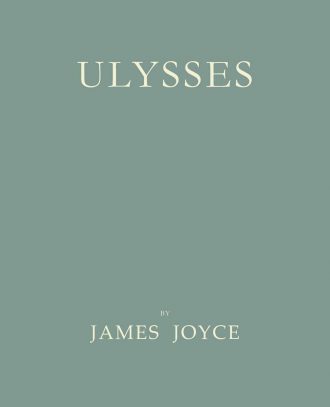Le centenaire d’Ulysse
Cent ans après la parution d’Ulysse de James Joyce, à Paris, et 140 ans après la naissance de l’écrivain, la littérature occidentale semble souffrir d’amnésie ou de dénégation, comme si la révolution artistique du modernisme anglo-saxon n'avait pas eu lieu.
James Joyce lui-même a déclaré à plusieurs reprises qu’il avait écrit son œuvre pour donner du grain à moudre aux chercheurs pendant trois cents ans. Maintenant qu’Ulysse, publié pour la première fois en 1922, a un siècle, nous pouvons constater que cette prophétie continue de se réaliser, bien que sous une forme résiduelle, dans le secteur des études universitaires. Mais nous devons aussi reconnaître que l’aura mystique qui a accompagné le roman depuis sa parution a fini par nuire à sa postérité, en le transformant en une œuvre que tout le monde connaît et que peu lisent. D’autre part, il n’échappe à personne qu’en cet anniversaire de l’annus mirabilis de la littérature européenne, ce que nous appelions jusqu’à récemment le « canon occidental » subit un discrédit qui aurait été inimaginable pour la génération de Joyce, T.S. Eliot ou Ezra Pound. Le modernisme a violemment rejeté certaines esthétiques mais, loin de remettre en cause le canon, il s’est surtout attaché à secouer la tradition jusque dans ses fondations et à intégrer ce nouvel ordre dans son présent, pour reprendre une idée chère à T.S. Eliot. En ce sens, Ulysse continue d’offrir une résistance contre la domestication de la littérature et la soumission à de nouveaux dogmes.
Le voyage de Leopold Bloom et Stephen Dedalus est un passage de l’obscurité à la lumière qui s’opère dans des sphères très diverses et synchronisées. Mais avant toute chose, il convient de rappeler qu’Ulysse, comme Don Quichotte, est une grande comédie au bord de l’abîme. Joyce lui-même a admis un jour à Samuel Beckett qu’il s’était peut-être trompé dans ses efforts pour systématiser le roman avec tous ces schémas explicatifs qui l’accompagnent généralement en notes, et qui souvent dissuadent le lecteur au lieu de le guider. Avant d’être un mammouth hermétique et avant-gardiste, Ulysse est une œuvre vivante, pleine d’humour, parfois hilarante, irrévérencieuse, transgressive, excessive, parfois lourde et même insupportable, mais finalement lumineuse et positive. Le parcourir reste une expérience irremplaçable, pleine de surprises pour le lecteur de notre temps.
Avant d’être un mammouth hermétique et avant-gardiste, Ulysse est une œuvre vivante, pleine d’humour, parfois hilarante, irrévérencieuse, transgressive, excessive, parfois lourde et même insupportable, mais finalement lumineuse et positive
Andreu Jaume
Pourquoi, disent certains, une complexité formelle aussi ostentatoire et gratuite ? La question est particulièrement insistante à notre époque. Cent ans après cette révolution artistique, la littérature occidentale semble souffrir d’une crise d’amnésie ou de désertion, comme si tout cela n’avait jamais eu lieu. Des œuvres telles qu’Ulysse nous rappellent toutefois que le roman, en tant que genre dépositaire de la narration, est un jour devenu incapable de continuer à raconter l’histoire, à témoigner de l’expérience humaine avec joie et ingéniosité. Le phénomène a commencé à être observé à la fin du XIXe siècle. Le roman, qui avait aspiré à supplanter l’épopée et l’histoire, a commencé à montrer des signes de fatigue et une incapacité à englober le monde. Flaubert était déjà un symptôme de cet épuisement. Sa dernière œuvre, Bouvard et Pécuchet (1881), n’est qu’une dramatisation satirique de l’effondrement du savoir, dernier acte de l’illusion bourgeoise de la maîtrise. Le style tardif de Henry James est également touché par cette paralysie. Dans ses derniers romans, il ne se passe rien d’autre que le flux de conscience (stream of consciousness) — l’expression est de James — de personnages paralysés devant eux-mêmes et leurs décisions morales. La spéculation réflexive remplaçait ce qui faisait jadis autorité. Pour le dire avec Walter Benjamin, la disparition progressive de l’art classique de la narration est aussi l’extinction de la sagesse, de la dimension épique de la vérité. Le roman — et surtout le roman du vingtième siècle — devait désormais se poser en épopée de la connaissance. Même Borges, avec ses paraboles essayistes, illustre ce problème.
La crise de la représentation littéraire dans Ulysse peut être comparée aux bouleversements parallèles d’autres arts comme la musique ou la peinture. La réaction contre la mélodie et la tonalité ou la disparition de la perspective et l’irruption de l’abstraction sont des symptômes du fait que l’homme occidental ne pouvait plus se regarder selon les schémas établis depuis des millénaires par la mimesis. Le centre de référence s’est déplacé ou a été détruit, notamment en raison de l’épuisement religieux et des avancées scientifiques, transformant à jamais notre rapport à la mort, à l’horizon eschatologique, et bouleversant ainsi l’échelle humaine. Bien que Joyce n’ait appartenu à aucun mouvement d’avant-garde et qu’il n’ait suivi aucun programme dans son travail, Ulysse a été immédiatement reconnu comme l’expression d’un changement d’époque. Ezra Pound, qui s’est fait le défenseur du modernisme, est allé jusqu’à dire que l’ère chrétienne avait pris fin le 31 octobre 1921, lorsque Joyce a écrit les derniers mots de son roman. Et pendant quelques années, Pound lui-même a couronné ses lettres de la légende post scriptum Ulixi, c’est-à-dire « après l’écriture d’Ulysse ». La nouvelle ère, cependant, allait être celle du totalitarisme, que Pound, comme tant d’autres des deux côtés du spectre idéologique, embrasserait avec enthousiasme.
Pourquoi Joyce a-t-il choisi le nom d’Ulysse pour le titre de son roman ? Au cours de ce siècle, en partie grâce à cet effort gratuit de systématisation auquel nous avons fait référence plus haut, les correspondances entre le voyage de Léopold Bloom et le poème homérique ont été étudiées ad nauseam, avec des résultats aussi évidents que décevants. La référence aux aventures d’Ulysse est de nature extra-formelle. Dans son roman, Joyce a entrepris d’intégrer et de subvertir le canon, en le faisant résonner d’un nouveau souffle. En fonction de cette angoisse extrême des influences, qui pour la première fois se manifestent violemment, Homère est l’architecte de la parole dans le temps. Dans ses poèmes, il crée l’événement de l’histoire et le devenir de l’expérience tels que nous avons appris à les imaginer en Occident. La relation entre les hommes et les dieux, la guerre, le voyage, le retour, la recherche du père ou du mariage sont les problèmes humains constants avec lesquels nous avons construit notre représentation. Deux mille ans plus tard, le titre d’Ulysse ne pourrait être plus ironique. Ce qui, dans l’épopée, était de l’ordre de l’oral et de l’écoute collective, est devenu de l’ordre de l’écrit et de la lecture individuelle. La relation entre les hommes et les dieux avait été rompue avec l’épuisement du christianisme. L’expérience riche et expansive d’Ulysse dans son poème plein d’aventures a été réduite à une journée ordinaire dans la vie d’un cocu mi-juif dans la ville de Dublin à une date indifférente. Les perspectives d’accomplissement épique — le nationalisme irlandais — se noyaient dans leur propre banalité. La métaphore homérique ne pouvait donc être que négative.
Car malgré les feux d’artifice, Ulysse n’est rien de plus qu’un roman. Et, en tant que tel, il assume et exploite toutes les limites de son genre, se posant également comme la conclusion de l’odyssée imaginative qui a commencé avec Cervantès. Il est éloquent que tant Don Quichotte qu’Ulysse, l’alpha et l’oméga d’une tradition, aient été à l’origine une nouvelle, un roman exemplaire dans le cas de Cervantès et un conte de Dublin dans le cas de Joyce. Chez les deux auteurs, le personnage s’est émancipé de l’intrigue, échappant au destin pour se répéter à l’infini. De la même manière que le chevalier et son écuyer sont la parodie d’une expérience tragique disparue, Leopold Bloom et Stephen Dedalus apparaissent au début du vingtième siècle pour certifier l’épuisement du drame bourgeois que le roman avait raconté. Cyril Connolly a observé que dans Ulysse, les personnages n’évoluent pas. Mais c’est précisément le sujet du roman. Les intrigues d’initiation, de formation, de malentendu filial et d’adultère qui avaient fait la carrière du grand roman moderne sont ici éludées et estompées au profit de l’étude des personnages et de leur rapport au langage. Joyce semble dire : « Nous savons ce qui leur est arrivé, nous devons maintenant nous demander ce qu’ils sont ».
Homère est l’architecte de la parole dans le temps. Dans ses poèmes, il crée l’événement de l’histoire et le devenir de l’expérience tels que nous avons appris à les imaginer en Occident.
andreu jaume
Joyce pouvait se permettre cette transgression car il s’était auparavant essayé à tous les genres, de la poésie et la nouvelle au théâtre et au roman de formation. L’ensemble de son œuvre, en fait, se réduit à une série de motifs qui se répètent et se transforment dans des styles différents jusqu’à atteindre le paroxysme d’Ulysse. Dubliners (1914) reste un recueil exemplaire d’images de la vie d’une société. Les Exilés (1915) est un beau drame ibsénien sur le mariage. Et Portrait de l’artiste en jeune (1916) est un Bildungsroman dans lequel, comme l’a observé Anthony Burgess, pour la première fois, ce qui est raconté affecte le style. Ulysse ne sera que la problématisation radicale de tous les éléments déployés dans ces œuvres. Stephen Dedalus, l’alter ego de Joyce, rencontre Leopold Bloom, dont l’expérience sentimentale prolonge et complique ce qui avait déjà été exploré dans Les Morts et Les Exilés. Et, bien sûr, l’expérimentation stylistique du Portrait devient ici un autre personnage. Il est intéressant de noter comment Joyce déçoit les attentes du lecteur de roman classique, puisque le premier chapitre présente des personnages dont il fait ensuite avorter l’histoire pour se concentrer sur d’autres aspects qui n’avaient jamais mérité l’attention du genre.
Que raconte donc Ulysse ? Portrait de l’artiste en jeune homme s’ouvre sur une citation des Métamorphoses d’Ovide : « Et ignotas animum dimittit in artes » (« Et il appliqua son âme sombre aux arts »). L’expression fait référence à Dédale, l’artisan qui a construit le labyrinthe dans lequel il a été emprisonné avec son fils Icare sur ordre du roi Minos. Grâce à ces arts sombres, Dédale a pu fabriquer les ailes de cire avec lesquelles le père et le fils s’échappent de prison. Pour Joyce, le mythe de Dédale représente la capacité de l’art à nous libérer des liens familiaux et historiques. Malgré toute la noirceur du monde dans lequel ils ont vécu, les auteurs du modernisme sont les derniers à manifester une foi inébranlable dans le pouvoir et la magie de l’imagination artistique. En ce sens, ils sont les héritiers de l’esthétisme de la fin du siècle. Et Joyce, comme Pound, a été toute sa vie convaincu que la littérature était une nouvelle religion. Ce n’est pas pour rien qu’il se sentait un enfant du naturalisme et du symbolisme. C’est pourquoi, dans Ulysse, la langue n’est plus seulement un instrument, mais un protagoniste à part entière, peut-être le principal.
La question du langage traverse bien sûr toute l’esthétique de l’époque. Un an avant la publication d’Ulysse, Wittgenstein avait révolutionné la philosophie avec le Tractatus logico-philosophicus, initiant la plus sérieuse interrogation sur les limites du langage jamais formulée. Joyce, pour sa part, s’est également attaché à cartographier les frontières du monde des mots, soumettant ses personnages à un examen verbal sans précédent. La langue, dans Ulysse, naît, se développe et se détruit. Que reste-t-il de la vérité dans la parole ? C’est l’une des questions constantes du roman, qui, pour cette raison même, questionne les grands pères de la tradition littéraire. Non seulement Homère, mais aussi Shakespeare et Dante jouent un rôle central dans la lutte à mort de Joyce avec l’héritage qu’il a reçu. Joyce, Eliot et Pound ont été les premiers à contester le canon européen inventé par les romantiques, se sentant les gardiens d’un héritage qu’ils ont également sévèrement remis en question.
Stephen Dedalus est le fils paria qui s’enfuit de chez lui à la recherche d’un père spirituel, qu’il trouve en la personne de Leopold Bloom. Bloom est un homme ordinaire d’une quarantaine d’années, agent publicitaire, descendant d’émigrés juifs hongrois mais converti au protestantisme. Lui et sa femme, Molly, une chanteuse d’opéra connue à Dublin, ont une fille de quinze ans, Milly, qui ne vit plus avec eux, étant partie dans une autre ville pour étudier la photographie. Le couple a également eu un fils, Rudy, qui est mort onze jours après sa naissance – ce qui rappelle la mort d’Hamnet, le fils de Shakespeare mort à l’âge de onze ans — une perte qui a traumatisé Molly, qui, en conséquence, ne veut plus avoir de relations sexuelles avec son mari depuis dix ans. Molly a plutôt une liaison avec Blazes Boylan, son manager. Bloom, quant à lui, entretient une relation épistolaire clandestine avec une certaine Martha Clifford. Malgré tout, Bloom et sa femme sont toujours très attachés l’un à l’autre, comme le montre le monologue final de Molly.
Stephen s’introduit dans ces vies ordinaires à la recherche d’une révélation. Jusque-là, sa vie a consisté en un perpétuel mépris — « Non serviam » était la devise de Joyce — mais il a peu à peu compris que tous ses rêves de rédemption politique, intellectuelle et religieuse étaient faux. Au début, nous le surprenons vivant avec deux compagnons dans la tour Martello, coupé de tout, comme Télémaque sur le point de sortir et de créer son père. L’Irlande est un terrain vague, dominé par un roi anglais et un pape italien. Même son langage est à la fois propre et étrange. La rencontre avec Bloom apprendra à Stephen que le véritable voyage spirituel consiste à abandonner les sécurités illusoires de l’ego et de l’identité pour embrasser l’absence de racines de l’existence. Dedalus semble suivre la maxime de Hugues de Saint-Victor selon laquelle l’homme pour qui la patrie est la plus douce est encore un débutant ; celui qui voit chaque sol comme celui de sa terre natale est déjà plus fort, mais seul est parfait celui qui ose voir le monde entier comme un exilé. C’est en effet sa mission de « forger dans la forge de son âme la conscience incréée de sa race ».
Deux mille ans plus tard, le titre d’Ulysse ne pourrait être plus ironique.
andreu jaume
Dans cette variante de Telemachia, Joyce invoque également le spectre de Shakespeare, son ancêtre dans la maîtrise virtuose de la langue anglaise. À cet égard, Ulysse est une méditation puissante et satirique sur Hamlet et le mythe de la paternité. Le prince du Danemark, lui aussi, fuit la roue du pouvoir et du sacrifice à laquelle il semble destiné pour tenter d’allumer autre chose, se découvrant dans l’exil de l’âge mûr. Tout le cycle tragique de Shakespeare, en particulier de Henri IV à Hamlet et au Roi Lear, aborde ce problème, qui n’est pas résolu avant les romances tardives. Dans des pièces telles que Le Conte d’hiver et La Tempête, le tragique semble trouver une solution. La mort intolérable de Cordelia est rachetée dans l’heureuse reconnaissance de Miranda par Prospero, son père. La stérilité de la terre froide et des crânes avec laquelle Hamlet se clôt, concrétisée par la mort de l’innocente Ophélie, se transforme en une fertilité lumineuse représentée par des personnages féminins triomphants et restaurés, qu’ils s’appellent Miranda, Perdita ou Hermione. Bloom et Stephen se rencontrent à la maternité, où ils entendent le tonnerre d’une renaissance intérieure, l’accès à une autre forme de spiritualité, comme à la fin de La Terre vaine de T.S. Eliot, le poème qui clôtura l’année qui avait commencé avec Ulysse.
Joyce, comme on le sait, était un écrivain d’origine catholique, éduqué chez les Jésuites, mais son appartenance à la tradition anglo-saxonne lui a permis de jouir du privilège, refusé dans d’autres langues, de travailler avec un instrument qui avait été tempéré dans la traduction de la Bible, puis affiné par un auteur, Shakespeare, qui a porté l’imagination de la Renaissance à une conception de l’homme émancipée du christianisme. Cette influence, inexcusable pour tout écrivain de son domaine, était particulièrement problématique pour Joyce qui, comme Eliot, oscillait entre la dévotion à Shakespeare et à Dante, ce dernier étant compris comme le poète canonique de l’Europe catholique. Joyce, en outre, dans le long exil qui l’a amené à quitter l’Irlande très jeune et à vivre à Paris, Trieste et Zurich, a adopté l’italien comme une langue presque à part entière et l’a utilisé pour communiquer avec ses enfants. Il y a chez lui, comme chez Eliot, un glissement vers la vieille Europe qui lui permet d’élargir la distance avec laquelle les Irlandais, en raison de leurs propres idiosyncrasies, ont traditionnellement jugé la culture anglaise.
Sous l’influence de Dante, Ulysse peut être lu comme une descente aux enfers. En fait, de son propre aveu, Joyce voulait organiser son travail sur le modèle de la Divine Comédie. Ulysse devait être l’enfer et Finnegans Wake (1939) le purgatoire. Paradise devait être une œuvre sur l’océan, qu’il n’a jamais écrite. Mais, selon certains témoignages, Joyce voulait que ce soit une pièce courte, simple, diaphane, un retour à la clarté après la longue agonie de l’obscurité et de l’hermétisme. Dans son cas, cependant, le modèle de Dante lui sert, contrairement à Eliot, à tenter d’échapper à l’orthodoxie catholique, notamment à son idée de Dieu, que Joyce veut reformuler en termes d’immanence : Dieu est un cri dans la rue. Dieu n’est pas la scission ontologique créée par le monothéisme, mais un cri dans la rue. La fuite de la maison paternelle et la rencontre avec le principe féminin, comme cela arrive à Ulysse avec Circé ou Calypso, implique aussi une transformation spirituelle, un passage de la transcendance à l’immanence qui devait s’accomplir dans ce Paradis qu’il n’a jamais écrit mais dont on a l’intuition dans « Anna Livia Plurabelle », le dernier chapitre de la première partie de Finnegans Wake dédié à cette mère qui est aussi épouse et fleuve. Tout cela est déjà préfiguré dans la rencontre entre Stephen et Poldy Bloom, qui est l’homme ordinaire, l’homme de la rue qui apprend à son fils adoptif à voir le monde avec une humilité générative. En définitive, la grande question d’Ulysse est l’amour, non pas un grand amour ou un amour ultraterrestre, mais le sentiment le plus commun et le plus difficile, la caritas, celui qui survit, malgré la douleur et les infidélités, au sein du mariage de Bloom.
Comme nous pouvons le constater, Ulysse reste une œuvre vivante et stimulante pour le lecteur du XXIe siècle, qui s’est égaré à bien des égards. Lu aujourd’hui, le roman surprend par le nombre de symptômes que son auteur a détectés par rapport aux transformations que la société occidentale subissait alors et qui sont déjà aujourd’hui des traits dominants de notre monde. Pour commencer, Joyce, qui avait une oreille pour l’anglais comparable seulement à celle de Shakespeare, s’est rendu compte à quel point la langue était cadenassée et épuisée. Des chapitres entiers sont écrits dans l’argot des magazines féminins ou des publications masculines. Dans le monde d’Ulysse, la publicité, le journalisme et les clichés ont tout envahi. Le flâneur de Baudelaire est déjà, comme le prophétisait Benjamin, un publicitaire. Joyce démontre à quel point le langage public est dégradé et exploité, au point de devenir un instrument de tyrannie, sans doute le précédent de l’imposition actuelle du politiquement correct. La forme classique de narration a également été épuisée parce qu’il n’y a plus de langue qui s’y prête. La seule issue est la parodie, le sarcasme, la caricature, les époques stylistiques successives de la langue anglaise se disant adieu dans un dernier rire. L’éclosion finale de la parole intérieure de Molly Bloom est le seul moment où le langage semble retrouver sa pureté. Le monologue de l’épouse devient ainsi le réveil après un cauchemar de mort, de mensonges et de stérilité qui culmine dans une affirmation orgasmique, paradoxalement la fin la plus lumineuse de toute la littérature du modernisme.
Il y a chez lui, comme chez Eliot, un glissement vers la vieille Europe qui lui permet d’élargir la distance avec laquelle les Irlandais, en raison de leurs propres idiosyncrasies, ont traditionnellement jugé la culture anglaise.
Andreu jaume
Mais on trouve d’autres signes avant-coureurs de notre présent. Joyce a osé remplir le langage et la vie de ses personnages avec la physiologie des corps, alors presque inexplorée. Contrairement à la vie mentale de Stephen, Bloom incarne toutes les expériences somatiques, de la nourriture et du sexe à la défécation et aux expectorations. Thomas Mann fera quelque chose de similaire dans La Montagne magique (1924) et plus tard Céline dans tous ses romans. La prééminence actuelle du discours biologique, qui a mis fin à la métaphysique, est déjà là, annoncée et exposée avec une crudité qui nous étonne aujourd’hui et continue à nous provoquer. Il en va de même pour les signes de la mort que Joyce dissémine avec inquiétude et insistance tout au long du roman. Une nouvelle marée d’anéantissement semble s’approcher dans ces pages, comme si Joyce se faisait l’écho du carnage qui se déroulait en Europe au moment où il écrivait le roman. L’enterrement de Paddy Dignam, avec la vision de l’abattoir sur le chemin du cimetière, fonctionne en ce sens comme l’émergence d’une nouvelle forme de mort, sans rédemption ni salut possible. La même chose que la mort bestiale de la mère de Stephen. Le fils a transformé la mort de sa mère en une mort animale en refusant de prier à genoux à ses côtés, comme elle le lui avait demandé. Ce non serviam fait de lui un vaurien à la fin.
Tout au long de ce siècle, Ulysse est passé du statut d’œuvre hérétique, interdite et censurée, comme c’était le cas au début, à celui d’œuvre inscrite au canon avec une autorité indiscutable qui a fini par désactiver sa férocité jusqu’à devenir une ruine muséale inoffensive et même discréditée. Joyce a eu des épigones insupportables qui lui ont fait du tort, mais aussi des disciples intelligents et habiles qui ont su profiter de son influence sans s’y brûler, comme ce fut le cas de Samuel Beckett, qui a poussé le jeu avec langage à l’extrême opposé, de Nabokov, pour qui Ulysse a toujours été un grand modèle, ou d’Anthony Burgess, peut-être le romancier qui a su tirer le maximum du maître sans tomber dans ses pièges. Borges est allé jusqu’à dire que si nous devions sauver deux œuvres de la littérature moderne, nous devrions choisir Ulysse et Finnegans Wake, comme exemples de ce que Virginia Woolf appelait « un glorieux échec ».
Convenons qu’aujourd’hui, un siècle après sa publication, Ulysse n’a que peu, voire pas, d’influence. L’industrie académique qui se consacrait à obscurcir davantage sa signification a été remplacée par l’industrie des études culturelles, qui constitue peut-être la dernière étape de cet âge chaotique prophétisé par Giambattista Vico dans un cycle que Joyce a utilisé pour structurer Finnegans Wake et que Harold Bloom a emprunté pour composer son élégie particulière pour le canon occidental. Toutefois, alors que nous attendons l’aube d’une nouvelle ère démocratique, nous pouvons peut-être faire de cette fatalité une vertu. Dépouillés de leur autorité, les chefs-d’œuvre du modernisme se montrent à nouveau tels qu’ils étaient à l’origine, animés par un esprit de défi et d’insoumission, prêts à transgresser les nouvelles limites que notre société actuelle, peut-être sans en avoir conscience, a fini par s’imposer à elle-même.