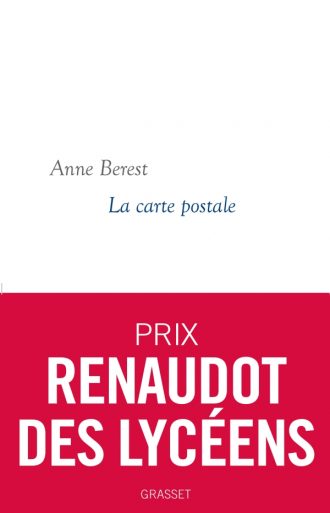« La vertu de l’œuvre d’art est d’être une porte d’entrée vers la découverte des témoignages et des travaux des historiens », une conversation avec Anne Berest
Entre l'exactitude historique et la fiction, entre l'enquête policière et la quête d'une identité, La carte postale est un roman initiatique qui retrace la recherche d'une identité. Nous avons rencontré Anne Berest pour parler de ses références, de ses sources et de la question de la légitimité de l'écrivain.
De quoi parle La carte postale ? Est-ce un livre sur la Shoah, l’histoire d’une découverte personnelle qui vous a amenée à questionner une histoire familiale, le récit d’une enquête ?
Évidemment, il y a plusieurs sujets, les plus intéressants n’étant peut-être pas les plus évidents. Il y a d’abord cette enquête au sens strict du terme, c’est-à-dire que je cherche à retrouver l’auteur d’une carte postale anonyme – et que je vais faire ma recherche à la façon d’un polar, si je me réfère à un genre littéraire.
Ensuite, et ici je fais référence à un deuxième genre littéraire, c’est la saga familiale. Je retrace sur plusieurs générations les déplacements d’une famille, ma famille, qui traverse les époques et les pays : la Russie, la Lettonie, ce qui est à l’époque la Palestine, pour arriver en France. On a ici une forme de « roman vrai », pour pasticher l’expression d’Aragon — le mentir vrai. Je pars d’une matière personnelle, existante pour en faire du roman, lui donner corps et chair à l’intérieur d’un récit.
Mais si je réfléchis aux sujets secrets qui ont traversé le livre… je dirais qu’en moi sont apparus deux thèmes. D’une part la question : « Qu’est-ce qu’être juif ? » question que je me pose, on va dire, dans la partie contemporaine du livre, que je me pose explicitement pour tenter d’y répondre. Mais qui est aussi la question que je pose dès le début du livre, quand je regarde cette famille vivre – et que j’essaie d’interroger en elle la notion de judaïsme.
Le second sujet caché est celui de la transmission invisible. Non pas de la transmission du judaïsme, mais de quelque chose de bien plus large, qui est l’influence de nos ancêtres sur notre personne, au sein d’un arbre généalogique. Ce qu’ils nous transmettent, même morts, même disparus depuis des décennies.
Voilà pour les deux sujets peut-être plus secrets ou mystérieux qui traversent le livre.
On voit émerger cette question de la transmission invisible, secrète, mystérieuse, sans que vous ne fixiez exactement la façon dont vous l’abordez. Vous soulignez des coïncidences, en disant que ce ne sont pas que des coïncidences. Est-ce parce que vous voyez plus que de simples coïncidences dans cette histoire familiale que le résultat est un « roman » ?
Je vais répondre en deux temps.
Votre question m’évoque la position du narrateur, chez Modiano, qui constitue plus qu’une simple référence, mais un héritage profond pour moi. Il écrit notamment dans Un pedigree : « Je cherchais des mystères là où il n’y en avait pas » et c’est peut-être une des définitions du roman. En effet, ces signes, ces coïncidences, ces hasards, permettent au romancier de faire des liens, et peut-être que ces liens sont un des outils du romanesque.
C’est une première chose.
Une deuxième façon de vous répondre est que – ce qui nous rapproche des sciences humaines davantage que du roman – je me suis beaucoup intéressée à la psychogénéalogie, et en particulier aux écrits de Jodorowsky. Avec celle qui était à l’époque sa femme, qui est aussi thérapeute, j’ai fait une thérapie par la lecture de l’arbre généalogique. C’était il y a quinze ans, quelque chose comme ça – et cela m’avait passionnée. Je ne sais pas si j’ai été « guérie » pendant cette séance, mais passionnée oui. Le thérapeute découvre votre arbre généalogique et essaie, à la lecture des prénoms, des dates de naissances, des dates de mort, des dates de mariage, en gros, tous les grands événements d’une vie, d’y voir des comportements qui se répètent, des cycles de vie, des transmissions de catastrophes – on vient au monde chargé de ses ancêtres.
Je retrace sur plusieurs générations les déplacements d’une famille, ma famille, qui traverse les époques et les pays : la Russie, la Lettonie, ce qui est à l’époque la Palestine, pour arriver en France.
ANNE BEREST
Dans la lignée de cette question de psychogénéalogie, des chercheurs travaillent depuis un certain nombre d’années, en épigénétique, sur la question de la mémoire cellulaire. Là encore, qu’importe pour moi de savoir si c’est vrai ou si c’est faux, je ne suis ni psychiatre, ni psychanalyste, ni scientifique ; ce qui compte pour moi, est la porte que ce champ d’investigation ouvre dans mon imagination, comment cela va me permettre de développer une intrigue littéraire. Une des thèses liées à ces recherches soutenait que nous avons une mémoire émotionnelle des émotions. Sur trois générations, des choses que nous vivons résonnent particulièrement en nous, vont vibrer à la faveur, à la lueur de cette mémoire cellulaire.
Cette question traverse le livre.
Je n’ai pas connu ma famille – parce qu’ils ont été assassinés pendant la guerre, mais aussi parce que je n’ai appris que très tardivement leur histoire – mais je suis frappée par les coïncidences : familiarité de caractère, de vocation, familiarité de lieux géographiques, avec ces gens-là. En écrivant ce livre, je me suis rendue compte que j’habitais dans la même rue que mon grand-oncle, que j’avais voulu faire mes études dans un lycée où ma grand-mère et sa sœur s’avèrent elles-même avoir été élèves.
Donc cette idée de la transmission invisible est un des sujets secrets, mais importants, du livre.
Cette réponse nous amène à la question suivante : est-ce que vous pourriez me donner un aperçu plus général des recherches à la fois personnelles et historiques, ontologiques que vous avez faites pour écrire ce livre ?
En fait, ce livre doit presque tout à ma mère qui, au début des années 2000, décide de présenter son dossier auprès de la commission Mattéoli.
La commission Mattéoli a eu pour objet le dédommagement des familles suite à la spoliation des biens juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
Lorsqu’elle a engagé cette démarche, ma mère s’est rendue compte qu’elle n’avait aucun papier qui attestait ses liens avec ses grands-parents. Et qu’elle savait à peine comment ils s’appelaient ! Elle se lance donc dans des recherches – elle a la chance d’être une chercheuse de métier – qui vont durer plusieurs années.
En 20 ans, elle a pu reconstituer, à travers toutes les archives de France, de Russie, de Yad Vashem en Israël… la saga familiale.
Ça, c’est pour moi un premier outil de narration. Vient ensuite la question de la recherche historique générale : pour écrire, je dois me renseigner, apprendre, affiner mes connaissances. Commence en moi une sorte de boulimie de lecture (comme lorsque j’ai écrit mon précédent livre sur l’histoire de l’art avec ma sœur, Gabriële, ou comme lorsque j’ai écrit sur l’année 54, dans Sagan 54.) Je ne suis pas historienne, mais j’aime cette plongée dans l’Histoire et j’aime l’idée de transmettre au lecteur des choses que je découvre et que j’apprends pour mon livre.
Quelles références en particulier avez-vous mobilisées ?
Ma bibliographie n’est ni exhaustive, ni systématique. Un livre m’emmène à l’autre, sans véritable méthodologie.
Je vais vous donner un exemple : quand j’écris les scènes où Myriam (ma grand-mère) rentre dans Paris après une nuit blanche après avoir échappé à une arrestation, il va falloir que je raconte ce Paris vide. Je vais alors trouver un ouvrage improbable, quasiment édité à compte d’auteur, sur l’histoire du vélo dans les années 40, et grâce à cet ouvrage quasi confidentiel, j’apprends comment étaient fabriquées les pneus de vélo à cette époque, comment les Parisiens, sous l’Occupation, prenaient soin de leur vélo ; les choses qu’ils avaient le droit ou non de faire – pas le droit d’avoir les mains dans les poches, pas le droit de poser le pied à terre sur leur vélo… Tous ces détails là, que je ne vais pas trouver dans des ouvrages d’Histoire un peu généraux, mais que je vais les trouver grâce à des auteurs très spécialisés dans un domaine. Ces thèses improbables sont pour moi des pépites romanesques.
Je ne suis pas historienne, mais j’aime cette plongée dans l’Histoire et j’aime l’idée de transmettre au lecteur des choses que je découvre et que j’apprends pour mon livre.
ANNE BEREST
À côté de cela, je me plonge évidemment dans des ouvrages de référence sur la période. Mais, si vous voulez, je travaille avec un spectre très large dans lequel ce qui compte, pour moi, est d’être évidemment « juste », d’un point de vue historique, de ne pas faire d’erreur, mais aussi d’aller trouver des points de détails de la vie quotidienne, que je vais trouver dans des romans de l’époque ou dans des témoignages.
S’ajoute toute la littérature de témoignage, parfois éditée à compte d’auteur. Je pense à l’extraordinaire travail de Serge Klarsfeld, dans sa collection « Témoignages de la Shoah » qu’il a créée grâce à la Fondation pour la mémoire pour la Shoah. Ce sont des témoignages « bruts ». Ces témoignages-là sont des pierres posées pour l’Histoire – et pour moi, en tant qu’écrivaines, des repères, des outils de narration très importants.
Trois passages, dans l’élaboration de mon livre, ont particulièrement été difficiles à raconter : l’internement à Pithiviers, l’extermination à Auschwitz et le retour des déportés au Lutetia. Parce que je ne voulais rien « inventer », je voulais que chaque phrase que j’écrive, même si je l’écrivais dans mon style, fasse référence à quelque chose que j’avais lu quelque part, dans un ouvrage de témoin ou un ouvrage historique.
Ces trois moments historiques, qui correspondent à quelques pages seulement dans mon livre, m’ont demandé des mois et des mois de travail. Entre les lectures, les recherches et l’écriture. J’ai demandé ensuite que mon livre soit entièrement relu par Laurent Joly, l’historien qui aujourd’hui est une des références sur la question de l’antisémitisme et de Vichy. J’ai eu dernièrement la chance d’être reçue par Serge Klarsfeld, qui m’avait écrit après avoir lu La Carte Postale. Son jugement bienveillant m’a fait me sentir protégée… lui et sa femme sont des êtres extraordinaires.
Et du point de vue des références littéraires ?
Il y a Daniel Mendelsohn (Les Disparus) évidemment, qui a beaucoup compté pour moi. Irène Némirovsky également, que je cite dans le livre. Et toute la littérature concentrationnaire. À l’époque où j’ai écrit les livres, l’ouvrage collectif de La Pléiade n’était pas sorti, mais j’en connaissais les principaux ouvrages. Je vous en conseille la lecture : Collectif, L’Espèce humaine et autres écrits des camps. Mais si je mets bout à bout tous les livres, romans, récits, témoignages, livres d’histoires, documentaires, films… Mon livre en lui-même engouffre peut-être 200 ou 300 références d’autres ouvrages.
Comment écrit-on à la troisième génération ?
Après guerre, lorsque la population découvre l’existence des camps de concentration ; c’est une stupeur. Françoise Sagan se rappelait très bien du premier jour où elle a vu les images de camps, elle est petite, elle en parle dans un de ses livres. Modiano aussi en parle, il se souvient très bien du jour où il voit, dans un cinéma, avec son père, les images des camps de concentration. Il écrit : « Quelque chose a changé pour moi, ce jour-là. »
Mais en France, après cette stupeur, s’est installé un long silence, que j’explique en partie dans mon livre. C’est le silence des bourreaux et le silence des victimes ; le silence des Justes et des « injustes »… pendant longtemps, les gens n’ont plus parlé. Mais heureusement, peu à peu arrive la littérature du témoignage, qui réussit à percer. Et donc pendant toute une période, il y a eu ce moment de l’Histoire où seuls les témoins ont le droit de parler. Parce que ce qui s’était passé était de l’ordre de l’impensable, et donc il ne fallait pas, on ne pouvait pas écrire de la fiction, on ne pouvait pas inventer – disons que cela n’était pas permis à celui qui n’avait pas été témoin. Car il fallait recueillir et inciter la parole de ceux qui avaient vécu les camps, qui s’étaient tus ou qu’on n’avait pas écoutés.
C’est la première génération, qu’accompagne la pensée de Jankélévitch, celle de Lanzmann, avec cette idée que seuls les témoins peuvent parler. Si bien que la deuxième génération qui vient après, qui correspond à la génération de ma mère, Lélia, est un peu dans l’ombre de cette parole-là. Elle n’est pas véritablement autorisée à parler. Puisque les témoins sont encore vivants, c’est eux qu’il faut entendre ; c’est eux qu’il faut écouter – et non pas leurs enfants.
Je travaille avec un spectre très large dans lequel ce qui compte, pour moi, est d’être évidemment « juste », d’un point de vue historique, mais aussi d’aller trouver des points de détails de la vie quotidienne.
ANNE BEREST
Mais le temps passe, et peu à peu ces témoins disparaissent. Ce ne sont pas leurs témoignages qui disparaissent, mais eux, la façon dont ils portent dans les classes, dans les médias, dans les journaux, cette parole-là. Quand j’ai commencé La carte postale, est survenu la mort de Simone Veil ; puis il y a eu Marceline Loridan-Ivens – la disparition de Claude Lanzmann, qui n’était pas un témoin mais qui a accompagné les témoins. Et je me rendais compte en écrivant que, peu à peu, les témoins disparaissaient.
Et les questions que je me posais, sur le statut d’une « littérature » concentrationnaire, tournaient dans ma tête. J’en suis arrivée à la conclusion que ces problématiques avaient changé, et qu’il était nécessaire que nous nous autorisions, notre génération, à faire entrer la littérature dans des endroits où jusque-là, au fond, il était problématique de la faire entrer quand on n’avait pas été un témoin. Oser écrire de la littérature sur les camps – dans mon cas le camp de Pithiviers et le camp d’Auschwitz. (Je ne suis pas la première, je pense évidemment à Vassili Grossman dans Vie et Destin, ou, si vous me permettez une référence cinématographique, Le fils de Saul, de Laszlo Nemes.)
Il faut que d’autres formes d’écritures naissent, parce qu’il faut que les écrivains aillent dans les classes, les librairies, les rencontres – ou plus personne ne prendra le flambeau d’œuvres qu’il faut sans cesse continuer à faire vivre. C’est à peu près à ce moment-là que j’ai découvert un entretien d’Elie Wiesel, comme un signe, qui dit : « Le roman peut aider la mémoire, il peut aider à entretenir la flamme. » A condition que l’écrivain ait une grande rigueur historique, il en va de sa responsabilité. De même que Jorge Semprun a écrit :« sans la fiction, le souvenir périt. »
Voilà comment je me suis, petit à petit, autorisée à écrire sur le sujet. Aujourd’hui j’accompagne mon livre dans les lycées (Anne Berest vient de remporter le Renaudot des Lycéens, ndlr) – j’ai rencontré des centaines d’adolescents. J’aime faire ce travail-là.
Moi j’appartiens à une génération où tout le monde a vu La liste de Schindler à l’école. Évidemment, on peut questionner l’œuvre de Spielberg, mais en tout cas c’était, pour toute une génération de jeunes gens, une initiation à un récit, qui par l’émotion, la personnification, l’identification aux personnages, (les fonctions de l’oeuvre d’art) permettaient à la jeunesse que nous étions, d’avoir des images et une approche « émotive », qui nous rendaient davantage sensibles aux cours d’Histoire.
On peut aussi penser à Au revoir les enfants de Louis Malle, qui passait à la télévision régulièrement, dans une société où tout le monde regardait la télévision.
Les œuvres – de cinéma, de littérature, de spectacle vivant – doivent continuer à attraper les gens par le biais du cœur et de l’émotion, pour les nouvelles générations. La vertu de l’œuvre d’art est d’être une porte d’entrée vers la découverte des témoignages et des travaux des historiens.
Le sous-titre du livre indique justement que La Carte postale est un « roman ». Quelle est la place, assumée ou non, de la fiction dans ce texte, et pourquoi avoir revendiqué ce terme de roman ?
J’en reviens à la notion de « roman vrai » que j’ai déjà avancée. Quand je raconte les étapes de l’enquête que j’ai menée avec ma mère, tout ce que je raconte est « vrai » – les événements si vous voulez. Mais parfois, pour le récit romanesque, je suis obligée d’adapter.
Je vous donne des exemples.
Je suis vraiment allée chez Duluc, j’ai vraiment rencontré un détective privé – et la conversation que nous avons eue ressemble à celle que j’ai écrite dans le roman.
Dans la « vraie vie », j’ai fait ce rendez-vous avec ma mère. Mais dans le roman, pour des raisons de récit, j’y vais toute seule. Il y a donc déjà un certain décalage.
Prenons d’autres exemples.
L’enquête, telle que je la raconte dans le livre, se déroule sur 3-4 mois. Dans la vie, elle s’est déroulée sur 4 ans ! En la relatant intégralement, j’aurais craint de m’enliser, de rendre le récit difficile à lire. Je choisis par moment de condenser les événements. De les rendre fluides, avec des enchaînements rapides. Dans le livre, ma mère et moi retournons au village où notre famille a été arrêtée. Pour des raisons d’intensité dramatique, toutes les péripéties se déroulent en une matinée. Les unes après les autres. Je vais chez tel voisin, qui me conduit à interroger tel autre, qui me donne l’idée d’aller sonner chez tel autre. Or, dans la vraie vie, ces rendez-vous se sont étalés sur des mois et des mois d’enquête. Il y a même un des rendez-vous, lorsque ma mère retrouve la fille de la femme de ménage des Rabinovitch, qui s’est passé il y a quinze ans ! Ma mère avait fait cette rencontre. Bien avant que j’écrive le livre. Mais, je l’ai intégré au récit.
J’utilise donc mon savoir-faire et mes techniques de romancière pour condenser les éléments et les « monter », pour reprendre une expression propre au cinéma. C’est donc là que s’introduit du romanesque, dans la technique narrative qui organise des faits vrais.
C’est la première chose.
J’utilise mon savoir-faire et mes techniques de romancière pour condenser les éléments et les « monter ».
ANNE BEREST
Deuxième chose, ce n’est pas un récit dans la mesure où j’avais pris une décision qui était de nommer, de leur vrai nom, tous ceux qui avaient aidé ma famille, et de changer le nom de tous ceux qui avaient participé à leur déportation. Comme le maire de l’époque, qui envoyait des lettres à la préfecture pour demander qu’on se dépêche de déporter la famille Rabinovitch. Les lettres que je reproduis dans le livre sont exactement, mot pour mot, celles qui ont été écrites par ce maire, mais j’ai choisi de lui donner un faux nom, parce que j’ai trouvé que ce n’était pas mon rôle de romancière d’être dans un règlement de comptes , de dénonciation de ceux qui se sont mal comportés.
C’est parce que j’écris un roman que je peux m’autoriser ces licences avec le réel.
Vous dites vous être autorisée à écrire sur un tel sujet. Est-ce que vous vous seriez permis d’écrire ce livre s’il ne s’agissait pas de votre propre famille ?
C’est une question très intéressante, parce qu’on est prisonnier de la question de la légitimité, la question de l’endroit d’où on écrit. Je suis absolument contre cet enfermement, contre l’idée qu’on n’a pas le droit d’écrire sur tel ou tel sujet. Toute forme de censure va contre l’idée même de démarche artistique. Ceci étant dit, je vois bien, évidemment, que j’ai une légitimité à écrire sur la Seconde Guerre mondiale, puisque je suis moi-même enfant et petit-enfant de survivant. Le fait que je sois juive, que ce soit mon histoire, rend la réception du livre peut-être plus évidente. Mais d’un point de vue idéologique, je veux défendre l’idée que d’autres ont le droit, doivent écrire sur ce sujet, sans être reliés dans leur histoire personnelle, familiale, à cette question.
Avec cette limite, sans sortir complètement de l’archive, inventer l’histoire de la famille Rabinovitch, c’est presque difficile étant donné que la réalité est plus puissante que l’imagination dans leur cas.
C’est vrai. Vous avez entièrement raison. Mais tout romancier aurait droit d’inventer l’histoire d’une famille – qui serait une famille juive – pendant la guerre. Même s’il n’est pas juif, même s’il n’est pas enfant de survivants. En revanche, ce droit lui donne des devoirs : le devoir de justesse historique.
C’est aussi un livre qui raconte l’itinéraire d’une personne, vous le dites vous-même, élevée avec une éducation laïque qui aussi cherche à comprendre ce que le mot juif veut dire pour elle-même. Est-ce qu’au terme de cette enquête, vous y avez mieux répondu ? Pensez-vous que cela est aussi un mouvement qui habite aussi d’autres personnes de cette génération, un retour identitaire ou religieux ?
J’en retourne encore une fois au mot roman : mon personnage, dans le livre, a une forme de révélation et vit une sorte de roman initiatique. La narratrice découvre une culture et un monde qu’elle ne connaissait pas, celui du judaïsme. J’accentue beaucoup, ou disons que j’exagère, la naïveté de la narratrice. Elle part d’une méconnaissance totale de la culture juive. Elle n’y connait rien. J’ai tenu à cette ignorance, tout d’abord parce qu’il existe dans la pensée juive la figure de l’ignorant – qui est toujours une figure importante. Celui qui ignore est celui qui pose des questions. Or, c’est très important, de poser des questions. Dans la culture juive, il est aussi important de bien savoir poser les questions que de savoir y répondre ! J’exagère ce personnage candide, au sens voltairien, qui va ouvrir de grands yeux sur une culture dans laquelle il entre.
Et je me rends compte que l’une des raisons du bel accueil du livre vient aussi de cette ignorance de mon personnage. Pour des gens qui connaissent peu la culture juive, ou pour qui elle est mystérieuse, ce livre est comme une porte d’entrée. J’ai cherché, en exagérant ma naïveté, à ouvrir le livre à des lecteurs, sans qu’ils se sentent non-sachants, ignorants ou exclus.
Je veux défendre l’idée que d’autres ont le droit, doivent écrire sur ce sujet, sans être reliés dans leur histoire personnelle, familiale, à cette question.
ANNE BEREST
Oui, c’est véritablement ce qu’on appelle un roman initiatique, puisque mon personnage va découvrir un nouveau monde, à travers des rites importants. Je pense à ces deux dîners de Pessa’h qui ponctuent le roman, l’un en 1919 et l’autre en 2019. C’est une quête initiatique. Mais mon personnage ne vit pas pour autant un retour au religieux – je ne suis pas croyante ni pratiquante – il s’interroge sur ce que signifie être juif, dans mon cas, moi qui n’ai eu aucun enseignement, aucune tradition… mais à qui on a parlé très tôt des camps de concentration. Ce qu’on appelle parfois les « Juifs de la Shoah », ceux qui n’ont comme lien avec le judaïsme que l’héritage de l’histoire des camps, parce leurs ancêtres ont été décimés et que les traditions culturelles ont disparu avec eux. De là vont dérouler des rêves, des traumatismes, des angoisses, des névroses, des cauchemars, qui sont particuliers à cette histoire, à ces familles. Dans La Carte postale, je vais découvrir tout cela, que je suis ce que l’on appelle un enfant, un petit-enfant de survivant. Et que c’est une culture en soi. La définition que j’en donne alors est nécessairement liée à un moment donné de ma vie, peut-être que dans dix ans, si je m’efforçais encore une fois d’essayer de répondre à cette question, j’y apporterai une réponse tout à fait différente !
Dans ce parcours initiatique, cette quête, je propose aussi cette définition du judaïsme, qui ressemble presque à une blague juive : « Qu’est-ce qu’être juif ? C’est passer sa vie à se demander : qu’est-ce qu’être juif ? » C’est une définition de « l’être juif » qui passe par le questionnement. La question, je l’ai déjà dit, étant un des fondamentaux de la pensée juive