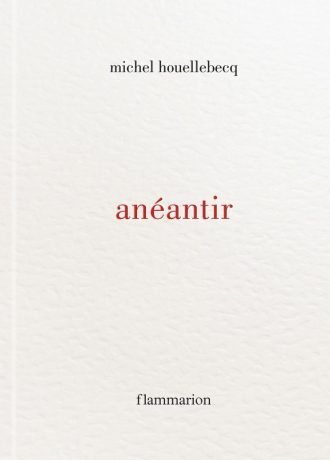Anéantir : une lecture
Comment lire Houellebecq ? Dans ce texte très personnel, l'helléniste et auteure de La Langue géniale, Andrea Marcolongo, s'ouvre sur sa passion pour les ouvrages du romancier en décrivant son entrée dans le dernier d'entre eux : Anéantir.
Peu de choses, dans la vie, m’ont rendue plus malheureusement heureuse d’être déprimée que les livres de Houellebecq. Je ne saurais me définir seulement comme une « fan » : le plaisir que je ressens à m’avilir entre ses pages est si illimité et si pervers qu’il frise l’idolâtrie. En tant que femme, je peux le dire avec une certaine fierté, presque comme s’il s’agissait d’un honneur : être sortie vivante de la lecture de ses romans sans céder à la tentation du suicide est un exploit qui ne va pas de soi et dont je suis effectivement fière. Et pourtant, j’ai commencé à lire l’auteur de La possibilité d’une île – mon roman préféré – relativement tard, il y a moins de deux ans. Je ne pense pas pour autant qu’il s’agisse d’un retard : je crois qu’avoir dépassé l’âge du Christ est une condition préalable à la lecture de Houellebecq, un auteur aussi négligeable quand on est dans la fleur de l’âge qu’il est nécessaire quand on commence à vieillir et, comme tout le monde, à craindre la mort.
Afin de me préparer à la sortie d’Anéantir avec un regard plus sincère, j’ai écouté ces derniers jours le podcast en trois épisodes proposé par France Inter, qui retrace les critiques de tous les romans de Houellebecq diffusées au fil des ans par l’émission Le masque et la plume. Au milieu de positions extrêmes, polaires, d’amour ou de haine – et en ce sens je me sens plus proche que jamais de l’engouement de Frédéric Beigbeder –, force est pourtant de constater que les romans de Michel Houellebecq sont peut-être les seuls à avoir une dimension européenne, non seulement par leur ambition d’être totaux, un peu comme La Montagne magique de Thomas Mann, mais aussi par l’attente qu’ils suscitent chez des lecteurs de tout le continent. Anéantir a été publié simultanément en Italie le 7 janvier par La Nave di Teseo, et on ne trouve pas un seul journal européen qui n’en ait parlé – Michel Houellebecq est devenu pour moi à l’étranger un objet de discussion franche, comme la cuisine italienne peut l’être, puisque je peux interroger pratiquement n’importe qui dans tous les coins d’Europe à son sujet.
J’ai donc vécu l’attente de la publication d’Anéantir comme une passion sévillane, avec des rituels qui n’engagent que moi et des conversations, des interrogations sans fin avec mon entourage. Le 7 janvier, j’ai même été choquée lorsqu’on m’a demandé en librairie si je cherchais « quelque chose de spécial » : que voudrait un lecteur le jour de la sortie du nouveau roman de Houellebecq ?
Il faut dire qu’en tant que livre-produit, je m’attendais à ce qu’Anéantir soit plus beau, au moins pour les publicités qui l’ont précédé et pour son prix (26 euros) : une couverture rigide d’un blanc – beaucoup trop – laiteux, sans aucune illustration, juste le nom de l’auteur en noir et le titre en rouge, comme pour signaler que ce qui donne un sens à l’argent dépensé est tout entier contenu à l’intérieur. Et le premier paragraphe qui ouvre le livre est en effet plus sophistiqué et tranchant que jamais : ce « la proximité du néant est inhabituelle » me rassure et m’envoûte comme le premier verre de vin d’une série de plusieurs bouteilles. Houellebecq est revenu pour nous dépouiller de nos névroses, voire pour nous écorcher vif : mieux vaut prendre ses aises pour mieux se scandaliser.
J’ai vécu l’attente de la publication d’Anéantir comme une passion sévillane, avec des rituels qui n’engagent que moi et des conversations, des interrogations sans fin avec mon entourage.
Andrea marcolongo
Le thème central d’Anéantir me tient particulièrement à cœur, ayant récemment perdu mon père : nous sommes dans un futur proche, en 2027, et Paul Raison, haut fonctionnaire au cabinet du ministre de l’Économie Bruno Juge (référence directe à l’actuel ministre Bruno Le Maire), a désormais atteint « une sorte de désespoir standardisé ».
Depuis plus de dix ans, sans aucun contact physique ou émotionnel avec sa femme Prudence tout en continuant à vivre sous le même toit qu’elle, Paul enquête sur une fausse vidéo où l’on voit son ministre se faire brutalement guillotiner. Et tandis que d’autres attentats encore plus inquiétants, réels mais non revendiqués, frappent la France, son père, qui a également été chargé de la sécurité de l’État au ministère en son temps et qui est aujourd’hui un homme de 76 ans peu enclin à l’hygiène de vie dont les médias nous matraquent, est victime d’un AVC qui le laisse dans le coma. Il s’agit donc d’un voyage à genoux sur le chemin de la fin de vie, aussi sombre qu’une salle d’hôpital qui, malgré tous les efforts pour être architecturalement acceptable, reste un lieu fait pour mourir, qui attend Paul – au milieu de la campagne présidentielle, encore plus folle qu’une embolie.
Dans Anéantir, on trouve une métaphore grâce à laquelle Houellebecq résume le scandale suprême de la mort : à bord d’un luxueux mini-van parcourant les routes isolées de l’Ouest américain, un homme au visage satanique s’amuse à jeter par la fenêtre une personne au hasard parmi les passagers âgés qui, malgré leur terreur et leur désarroi, n’osent pas se rebeller. Cet homme est Dieu et l’irrationalité absolue avec laquelle il choisit de mettre fin à l’existence des voyageurs impuissants est la synthèse de la mesquinerie et de la mort. Il y a en effet – et heureusement – beaucoup de religion dans Anéantir, du yoga et de la méditation de la femme de Paul au christianisme inébranlable de sa sœur Cécile, qui, depuis qu’elle est enfant, a toujours répondu « je demande à Dieu » face à un problème aussi clairement banal que le fait de récupérer une chemise au pressing.
Bien sûr, on trouve aussi beaucoup de politique, puisqu’une campagne électorale est en jeu. Mais on ne voit pas de grandes idéologies ou du moins de remèdes au populisme ambiant, dans une société où il n’y a plus que des riches et des pauvres, sans trace de classe moyenne. Curieusement, il y a un peu moins de sexe que d’habitude, les désirs des personnages restant presque toujours frustrés (bien que les premières prostituées apparaissent dès la cinquantième page), et un peu plus d’amour, ou du moins un grand besoin d’amour comme seul espoir de sens – « coucher seul est difficile lorsqu’on en a perdu l’habitude, on a froid et on a peur ».
Comme toujours – et c’est la raison suprême pour laquelle j’aime tant Houellebecq – la sociologie occupe une grande part du roman, Houellebecq faisant un constat impitoyable de notre mode de vie contemporain et d’un écologisme idiot bon seulement à remplir les consciences d’hypocrisie et certains jardins parisiens de plantations partagées, entre un féminisme de façade qui cache parfois des perversions sexuelles et une infantilisation plus générale du langage public qui nous réduit désormais au rang de nourrissons perdus en attendant le prochain ordre de nos parents-État – à l’heure où j’écris ces lignes, à bord du TGV qui me ramène de Nantes à Paris, le contrôleur éprouve le besoin d’expliquer aux passagers quels sont les en-cas autorisés à bord dans ce contexte de crise sanitaire – les fruits oui, les chips non – et je me demande alors si lui aussi ne sort pas tout droit d’un roman de Houellebecq.
Enfin, ce qui me reste après avoir lu Anéantir, c’est un profond sentiment de honte. Non seulement de tant aimer son auteur – il y a longtemps que j’ai dépassé mon complexe de la lecture à la mode – mais surtout de devoir reconnaître, comme toujours, qu’il a raison : les personnes dont il parle dans Anéantir sont mes amis, mes collègues, mes amants, c’est moi-même. Heureusement, de l’extérieur, cela ne se voit pas. Personne ne le saura jamais, et je continuerai, hypocrite comme tout le monde, à prétendre être meilleure que les personnages décrits par Michel Houellebecq.