Le choix de la suprématie mondiale : du non-interventionnisme aux guerres sans fin, une conversation avec Stephen Wertheim
Dans son livre Tomorrow the World, publié en 2020, il étudie le débat sur la politique étrangère et sur le rôle des États-Unis dans l'ordre mondial au cours de la seconde guerre mondiale. Nous lui avons demandé comment cette nouvelle vision du rôle des États-Unis, en tant que garant de « la paix par la force » influence la scène internationale contemporaine, en tournant notre attention vers les « guerres sans fin », le retrait d'Afghanistan et la compétition avec la Chine.
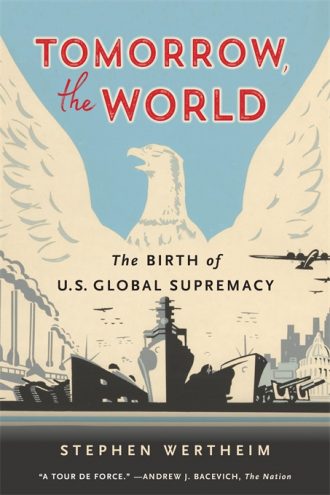
Votre livre, Tomorrow the World, porte sur l’émergence chez les élites et le public américain, entre 1940 et 1945, de la volonté de s’assurer la suprématie mondiale à l’issue du conflit. C’est une rupture avec les idées dominantes jusqu’alors.
Cela peut sembler difficile à imaginer aujourd’hui, étant donné la façon dont les États-Unis se sont comportés de notre vivant, mais la suprématie mondiale n’a pas toujours constitué un objectif de la politique étrangère américaine. Pendant la majeure partie de l’histoire des États-Unis, il est même très difficile d’identifier des dirigeants soutenant la poursuite d’un objectif de domination militaire incontestée et mondiale, même en tant que simple aspiration pour le futur. Au contraire, les fondateurs ont mis en garde les États-Unis contre la conclusion d’alliances permanentes ou susceptibles de les impliquer dans les affaires d’autres pays, en particulier sur les continents européen et asiatique. Et pendant la majeure partie de leur histoire, les États-Unis ont agi en conséquence.
Les États-Unis n’étaient pas pour autant un pays pacifiste. Ils ont constamment étendu leur pouvoir, et cela de manière profondément violente. En premier lieu, nous ne devons pas oublier la conquête à travers l’Amérique du Nord, la colonisation de peuplement qui l’a accompagnée, avec une spécificité américaine : l’incorporation des États dans l’union fédérale. Au tournant des 19ème et 20ème siècles, les États-Unis ont saisi des colonies, dont Porto Rico et les Philippines. À ce moment-là, les États-Unis avaient déjà acquis le statut de grande puissance et ils étaient en mesure de dominer l’hémisphère occidental tout en assurant ce que le président Theodore Roosevelt appelait la « police internationale » dans le grand bassin des Caraïbes. Pour autant, ils respectaient toujours le conseil de leurs fondateurs consistant à éviter les engagements militaires dans la masse continentale de l’Eurasie. Les Etats-Unis ne tentaient pas de devenir la puissance militaire dominante, à l’instar de ce que nous connaissons aujourd’hui, avec un réseau d’alliances et des déploiements permanents dans toutes les régions d’importance géostratégique.
Si la tradition américaine consistait donc à éviter les engagements militaires en dehors de l’hémisphère occidental, quels événements ont pu mener à un changement aussi radical après 1945 ?
C’est la chute de la France face à l’Allemagne nazie au milieu des années 1940 qui constitue l’événement déclencheur. Avant cela, il était pratiquement inconcevable pour les responsables américains que les États-Unis entrent en guerre, sans même parler de projeter leur puissance militaire en Europe ou en Asie en période de paix.
La chute de la France a changé leurs calculs car elle a démontré que les puissances de l’Axe pouvaient parvenir à la maîtrise de l’Europe à force de conquêtes, tandis que le Japon imposait sa domination en Asie de l’Est. Tandis que pour les pays européens et asiatiques, les avancées de l’Axe constituaient une menace immédiate pour leur survie, l’Amérique du Nord n’était menacée d’aucune sorte d’invasion imminente. Néanmoins, la grande majorité des élites politiques et intellectuelles américaines considéraient que leur pays devait arrêter les puissances de l’Axe et les futurs aspirants à la domination en Eurasie. Car l’existence d’un pouvoir totalitaire en Europe et en Asie viendrait interdire la réalisation par les États-Unis de leur aspiration traditionnelle à réaliser autant d’interactions pacifiques que possible à travers le monde. En d’autres termes, cela menacerait un ordre mondial libéral. De plus, une telle situation nierait l’aspiration américaine à conduire le monde progressivement, au fil du temps, vers son propre modèle politique. Cela viendrait contredire l’identité de l’Amérique en tant que nation exceptionnelle.
La chute de la France face à l’Allemagne nazie au milieu des années 1940 constitue l’événement déclencheur.
Stephen wertheim
Dans le livre, je retrace cette évolution radicale au sein des travaux du Council on Foreign Relations. Ce think tank avait créé en 1940, au nom du département d’État alors à court de personnel, un groupe de planification de l’après-guerre. Juste après la chute de la France, ce groupe prévoyait que les États-Unis ne devraient défendre que leur hémisphère, et peut-être même juste un « quart de sphère »1. Les membres du groupe pensaient que les États-Unis pourraient rester en sécurité et prospères dans un tel périmètre de défense. Mais au fur et à mesure que les mois passèrent et que la Grande-Bretagne résistait à l’assaut nazi, leurs ambitions grandirent. Bientôt, les planificateurs proposèrent la vision d’une domination militaire illimitée sur l’ensemble du monde non allemand (la position de l’Union soviétique restant ambiguë). En 1941, Henry Luce, l’éditeur du magazine Life, a déclaré le début du « siècle américain », alors que les membres de l’administration de Franklin D. Roosevelt commencèrent à réfléchir à sa mise en pratique.
Comment ce changement radical de perspective sur la politique étrangère américaine a-t-il pu être accepté par l’opinion américaine ?
Il est difficile de dire dans quelle mesure le public a pleinement compris, et donc accepté ou résisté, l’idée que les États-Unis devraient projeter leur puissance militaire à l’échelle mondiale et cela sans limite temporelle. Cependant, les élites craignaient beaucoup, et non sans raison, que le public américain refuse une telle rupture historique avec la tradition américaine de non implication dans les affaires de l’Eurasie. Ils avaient bien conscience que le mondialisme politico-militaire amènerait les États-Unis à occuper un rôle en contradiction avec les sentiments populaires, en particulier les idéaux internationalistes qui espéraient transcender la politique de puissance, pas la dominer. Dans l’Entre-deux-guerres, les citoyens ordinaires et les élites jugeaient que la Première Guerre mondiale avait démontré la nature destructrice et inutile de la guerre. Les États-Unis devaient donc promouvoir la compréhension mutuelle entre les peuples et non pas entrer dans une autre guerre européenne. C’est également à cette période que les États-Unis ont conclu le pacte Briand-Kellog, qui « interdit » la guerre, tout en soutenant de nombreuses activités de la Société des Nations, sans y avoir toutefois adhéré. Les élites américaines avaient donc bien conscience qu’elles rompaient avec leurs propres idéaux et objectifs antérieurs en emmenant les États-Unis sur la voie coûteuse et incertaine de la domination mondiale.
Ce qu’ils ont donc fait, c’est de refaçonner la façon dont l’Amérique comprenait son rôle dans le monde. Ils ont forgé un nouveau concept, « l’isolationnisme », pour décrire ce que les États-Unis se devaient d’éviter. En qualifiant à tort les partisans de la défense de l’hémisphère occidental d’« isolationnistes », ils ont réussi à imposer l’idée que si les États-Unis ne recourent pas à la force à l’échelle mondiale, ils sont inactifs et isolés. Plus important encore, le concept d’isolationnisme a remodelé son antonyme, « l’internationalisme » qui en est venu à signifier le devoir de projeter la puissance américaine à l’échelle mondiale, tout en conservant ses anciennes connotations de coopération, d’harmonie et de paix. Pour donner une incarnation à cette nouvelle conception de l’internationalisme, les responsables américains ont choisi de créer l’Organisation des Nations Unies, à laquelle chaque État participerait, mais que les États-Unis dirigeraient.
Mais alors qui étaient ces soi-disant « isolationnistes » ? Quelles étaient leurs idées et leur vision des affaires internationales ?
Un grand nombre d’Américains d’opinions politiques diverses se sont opposés à une intervention dans la Seconde Guerre mondiale, au moins jusqu’à l’attaque de Pearl Harbor. Ils étaient généralement favorables à ce que les États-Unis défendent par la force et dominent l’ensemble de l’hémisphère occidental. Beaucoup d’entre jugeaient que les échanges économiques et culturels et le droit international constituaient les principaux piliers de la paix. Pour cela, ils furent désignés comme des « isolationnistes », une épithète surtout utilisée par leurs adversaires politiques… Demandez aux Chiliens, Cubains ou Nicaraguayens si la domination américaine sur l’hémisphère est de l’isolationnisme ! Le terme isolationnisme en dit plus sur les personnes qui l’ont employé que sur les personnes qu’il a servi à désigner.
Dans l’Entre-deux-guerres, les citoyens ordinaires et les élites jugeaient que la Première Guerre mondiale avait démontré la nature destructrice et inutile de la guerre.
Stephen wertheim
La politique étrangère américaine d’avant la Seconde Guerre mondiale fut elle aussi parfois qualifiée d’isolationniste, puisque les États-Unis avaient en grande partie évité les interventions militaires et les alliances sur le continent eurasiatique. Selon cette logique, Theodore Roosevelt, l’impérialiste déclaré, était donc un isolationniste. Il en va de même pour Woodrow Wilson, à l’origine de la création de la Société des Nations, mais qui expliquait que la véritable force derrière elle serait « l’opinion publique » internationale, ce qui éviterait le recours à la force armée pour assurer l’ordre. Le terme isolationnisme tourne donc en dérision la réalité historique, et pourtant il reste largement utilisé aujourd’hui.
En lisant le livre, je me suis demandé si ces internationalistes non-interventionnistes constituaient une « tradition perdue » dans la pensée américaine ou s’ils avaient eux des héritiers ?
Certaines des tendances les plus idéalistes de l’internationalisme américain, comme le pacifisme, se sont certainement éteintes rapidement après la Seconde Guerre mondiale. Pendant quelques années après la guerre, certains américains influents pensaient encore que les grandes puissances pouvaient coopérer par l’intermédiaire des Nations Unies. Il y eut un intérêt réel, bien que marginal, pour le fédéralisme mondial, pour des contrôles supranationaux forts qui pourraient apprivoiser la rivalité interétatique. Dans la même veine, certains responsables se sont opposés à la guerre froide à ses débuts, comme Henry Wallace, qui démissionne de l’administration Truman en 1946. Mais la position selon laquelle les États-Unis devraient se limiter à un périmètre de défense hémisphérique fut solidement défaite après la Seconde Guerre mondiale. Cela ressemblait à de l’isolationnisme. Surtout, le consensus de la guerre froide s’est rapidement formé : le communisme soutenu par les Soviétiques devait être contenu, ou repoussé, sur l’ensemble de la surface du globe.
Ce que je trouve remarquable, c’est qu’après l’effondrement complet de l’Union soviétique il y a trois décennies, les États-Unis ont persisté dans leur poursuite de la domination militaire mondiale. Ils n’ont pas seulement maintenu les alliances en place, mais ils les ont élargies, y compris via l’OTAN. Je pense que dans les années 1990, les responsables de la politique étrangère et les intellectuels américains avaient perdu le lien avec une tradition plus ancienne combinant le nationalisme américain et l’internationalisme pour conclure que les États-Unis n’avaient pas grand intérêt à projeter leur puissance militaire à l’échelle mondiale et qu’ils ne provoqueraient que des dommages en le faisant.
Cette vision du rôle des États-Unis née lors de la seconde guerre mondiale a-t-elle des conséquences de long terme sur la définition et la conduite de la politique étrangère américaine ? Je pense notamment aux interventions à l’étranger et aux « guerres sans fin ».
Au niveau de la grande stratégie, si un pays essaie d’être la puissance militaire dominante, prend des engagements en matière de sécurité et stationne ses forces à travers le monde, il va de soi qu’il sera fréquemment et peut-être perpétuellement impliqué dans des conflits. C’est ce que nous avons pu constater depuis la chute de l’Union soviétique. Les États-Unis ont utilisé la force militaire beaucoup plus fréquemment depuis l’effondrement de leur principal ennemi que pendant la guerre froide. Tant que les États-Unis chercheront à dominer partout, ils seront en guerre quelque part. Bien sûr, ce n’est pas ce que disent les dirigeants américains qui entretiennent l’illusion de « la paix par la force ». Il s’agit de l’idée que les États-Unis, en conservant une domination écrasante, peuvent dissuader tous les États et les groupes armés de chercher à accroître leur puissance ou d’agir d’une manière qui leur déplaise.
Il y eut un intérêt réel, bien que marginal, pour le fédéralisme mondial, pour des contrôles supranationaux forts qui pourraient apprivoiser la rivalité interétatique.
Stephen wertheim
C’est une forme de paix à par l’empire. Or même les empires se sont retrouvés à constamment devoir combattre sur leurs frontières. Point intéressant, mon livre montre que certains des premiers planificateurs de la domination américaine avaient bien conscience que les États-Unis d’après-guerre s’engageaient dans la voie d’une action de police internationale constante. Ils considéraient même l’empire britannique comme un modèle pour le leadership américain. Pendant la plus grande partie de 1941, ils imaginèrent que les États-Unis allaient conclure une alliance étroite et exclusive avec l’empire britannique afin de disposer d’une force de police aérienne et navale capable de bombarder les auteurs de troubles. Ils n’avaient aucune illusion au sujet de la paix par la force.
Sur le plan idéologique, les politiciens et les élites américaines assimilent souvent le fait d’agir sur la scène internationale à l’utilisation de la force militaire. Je pense que la création du concept d’isolationnisme est à l’origine de ce phénomène. L’isolationnisme fonctionne en présentant ceux qui s’opposent à l’usage de la force comme s’opposant en fait, indépendamment de ce qu’ils disent, à ce que les États-Unis interagissent avec l’extérieur. Ainsi, les Américains peuvent bien mener des actions dans le domaine de la diplomatie, du commerce et de l’aide au développement, des commentateurs éminents seront toujours susceptibles d’accuser un président de ne rien faire tant que celui-ci n’aura pas dépêché de troupes.
Je vous propose de nous tourner maintenant sur la situation contemporaine. Selon vous, dans quelle direction se dirige l’administration Biden en matière de politique étrangère, entre l’accent mis sur la compétition avec la Chine et les signes de retenue, à commencer par le retrait d’Afghanistan ?
Le débat sur la politique étrangère a radicalement changé au cours de la dernière décennie et plus particulièrement ces toutes dernières années. Les partisans de la retenue, dont je fais partie, ont pris l’initiative, en particulier au sujet des guerres dites « sans fin » au Grand Moyen-Orient. En partie à cause d’une forte opposition de l’opinion, l’administration Biden a ainsi décidé de mettre fin à la guerre en Afghanistan, ceci de manière décisive, du moins c’est ce qu’il semble à ce stade. Plus largement, un fort consensus existe aujourd’hui pour juger que les « grandes opérations militaires pour refaire d’autres pays », selon les mots du Président Biden, étaient contre-productives.
Mais ceux qui prônent la retenue désirent un changement beaucoup plus profond. Ils s’inquiètent du fait que les États-Unis déploient encore des centaines de soldats en Syrie et plusieurs milliers en Irak, et qu’ils mènent des opérations militaires par le biais de forces spéciales et de frappes aériennes le long d’un grand arc allant d’Afrique en Asie. Ils sont également préoccupés par le fait que les États-Unis aient pris l’engagement d’entrer en guerre au nom de dizaines de pays à travers le monde. Ces alliances ne servent pas forcément les intérêts des États-Unis et sont plus susceptibles de provoquer que de dissuader les conflits. Par exemple dans le cas de Taïwan, l’abandon par les États-Unis de leur politique d’ambiguïté stratégique serait déstabilisante. En effet, en l’absence d’un engagement clair des États-Unis à défendre Taïwan, Pékin a jusqu’à présent accepté le statu quo, puisque les dirigeants chinois peuvent toujours imaginer que la réunification pacifique aura lieu à l’avenir. Mais si les États-Unis s’engagent clairement à défendre Taïwan, les dirigeants chinois pourraient être conduits à conclure qu’en l’absence d’une action rapide pour conquérir Taïwan, la réunification ne pourra jamais avoir lieu.
Le débat sur la politique étrangère a radicalement changé au cours de la dernière décennie et plus particulièrement ces toutes dernières années.
Stephen wertheim
Jusqu’à présent l’administration Biden n’a fait qu’un pas vers la retenue en mettant fin à la guerre en Afghanistan. Dans l’ensemble, elle tente surtout d’adapter « la paix par la force » aux conditions actuelles, qui sont plus compétitives qu’elles ne l’étaient dans les années 90. Mais les États-Unis se sont trop étendus, et il est nécessaire de réduire considérablement les engagements de sécurité et les déploiements militaires de l’Amérique. La dernière chose que nous devrions souhaiter, c’est une guerre entre grandes puissances. Même si les États-Unis et la Chine ne devaient que se retrouver au bord de l’affrontement pour une période prolongée, ceci serait déjà amplement dommageable. En effet, les problèmes mondiaux tels que le changement climatique requièrent une coexistence mutuelle et à des coopérations entre ces deux pays.
À ce propos, concernant les rapports entre la Chine et les États-Unis, ne peut-on pas lire le discours sur la compétition entre grandes puissances comme une nouvelle revendication, par les États-Unis, de la suprématie mondiale, qu’une partie des élites américaines craignent de se voir ravir par la Chine ?
A Washington, certains abordent la montée en puissance de la Chine par analogie avec la l’ascension des pouvoirs totalitaires dans les années 1930. Prenons par exemple le récit qui sert de soubassement à la notion de compétition entre grandes puissances : les États-Unis se seraient convaincus, à partir des années 1990, que la Chine deviendrait une démocratie libérale pro-occidentale grâce à son intégration dans l’ordre mondial, et en particulier à son adhésion à l’OMC. Mais il s’agissait d’un espoir naïf et il serait donc aujourd’hui nécessaire de s’endurcir. Ce récit ressemble étroitement à celui qui s’est développé au début des années 40, lorsque les partisans de la domination américaine dans l’après-guerre expliquaient que les puissances de l’Axe avaient pu se rapprocher dangereusement de la domination mondiale en raison de la confiance naïve que les États-Unis avaient placée dans l’opinion publique pour préserver l’ordre mondial.
Mais je ne pense pas que les États-Unis et la Chine doivent nécessairement s’enfermer dans une guerre froide et accroître leur agressivité réciproque à l’avenir. Nous assistons peut-être à une guerre froide performative : les dirigeants de part et d’autre adoptent une rhétorique rude pour diaboliser l’autre, mais les pays restent profondément intégrés économiquement, et le risque de conquête territoriale ou de changement de régime est plutôt faible. La Chine n’a pas encore poursuivi de programme de conquêtes massives, comme ont pu le faire les puissances de l’Axe et l’Union soviétique à ses débuts. Et je ne pense pas que le public américain ressente autant d’inquiétudes vis-à-vis de la Chine que ne le les élites à Washington.
Je voudrais maintenant me tourner vers l’Europe et connaitre votre opinion sur le renouveau de la géopolitique dans le discours officiel, autour notamment des notions « d’autonomie stratégique » et de « souveraineté européenne ». Assiste-t-on au retour de la politique de puissance en Europe ?
Je pense que l’Europe fait montre d’un intérêt croissant pour le fait de se positionner comme un acteur stratégique. Concernant la seconde partie de votre question, plus critique, il est sans doute prématuré de considérer que la politique de puissance fait son retour en Europe, puisque la Grande-Bretagne et la France, par exemple, ne sont pas sur le point de se faire la guerre, bien heureusement.
Je pense qu’il est sain pour l’Europe d’assumer plus de responsabilités en tant qu’acteur stratégique dans le monde, parce qu’il est aujourd’hui difficile de compter sur les États-Unis pour jouer un rôle stabilisateur en Europe. Elle pourrait être un acteur précieux, en mesure de jouer un rôle de médiateur entre la Chine, la Russie et les États-Unis, si ces trois puissances continuent d’intensifier leur concurrence. Si mon livre permet de donner un conseil sur ces questions, c’est d’éviter de passer d’une confiance excessive dans l’idée que la politique de puissance appartient au passé à l’affirmation et à la projection zélée de la puissance. Je pense que c’est ce qui s’est passé aux États-Unis. Une perspective plus saine consiste à assumer la responsabilité de faire avancer l’intérêt véritable de son pays ou de l’Europe, et de ne pas rechercher le pouvoir pour lui-même, mais d’être au contraire très attentif aux potentiels effets contre-productifs de son emploi.

