« Être antimoderne n’a pas grand sens », une conversation avec Johann Chapoutot
Dans Le Grand Récit, paru aux PUF, Johann Chapoutot analyse les grands discours de dotation et de donation de sens, du providentialisme au complotisme. Nous l'avons rencontré pour discuter de son approche historienne, des interrogations qu’elle peut soulever, et de l’articulation de son livre au reste de son travail.
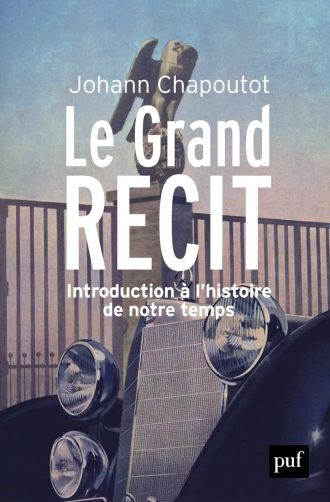
En vous lançant dans ce livre, vous êtes-vous dit que votre approche historienne ne suffisait plus pour éclairer notre temps ?
À vrai dire, non, c’est même le contraire. Beaucoup de gens m’ont demandé si je faisais un pas de côté avec ce livre. Mais en réalité, j’ai l’impression d’avoir approfondi ce qui est le cœur de mon métier, qui est une attention au sens de l’histoire aux yeux des acteurs eux-mêmes. Il y a différentes manières de faire de l’histoire : pour ma part, je préfère une approche culturaliste, internaliste et compréhensive à une approche qui serait plus externaliste et à prétention explicative.
Je m’interroge sur le sens donné aux actes par les acteurs et donc sur le discours de donation et de dotation de sens, c’est-à-dire au récit. Je m’intéresse à ces formes de discours qui sont des mises en intrigue narratives et j’ai voulu expliciter, dans l’introduction, dans la conclusion et dans le chapitre 9, une certaine manière de faire de l’histoire. Tout cela dérive d’une suggestion de mon ami et complice Christian Ingrao qui me conseillait d’écrire un article sur la manière dont, avec d’autres, je fais de l’histoire.
En réfléchissant au discours, au récit de donation de sens, je me suis dit que j’allais faire ce point méthodologique et épistémologique. Je suis donc au cœur de ce que je fais habituellement. De nombreuses personnes se sont étonnées que je parle trop de philosophie ou d’humanités, mais il suffit d’ouvrir ma thèse pour se rendre compte que j’ai toujours fait cela. C’est ce que je lis et ce que je pratique. Pour le dire simplement, je ne passe pas mon temps à lire Himmler. Ce que je lis dans ma vie c’est de la philosophie, des essais, de la littérature, de la sociologie et également mes collègues historiens, auxquels j’essaie de rendre hommage dans ce travail.
J’ai fait ce que je fais habituellement, en l’explicitant. Ce qui me surprend en revanche, c’est la manière dont mon travail est reçu. J’écris ces ouvrages avant tout pour mes filles et pour moi, dans le but d’expliquer, de mettre un peu d’ordre, de définir et de comprendre un minimum notre être au monde. Et en fait, cela a été approprié médiatiquement et socialement car cela rencontre des questionnements contemporains.
Vous affirmez que les nazis sont « de notre temps et notre lieu », prolongeant ici la réflexion engagée dans Libres d’obéir. Comprenez-vous que cette affirmation puisse dérouter ? Du reste, plus que de notre temps et de notre lieu, les nazis ne sont-ils pas le produit de la civilisation industrielle qui naît au XIXe siècle ? On a l’impression que vous vous éloignez de vos premiers travaux sur la généalogie intellectuelle du nazisme pour plutôt réfléchir à la permanence du nazisme dans nos sociétés.
L’amont et l’aval sont liés. Mon objet d’étude n’est pas le nazisme. C’est plutôt mon terrain au sens des archéologues ou des anthropologues. Mon objet est plutôt, pour aller vite, la modernité, c’est-à-dire cet être-au-monde particulier, différent de celui que l’on connaissait avant la Révolution française. L’industrialisation et les formes de dérélictions sociales de masse induites par l’urbanisation, l’industrialisation et la déprise religieuse ont provoqué un désenchantement du monde auquel le nazisme a été une réponse explicite. Le nazisme a pu séduire, convaincre voire enthousiasmer car il répondait concrètement à des questions majeures sur l’être-au-monde de ceux qui se posaient ces questions : que suis-je ? d’où est-ce que je viens ? où va-t-on ? C’est un ensemble de questions fondamentales auxquelles les récits et les discours traditionnels ne parvenaient plus à répondre.
C’est en cela que le nazisme est, de fait, de notre temps et de notre lieu. C’est une chose sur laquelle j’insiste car on traite le nazisme, surtout médiatiquement ou publiquement, sous le prisme de l’aberration, de l’exception ou de l’anomalie. Je le comprends et c’est du reste comme cela que j’ai commencé à travailler sur le sujet, comme tout le monde. Mais lorsque nous nous penchons sur le nazisme, nous nous rendons compte que tout ce qui est dit et affirmé est d’une grande banalité. Ce qui est rêvé et planifié l’est moins cependant. Ajoutons que, géographiquement et temporellement, le nazisme n’est pas la Papouasie du XIIIe siècle ou l’Inde du XVIIe siècle mais bien l’Europe du XXème siècle. De fait, c’est notre temps et notre lieu, et il est issu de cette matrice que vous évoquiez : l’Europe capitaliste et colonialiste de la seconde moitié du XIXe siècle.
Mon objet est, pour aller vite, la modernité, c’est-à-dire cet être-au-monde particulier, différent de celui que l’on connaissait avant la Révolution française.
JOHANN CHAPOUTOT
Pour l’aval, c’est la même chose. De la même manière qu’il n’y a pas une création ex nihilo en 1933, il n’y a pas de volatilisation à partir de 1945. Les fondamentaux de notre civilisation occidentale pour aller vite — extractivisme, productivisme et aliénation —, qui se sont cristallisés dans la seconde moitié du XIXe siècle en Europe et aux États-Unis, ne se sont pas dissipés. Les fondamentaux sont là, les questions sont là également et, de fait, les phénomènes dont les nazis ont été des « exposants » (je me réfère ici au terme allemand Exponent), c’est-à-dire des illustrations particulièrement vives, ne se sont pas dissipés par la suite.
L’idée de considérer un travailleur comme une ressource, idée typiquement nazie, cette réification de l’autre en tant qu’il est agent producteur, est la base de la définition des « ressources humaines » que l’on « gère » aujourd’hui. C’est pour cela que j’avais avancé ces idées dans Libres d’obéir, qui a reçu un excès d’honneur ou un excès d’indignité. Excès d’honneur de la part de ceux qui estimaient que j’avais enfin montré que notre quotidien était nazi, ce qui n’est pas mon propos. Excès d’indignité de la part de ceux qui estimaient que je rabattais tout sur le nazisme, que je faisais une espèce de reductio at hitlerum, alors que ce n’était pas le cas.
Le moment nazi, le phénomène nazi nous permettent de lire notre modernité à l’œil nu, comme les chromosomes de la mouche drosophile que l’on privilégie dans les enseignements de biologie car ils sont tellement énormes que nous pouvons les regarder sans outils plus perfectionnés qu’un simple microscope.
À « nazifier » notre présent, n’y a-t-il pas un risque, d’une part, de perdre de vue ce que vous montrez dans une partie de vos travaux c’est-à-dire qu’il y aurait une banalité du nazisme, qu’il est avant 1939 une expression politique parmi d’autres réponses à la modernité industrielle ? Et de l’autre côté, ne risque-t-on pas de perdre de vue ce qui fait tout de même la singularité historique du nazisme, lorsque l’on considère l’histoire longue des extrêmes droites en Europe ?
Il y a deux malentendus. D’abord, je ne « nazifie » pas le contemporain. Dans Libres d’obéir, je n’ai pas inventé ce Général de la SS proche de Himmler qui devient pape du management et créateur de la plus grande école de commerce en Allemagne après 1945. Je n’ai pas inventé Reinhard Höhn, il existe, il y a du reste de bons travaux sur lui. À partir de cette étude de cas-là, j’ai voulu proposer un certain nombre d’axes de réflexion, le fait par exemple que je me suis mieux expliqué le haut-le-cœur que provoque chez moi la notion de « gestion des ressources humaines ». Quand les nazis parlent de Menschenmaterial, il y a quelque chose comme un bain culturel commun entre le Reinhard Höhn officier SS des années 1930 et 1940 qui réfléchit à la disparition de l’État, à la multiplication des agences et à l’usage propre du matériel humain et le Reinhard Höhn de 1956, ex-général de la SS redevenu professeur-docteur et créateur d’école de commerce acclamé comme « pape du management » pour son 95ème anniversaire en 2000. Là non plus ce n’est pas moi qui le présente comme tel, c’est la Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeberverbände (BDA), le syndicat des patrons allemands, le MEDEF allemand.
Il faut ensuite voir ce que nous entendons par nazisme. Je vais dire quelque chose que j’ai déjà dit et écrit et qui peut susciter une forme d’incompréhension : le nazisme ne peut pas être réduit à la Shoah, et la Shoah ce n’est pas que le nazisme.
La Shoah ce n’est pas que le nazisme car c’est une entreprise commune à toute l’Europe. Tout le monde s’y est mis. Des préfets français aux nationalistes lituaniens en passant par les Oustachis croates et les antisémites polonais. Ils s’y sont mis sur incitation allemande, mais les Allemands eux-mêmes — regardez les travaux de Jan Tomasz Gross – étaient horrifiés par les pogroms polonais qui se déroulaient devant leurs yeux. C’est la même chose dans la Baltique ou dans les Balkans avec les Oustachis : les Allemands présents sur place sont effarés par la violence antisémite des locaux.
Ensuite, le nazisme, ce n’est pas que la Shoah. Le nazisme c’est, avant 1941, au moins 8 ans —plus si l’on remonte à 1919 ou 1920 — d’une expérience politique qui a été acclamée de toutes parts : en France, en Grande-Bretagne et aux États-Unis. Ce ne fut pas le cas de tout le monde bien sûr : les communistes étaient contre, les sociaux-démocrates également, certains chrétiens-démocrates aussi. Mais le « plutôt Hitler que Blum » dénoncé par Mounier puis par Marc Bloch n’est pas un mythe. Il est frappant de voir comment les élites britanniques ont couvé de leur regard bienveillant un Hitler qui leur paraissait être la parade idéale contre le bolchevisme, la solution pour tuer la gauche et les syndicats et pour transformer l’Allemagne en « zone d’investissement optimale ». À partir de 1933 en effet l’Allemagne, vu le programme de réarmement et vu qu’il n’y a plus de gauche, est une « zone d’investissement optimale » — un concept que j’ai élaboré à partir de la zone monétaire optimale. Vous pouvez avoir un rendement unique au monde de vos placements grâce aux conditions de productions offertes par le pays.
Le nazisme avant 1941, ce n’est ni Treblinka, ni Sobibor. Ce sont des réalités que je connais un peu. Et cela m’étonne lorsque certains froncent le sourcil : je suis le seul historien français primé par Yad Vashem, pour La loi du sang. C’est pour cela que cela m’a laissé un peu perplexe. En même temps je me dis qu’à étudier longtemps un phénomène on ne se rend plus compte que ce qui apparaît comme évident après une lente décantation ne l’est pas du tout pour l’auditoire. Le hiatus entre chercheur et public croît fatalement.
Le plus surprenant dans Libres d’obéir est le saut d’une étude de cas à une lecture beaucoup plus générale du management ouest-allemand et même ouest-européen après 1955. Pensez-vous que ce n’est pas ça qui provoque la surprise de la réception ?
Avant 1945, Reinhard Hohn est une individualité typique du milieu des intellectuels SS pour reprendre Christian Ingrao 1 ou Michael Wildt. Et ses amis, ceux avec qui il travaille sont Werner Best — le numéro deux de la Gestapo — et Wilhelm Stuckart — le rédacteur des lois de Nuremberg. Et c’est avec eux qu’il travaille à cette revue appelée Empire. Ordre racial. Espace vital (Reich, Volksordnung und Lebensraum) pour réfléchir à l’attrition de l’État et à la mutation des structures pour administrer le Grand Empire de manière optimale.
Le nazisme ne peut pas être réduit à la Shoah, et la Shoah ce n’est pas que le nazisme.
JOHANN CHAPOUTOT
Après 1945, il est célébré pendant son jubilé du 95e anniversaire comme étant le « pape du management ». Son école a formé 700 000 cadres embauchés dans plus de 2000 entreprises allemandes. C’est un phénomène social de masse et c’est en cela que nous pouvons passer d’une étude de cas à un phénomène plus général. D’autant plus que dans son école, il ne s’est pas amendé, n’a rien regretté et n’a jamais eu un mot pour le passé. Et, par ailleurs, il a employé, comme enseignants dans son école, des alte kameraden, c’est-à-dire des anciens SS. Franz-Alfred Six condamné à Nuremberg pour génocide actif — sur le terrain — libéré, devint le directeur du marketing de Porsche et fut professeur de marketing dans son école de commerce. Le professeur de médecine Karl Kötschau qui, après 1945, continua à dire qu’il fallait éliminer les malades ou les handicapés devint professeur de « développement personnel ». Le docteur Justus Beyer, condamné à Nuremberg pour génocide actif y enseigna comme professeur de droit commercial.
Le XXIe siècle constitue-t-il une césure, notamment du point de vue que vous traitez, c’est-à-dire la création de sens, de récit ?
Peut-être, cela dépend de l’endroit où nous mettons la césure. Les chronologies les plus argumentées parlent de 1989 et d’autres de 2001. Est-ce que la césure n’est pas plutôt la fin des années 1970 avec la crise industrielle majeure que connaît la première patrie de la révolution industrielle qu’est la Grande-Bretagne, par la réaction politique ferme, pleinement assumée qui est celle de Margaret Thatcher qui incarne et met en oeuvre ce que Grégoire Chamayou a bien étudié dans La société ingouvernable 2, c’est-à-dire les solutions néolibérales. J’entends par là un libéralisme profitable pour le capitalisme financier, le tout sous la gouverne d’un État dépouillé d’à peu près tout, sauf de sa capacité à maintenir de l’ordre. Car il faut de l’ordre pour que les affaires se fassent. C’est pour cela qu’on a acclamé Hitler dans les années 1930, et Pinochet dans les années 1970.
La césure ne serait-elle donc pas l’arrivée de Margaret Thatcher au pouvoir en 1979, juste avant celle de Ronald Reagan, puis d’Helmut Kohl en 1982-1983 en RFA ? On est du reste juste avant le fameux tournant de la rigueur de 1983 en France et l’arrivée de Laurent Fabius qui marque à la fois une inflexion dans le discours politique sur la question de l’immigration — le fameux « Monsieur Le Pen pose les bonnes questions mais y apporte les mauvaises réponses » 3 — et une inflexion également dans la conception du règlement et de la loi avec le début de la dérégulation. On n’a pas attendu Chirac en 1986, cela a commencé très clairement en 1984.
Pour continuer sur la césure que représente le XXIe siècle, le complotisme contemporain est-il une réponse à la disparition de structures politiques ou religieuses capables d’expliquer le monde ?
Si l’on considère l’importance de la déprise du religieux, qui est claire en Occident, on pourrait faire l’hypothèse que le religieux resterait important en creux, de manière fantomatique ou spectrale, au sens où l’on parlerait de membre fantôme. Si nous faisons cette hypothèse, il est clair que dans cette lecture-là, pour reprendre une vision aronienne des religions séculières, le complotisme est une manière de se passer de religion sans avoir fait le deuil d’une transcendance. Celle-ci devient une transcendance négative dans laquelle le mal — le juif, le reptile ou je ne sais quoi — finit par avoir une vertu car il explique tout. Les malheurs individuels et sociaux se voient attribuer une cause évidente et compréhensible.
C’est pour cela que je resitue les théories et les récits du complot dans une perspective plus large et une chronologie plus longue, en me référant par exemple aux travaux de Franck Collard sur la conspiration des lépreux au Moyen-Âge 4.
Il faut de l’ordre pour que les affaires se fassent. C’est pour cela qu’on a acclamé Hitler dans les années 1930, et Pinochet dans les années 1970.
JOHANN CHAPOUTOT
Il y a une permanence : derrière le chaos impénétrable qui m’affecte, il y a une « causalité diabolique ». Je reprends cette expression de Léon Poliakov et Norman Cohn dans Les Fanatiques de l’apocalypse 5. Cette causalité me rassure car elle est identifiée et pourvoyeuse de sens. Cela répond à un besoin thérapeutique : trouver du sens dans son malheur est fondamental. Moi-même, j’ai eu la surprise d’apprendre qu’une psychanalyste, Nathalie Zajde qui traite des patients nés de survivants de la Shoah prescrivait La Loi du sang 6 à ses patients. Car c’est important pour des patients qui souffrent d’avoir un discours de sens qui expose et déconstruit le projet exterminateur des nazis en l’inscrivant dans une époque et dans sa rationalité propre. Le complotisme est une forme de thérapie sauvage à grande échelle de manière tout à fait comparable à un phénomène que je n’ai du reste pas cité dans mon livre, les épidémies de sorcellerie dans les années 1960-1970 étudiées par Jeanne Favret-Saada dans Les mots la mort les sorts 7. C’est une réponse à un traumatisme social massif : la loi Pisani, l’américanisation de l’agriculture, les intrants chimiques, l’arrachage du bocage pour faire des grands openfields. La manière de répondre à ces traumatismes de masse est d’imaginer qu’on nous a jeté un sort qui entraîne la mort d’une vache, la panne du tracteur ou les difficultés financières. Je suis historien, je ne fais que constater, mais les anthropologues ou les psychologues ont quelque chose à dire sur les ressorts de tout cela. Il est évident que le besoin d’herméneutique est là et le complotisme y répond merveilleusement bien car c’est une manière de faire du religieux sans Dieu, mais en conservant le Diable, parce que vous gardez une figure détestable, honnie, un « Qui ? » adorné de petites cornes.
Vous faites des parallèles entre la France contemporaine et la Rome antique, comparant notamment leur fascination pour le mythe de l’âge d’or. Ce mélange des temps n’est-il pas problématique ? Ne donne-t-il pas l’impression que l’histoire est un éternel recommencement ou un cycle ? Peut-on vraiment mettre Salluste et Éric Zemmour sur le même plan ?
Vu comme cela, ce n’est effectivement pas une bonne chose et il vaut mieux faire comme Gérard Noiriel qui met Zemmour sur le même plan qu’Edouard Drumont !
Le rapprochement avec l’Empire romain est opportun dans la mesure où la République française et la cité politique française se sont construites en référence à la romanité. La révolution s’est faite « en habits de Romain » – je reprends ici Marx. On peut citer Camille Desmoulins affirmant « Nous avions la tête farcie de grec et de latin, nous étions des républicains de collège ». Tout concourt à ce que l’on se pense en Romain, notamment la vertu stoïcienne du citoyen qui doit penser l’intérêt général contre son intérêt privé. Dès lors, l’histoire ancienne a une importance, une prégnance en France depuis la Révolution française, qui renforce l’héritage de la Renaissance puis des Jésuites en lui donnant une dimension civique. Il est donc important de voir que nous avons été nourris de cela par innutrition.
Or lorsque nous lisons des textes du premier siècle avant et de notre ère, l’acmé de l’Empire, les auteurs romains ne cessent de se plaindre. Et il est tout de même possible que nous soyons les héritiers de cette insatisfaction face au présent. Après tout, pendant des décennies, les générations politiques et universitaires ont été formées à la version latine sur ces textes-là, en traduisant la conjuration de Catilina de Salluste, en traduisant du Tite-Live, du Tacite et tous se plaignent en affirmant que « c’était mieux avant », que le mos maiorum a été perdu, que la virtus patrum était à retrouver. Cela a peut-être laissé des traces.
Comme les Romains nous avons une haute idée de nous-mêmes : l’urbs c’est la civilisation, la culture et nous ne sommes jamais à la hauteur de notre idéal, or l’idéal romain était immense. En France, c’est la même chose, nous avons depuis la Révolution française l’ambition de parler pour le genre humain. Ce messianisme-là a un revers de la médaille qui est cette espèce de délectation morose, celle qui consiste à dire que nous ne sommes pas à la hauteur de ce que nous prétendons être. Le messianisme et le déclinisme sont les deux revers d’une même médaille.
Justement, on ne comprend pas complètement ce qui distingue « les grands isthmes » du contemporain des grands récits que vous décrivez dans la première partie du livre. Les voir comme des ruines des grands « -ismes » qui se seraient effondrés, n’est-ce pas prendre le risque de ne pas prendre autant sérieux ces nouveaux récits, ces discours qui portent du sens ? Vous prenez par exemple le messianisme et le déclinisme comme des « isthmes » et j’avoue ne pas complètement voir en quoi ce sont des discours moins puissants ou moins valables comme explication du monde que le providentialisme, si ce n’est qu’ils ne sont pas adossés à des structures millénaires ?
Vous avez parfaitement raison en termes d’herméneutique. Leur valence herméneutique est analogue, comparable, sinon identique. Mais c’est dans leur faculté de mobilisation que c’est plus problématique. Le déclinisme ne va pas vous faire envahir la Pologne car il est déploratoire, et c’est en cela que je me demande si un Zemmour peut aller bien loin.
Mais le déclinisme, ou le sursaut qu’il provoque, fait sortir l’Angleterre de l’Union européenne, et il participe sans doute à l’élection de Trump.
Oui mais c’est un scrutin, ça n’est pas la campagne de Russie. Aller voter est important, mais ce n’est pas l’épopée eschatologique de la construction du nouvel « Empire romain » par les fascistes en 1936, de l’invasion de la Russie ou des Révolutions française et bolchevik.
Le mythe qui pourrait être plus mobilisateur est l’ « illimitisme », représenté par Jeff Bezos ou Elon Musk. C’est le dernier avatar d’un progressisme techniciste qui essaie de se sauver lui-même en cherchant à fuir une planète que nous avons rendue inhabitable pour investir, dans une grande épopée spatiale, une planète inhabitable. Nous voyons que cela ne mord pas, et que cela provoque même des réactions hostiles.
Le déclinisme ne va pas vous faire envahir la Pologne car il est déploratoire, et c’est en cela que je me demande si un Zemmour peut aller bien loin.
JOHANN CHAPOUTOT
En termes herméneutiques, il y a des fortes valences, mais en termes de performativité mobilisatrice, je ne pense pas. Mais cela reste une discussion ouverte.
Cette performativité mobilisatrice n’est pourtant pas un phénomène constant dans les grands récits que vous évoquez. Si l’on prend l’histoire du catholicisme par exemple, durant de longues périodes, il n’y avait pas d’autres conséquences de sa capacité herméneutique que celle de réunir des individus chaque dimanche. Aujourd’hui, où en sommes-nous ?
D’abord, il est vrai que cette puissance mobilisatrice n’a pas toujours été à son apogée. Mais il y avait tout de même une structure capable d’opérer une reconquête évangélisatrice, ce qui n’est plus le cas aujourd’hui, d’abord parce qu’il n’y a plus assez de curés. À la fin du XVIe siècle, avec le Concile de Trente, la puissance de l’Église est telle qu’elle peut contre-réformer et entamer une reconquête catholique. Il en est de même au XIXe siècle. Il y a eu un grand arasement, déjà avant la Révolution française – ce que montre très bien Michel Vovelle – mais il y a le maillage des couvents, des paroisses, des séminaires qui permet cette deuxième contre-réforme du XIXe siècle.
Actuellement, c’est beaucoup plus discutable : la technostructure, les moyens ne sont plus là. Nous pourrions finalement dresser un triptyque à partir de trois travaux d’historiens : Le Goff dans la Naissance du purgatoire 8, Michel Vovelle qui montre l’apogée et le début du doute et Guillaume Cuchet, qui montre la mort du dogme 9. Ces trois historiens nous offrent, avec leurs ouvrages, toute la vie du dogme, et Guillaume Cuchet pose cette question, dans son dernier ouvrage, de la disparition ou non du catholicisme dans un lieu qui était censé en être sinon le berceau du moins un vecteur important.
Vous défendez une autre approche historique qui peut paraître, à première vue, étonnante, la pensée contrefactuelle. Quelle est la fécondité de cette approche pour l’historien et plus largement pour la compréhension de notre temps ?
J’y suis venu de mon pré carré, en l’occurrence le terrain allemand. À partir des années 1950 a existé une école historique — qualifiée de bundesrepublikanisch — parce que les historiens qui la composaient étaient issus d’Allemagne de l’Ouest et avaient embrassé la cause de la loi fondamentale et de la démocratie parlementaire. Nés dans les années 1930, ils ont essayé de faire la généalogie du nazisme.
On voit que tous ces historiens autour de l’École de Bielefeld ont fait des thèses sur le XIXe siècle, à chaque fois pour identifier les prodromes de la catastrophe. C’était une approche téléologique qui liait généralement le XIXe siècle bismarckien et wilhelminien au nazisme. Dans leur sillage, une doxa s’est installée, celle du Sonderweg, du chemin particulier d’une Allemagne dont les modernisations auraient divergé. Il y aurait eu d’une part une modernisation économique et technique bien réelle et d’autre part une modernisation politique qui ne serait jamais advenue. Autrement dit, le couple capitalisme/libéralisme politique ne se serait pas vérifié. Tout menait à 1933 dans leur approche.
Cela tient peut-être à la difficulté qu’il y a à lire l’histoire allemande dans la mesure où il n’y a pas d’Allemagne pendant très longtemps — au fond jusqu’en 1990 — et que pour la rendre historiquement visible, on crée une autoroute qui va de Luther à Hitler, voire de Hermann le Chérusque à Hitler. C’est une espèce de déterminisme culturaliste et téléologique qui aboutirait systématiquement à 1933.
Mais, et c’est ce que j’ai défendu dans mon livre sur l’histoire contemporaine de l’Allemagne 10, on pourrait imaginer un autre chemin qui va de 1848-1849 jusqu’à 1949-1990 en passant par 1919 et la République de Weimar. Cette dernière n’a pas été un succès mais il faut tout de même voir ce qui pesait sur ce régime. L’idée d’une téléologie, d’un finalisme et d’un déterminisme m’a toujours chagriné parce que tout ne se résume pas à 1933 dans l’histoire allemande.
L’idée d’une téléologie, d’un finalisme et d’un déterminisme m’a toujours chagriné parce que tout ne se résume pas à 1933 dans l’histoire allemande.
JOHANN CHAPOUTOT
J’ai donc été vraiment intéressé par la démarche de Quentin Deluermoz et Pierre Singaravélou lorsqu’ils ont lancé un séminaire d’examen épistémologique de l’approche contrefactuelle dans le but de montrer que cela ne se résumait pas à l’uchronie, telle qu’elle est pratiquée par les romanciers de science-fiction. Au contraire, ils voulaient montrer que c’était une démarche féconde pour l’histoire. Nous faisons tous du contrefactuel sans le savoir lorsque nous privilégions une hypothèse par rapport à une autre, et que nous mettons de côté des futurs non advenus. Les travaux sur les futurs non advenus, sur les horizons inexplorés qui étaient possibles permettent de revisiter une époque de manière bien plus féconde.
Je m’intéresse beaucoup aux années 1930 françaises et mes grands-parents étaient des jeunes gens durant cette période. Je fais l’hypothèse qu’ils n’avaient pas des pensées suicidaires chaque matin en pensant à l’affaire Stavisky ou à la crise mais qu’ils rêvaient à quelque chose qui n’était ni juin 1940, ni le Maréchal Pétain. Rouvrir les possibles est un impératif épistémologique car les contemporains, comme vous et moi maintenant, ne savent pas ce qui va se passer dans le futur, même proche. Mais nous avons des hypothèses, des désirs et des angoisses. Il ne faut pas sceller les sépulcres, et c’est pour cela que j’ai commencé mes 100 mots de l’histoire 11par le mot « Avenir » car l’histoire n’est pas la pieuse récitation des fatalités mais, au contraire, une école d’avenir. Ceux que l’on étudie sont des gens qui avaient leur désir, leur ouverture, leur indéfinition et leur liberté. C’est à nous de les leur rendre.
Les uchronies nazies passionnent. Beaucoup d’auteurs, comme Robert Harris ou Philippe K. Dick, se sont amusés à imaginer des mondes dans lesquels le IIIe Reich n’était pas tombé. Et il y a une vraie demande pour ce type de récit. Risqueriez-vous une hypothèse pour expliquer ce succès ?
Je pense que c’est avant tout lié à la popularité de l’histoire factuelle, documentaire de la Seconde Guerre mondiale. Qu’on le veuille ou non, celle-ci représente sans doute la dernière grande épopée à disposition, avec un mal bien identifié, et vraiment atroce, un bien qui l’est tout autant, et une victoire du bien sur le mal. Tout cela est en plus très cinématographique car les propagandes de l’époque, d’un côté comme de l’autre, savaient très bien se mettre en scène. Cela a une première conséquence, télévisuelle : la Seconde Guerre mondiale est omniprésente sur les écrans. Et même lorsque les chaînes disent ne plus vouloir traiter cette période, elles continuent car les succès d’audience sont énormes.
De la même manière que nous nous intéressons factuellement à cette période, l’intérêt pour l’uchronie est qu’il s’agit d’une manière de conjurer le mal, le nazisme. Le nazisme, c’est la fermeture face à l’univers des possibles et à l’ouverture dont nous parlions. Tout y est déterminé et nécessité. Le nazisme est un long discours apodictique. Hitler le dit : le nazisme c’est de la biologie appliquée, de la science appliquée, de l’anthropologie raciale appliquée. Dès lors, il n’y a pas de débat possible. C’est comme cela, et si ce n’est pas comme cela, nous mourrons. Nous pouvons bien être pacifistes dit Hitler, mais nous mourrons si nous le sommes. C’est ce qui explique la lourde ironie macabre des nazis. J’ai toujours eu une profonde défiance envers ceux qui affirment que c’est comme cela et pas autrement. Cette absence proclamée d’alternative qu’évoque le « There’s no alternative » de Thatcher.
L’intérêt pour l’uchronie est qu’il s’agit d’une manière de conjurer le mal, le nazisme.
JOHANN CHAPOUTOT
Si le nazisme est la fermeture, l’uchronie permet de réécrire l’histoire et de défier cette chronologie imposée par les nazis, et ce de manière paradoxale car généralement elle les fait survivre, elle leur fait gagner la guerre mais pour mieux les vaincre in fine. Car dans presque toutes les uchronies, ils finissent par perdre. Et ce qui rend leur défaite plus jouissive encore est le fait de prolonger le plaisir, de leur donner une leçon d’histoire et de les vaincre in fine.
En lisant ces histoires, on cherche à se rassurer. Comme, du reste, on cherche à se rassurer en lisant des vulgarisations ultra-factuelles sur l’histoire du nazisme qui nous permettent de nous dire que nous n’avons plus rien à voir avec cela et que le nazisme a disparu en 1945, remplacé par la démocratie et la croissance économique. Mais cette croissance, elle est en partie organisée par des hommes comme Reinhard Höhn.
Nous parlions d’avenir, du manque d’alternatives. Cela rejoint la crise écologique que nous traversons et qui provoque une perte de sens, un bouleversement au sein de notre « régime d’historicité » contemporain. La conception du futur devenant trouble, quelle place peut tenir le discours écologique ? Est-ce un nouveau « messianisme » ?
Je me suis posé la question lorsque je rédigeais cet ouvrage et, pour être tout à fait honnête, j’ai été embêté. Je n’ai pas vraiment trouvé de réponse satisfaisante. La question que je me suis posé est : faut-il parler du récit écologique, notamment dans ses variantes effondristes, « collapsologiques », au risque de rendre la chose triviale et de perdre de vue que les chiffres et les courbes parlent d’eux-mêmes, que les phénomènes catastrophiques sont déjà là et qu’il ne faut donc pas plaisanter avec cela. Nous sommes en train de rendre la planète inhabitable, nous sommes en train de contribuer à la sixième grande extinction, qui va peut-être être également la nôtre si nous restons sur les trends actuels.
Autrement dit, et j’en reviens peut-être à une forme de naïveté épistémologique, il y aurait d’un côté la vérité des chiffres, des courbes et du réel et je ne dois pas la trivialiser, en tant qu’historien, en disant que ce n’est qu’un discours. Mais je peux tomber sous le coup des critiques et beaucoup de journalistes m’ont posé cette question. Il me semble qu’en traitant de cela comme un simple discours, nous tombons dans une forme de climato-négationnisme, qui nie l’évidence de ce changement.
Vous dessinez un portrait séduisant d’un aspect important de l’histoire des idées à l’époque contemporaine. Mais cela reste une histoire très livresque : ce sont les publications d’ouvrages et les controverses entre auteurs qui rythment votre chronologie. Étudiant une époque marquée par l’alphabétisation puis par la politisation de masse, vous ne faites pas du tout d’histoire « par le bas » et vous vous intéressez peu à l’usage et à l’appropriation des récits que vous présentez. Ne craignez-vous pas d’écrire une histoire des idées en « éprouvettes » ?
C’est une question qui se pose toujours quand on fait de l’histoire culturelle. Est-ce que l’histoire culturelle, ou plutôt culturaliste (dans l’idée que le sens des acteurs a un intérêt) est véritablement fidèle à ce qu’a très bien dit Pascal Ory, que c’est une « histoire sociale des représentations » avec cette dimension sociale d’appropriation, de formulation, de vécu social, ou est-ce qu’elle retombe dans l’ornière d’une tradition académique d’histoire des idées totalement désincarnée où, comme vous le dites, nous voyons Léon Brunschvicg répondre à Henri Bergson qui lui-même discutait Kant sans que cela morde sur la société. Je répondrais néanmoins que Kant mord sur la société, et ô combien !
Il y aurait d’un côté la vérité des chiffres, des courbes et du réel et je ne dois pas la trivialiser, en tant qu’historien, en disant que ce n’est qu’un discours.
JOHANN CHAPOUTOT
Par ailleurs, je parle tout de même de l’appropriation. Dans le chapitre sur le complotisme, je parle énormément des réseaux sociaux. Il y a effectivement deux chapitres sur la littérature parce que je parle de « Crise du récit ». Dans le chapitre sur le providentialisme, j’ai essayé de voir ce que pensaient les croyants eux-mêmes du côté protestant, catholique et juif et je me suis donc adressé aux théologiens. Et cela a des implications réelles tous les dimanches dans la pastorale, dans la vie concrète de ceux qui adhèrent à cela et qui suivent le message du magistère. Ce n’est donc pas décorrélé de la société et des pratiques sociales. De même, pour le fascisme, le nazisme et le stalinisme, je ne me suis pas perdu dans les controverses entre Rosenberg et Hans Günther ou entre Boukharine et Trotski. J’ai essayé de voir, en m’appuyant sur les travaux de Nicolas Werth notamment, quelles étaient, socialement, les pratiques d’appropriation de ces discours. Pour le fascisme, je parle du cinéma et pour ce qui est de mes travaux sur le nazisme, mes sources ne sont pas littéraires.
Je suis très attentif à cela parce qu’il ne faut pas être dupe de ce que Bourdieu appelait très justement l’« illusion scolastique » où nous nous faisons plaisir. Mais il ne faut pas non plus escamoter l’efficacité des idées.
Une inquiétude antimoderne traverse votre livre au point que l’on peut se demander si vous voyez des motifs d’espoir dans le présent et dans l’avenir. Qu’en est-il ?
Antimoderne, certainement pas parce que je suis très content de vivre dans notre époque. Je suis très content d’avoir un État de droit qui me protège et de ne pas avoir peur qu’Alexandre Benalla bénéficie d’une impunité totale. Je suis très content d’être soigné comme je le suis et je suis beaucoup mieux en France qu’en Afghanistan, ce n’est même pas une question. Être antimoderne n’a pas grand sens.
Mais quiconque se pique d’intelligence est inquiet, dès que nous faisons profession de réfléchir nous sommes inquiets. Dans cette modernité que j’habite avec reconnaissance, je vois également beaucoup de choses qui ne vont pas et beaucoup de choses qui sont même structurellement liées à la modernité qui ne me conviennent pas : extractivisme, productivisme, réification, aliénation, mépris de l’humain, destruction de notre biotope, tout cela ne me convient pas. Mais ce n’est pas être antimoderne que d’être inquiet de tout cela. Altermoderne, peut-être ?
Je ne considère d’ailleurs pas que ma conclusion soit négative ou désespérée. Au contraire, il y a du scepticisme vis-à-vis des grands récits car, comme vous j’imagine, je me méfie de tout ce qui est « grand » ou se prétend « grand », je suis très pascalien à cet égard, et Pascal est d’ailleurs très présent dans mon ouvrage car il était également très présent au XXe siècle. Les « grandeurs d’établissement » me font rire. Donc je fais effectivement preuve de scepticisme vis-à-vis de ce qui se prétend grand et j’ai également un immense espoir, peut-être lié au fait d’avoir des enfants. Il y a une grande appréhension d’avoir des enfants, mais on se rend compte qu’avec un peu d’humour, un peu d’échanges, de dialogues et un peu d’amour, l’être humain pousse très bien, et la dialectique entre les individus se déroule très bien.
Je dirais donc que mon livre est traversé par deux tensions : du scepticisme et du détachement vis-à-vis du macro mais un immense optimisme quant au micro, sur l’organisation concrète des vies, sur les mutations, sur la réflexion, sur l’intelligence des gens. Les systèmes sont verrouillés et vérolés jusqu’à l’os, comme en témoigne la Ve République. Qu’une personne proclame sérieusement une guerre contre un virus et encourage les incartades de ses collaborateurs, ce n’est pas possible, et le système qui permet cela est mauvais.
Mais au ras du sol, je vois des évolutions très bénéfiques, encore accentuées par les remises en cause covidiennes. Nos contemporains nous ont rejoint pendant ces confinements : ils ont vécu ce que nous vivons, les chercheurs, c’est-à-dire être seul dans sa chambre, réfléchir, se poser des questions fondamentales, et j’y vois un immense espoir.
Dans ce contexte-là, les lettres, l’humanité, l’échappée belle, l’otium, oui, embrassons-les, cela nous nourrit.
Sources
- Christian Ingrao, Croire et détruire : Les intellectuels dans la machine de guerre SS, Fayard, 704 pages.
- Grégoire Chamayou, La société ingouvernable, La Fabrique, 336 pages.
- Laurent Fabius dans L’heure de vérité, le 5 septembre 1984 : “Je pense que l’extrême droite ce sont de fausses réponses à de vraies questions. Les questions sont vraies, c’est la question de l’insécurité dont nous parlions tout à l’heure […]”.
- Franck Collard, “Une rumeur médiévale. Le complot des Juifs et des lépreux.”, L’Histoire (n°231), avril 1999
- Norman Cohn, Les Fanatiques de l’Apocalypse : Courants millénaristes révolutionnaires du XIe au XVIe siècle, Aden Belgique, 482 pages
- Johann Chapoutot, La loi du sang. Penser et agir en nazi., Gallimard, 576 pages
- Jeanne Favret-Saada, Les mots, la mort, les sorts, Gallimard, 432 pages
- Jacques Le Goff, La naissance du Purgatoire, Gallimard, 516 pages
- Guillaume Cuchet, Le Catholicisme a-t-il encore de l’avenir en France ?, Seuil, 256 pages
- Johann Chapoutot, Histoire de l’Allemagne de 1806 à nos jours, Que sais-je ?, 128 pages
- Johann Chapoutot, Les 100 mots de l’histoire, Que sais-je, 128 pages

