Le plaidoyer d’Hubert de Vauplane pour une dette juste
Pierre-Benoit Drancourt et Hugo Pascal ont rencontré Hubert de Vauplane, pour qui la dette perpétuelle est une chimère juridique et une bombe à retardement pour les générations futures. Seule une approche de justice distributive permettra de résoudre la question de la dette, y compris souveraine.
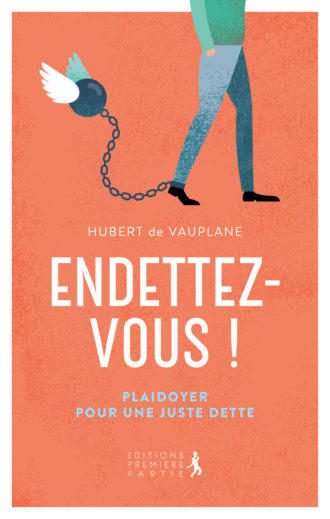
La lutte contre les déficits publics représente une constante dans les politiques libérales contemporaines. Aujourd’hui, l’importante hausse des dépenses publiques et du déficit liés à la Covid-19 ont remis au second plan cet objectif devant une urgence sanitaire et économique dont nous peinons encore à saisir l’ampleur. Quel bilan tirez-vous de l’année écoulée ?
Une grande confusion. Ce qui était considéré hier comme la plus pure orthodoxie budgétaire et devenue une hétérodoxie : le niveau d’endettement mesuré au PIB a tout simplement dépassé dans nos pays tout ce qui était considéré comme des niveaux infranchissables. La soutenabilité ne semble plus avoir de limite, et l’excès de déficit ne semble plus devoir être contrôlé. Certes, « nécessité fait loi », et le « quoi qu’il en coûte » à remplacer le strict respect des ratios issus des traités de Maastricht et les critères de convergence 1. Mais qui respecte encore ces règles ? Qui même estime qu’elles sont pertinentes ? En fait, c’est la gouvernance même des politiques budgétaires nationales qui est remise en cause : pourquoi graver dans la pierre des tables de la loi budgétaire des engagements qui, au regard des circonstances, ont les plus grandes chances de ne pas être respectés et qui conduisent, in fine, à briser ces tables ? Bien sûr qu’une discipline budgétaire est nécessaire ; bien sûr qu’il convient de réduire certaines dépenses de fonctionnement et rationaliser les moyens financiers, mais la mise en place de ratios strictement financiers souligne l’approche purement monétaire de la dette, comme une règle de discipline militaire là où l’on devrait trouver de la souplesse et de la solidarité.
Il est piquant – mais aussi triste – de voir combien les hérauts de cette orthodoxie en sont devenus aujourd’hui les fossoyeurs. Et que la malheureuse Grèce, mais aussi l’Irlande, le Portugal, l’Espagne et d’autres auraient pu s’éviter des mesures budgétaires drastiques avec les effets terribles sur leurs populations.
En particulier la conception d’un plan de relance commun entre les 27 pays de l’Union européenne (UE) pour un total de 750 milliards d’euros est inédite, tant par son montant que par la marque d’un endettement commun et solidaire, et ce alors même que le manque de coordination entre les pays de l’UE dans la gestion de la pandémie a fait l’objet de nombreuses critiques. Le droit européen est-il toujours adapté pour gérer ces dettes dont l’ampleur ne cesse de croître ?
En premier lieu, on ne se félicitera jamais assez de l’étape franchie consistant à prévoir un mécanisme d’endettement partiellement mutualisé. Il reste maintenant à concrétiser ce changement de perspective en renversant, ou à tout le moins, en complétant l’ordre des principes communautaires. Ainsi, alors que la notion de stabilité financière n’a cessé au cours des dernières années de constituer l’étalon des décisions de la CJUE pour juger des rôles et responsabilité de la BCE lors de la crise économique de 2008, permettant de créer autour de l’institution européenne une quasi irresponsabilité de droit de ses décisions, il est temps d’intégrer la solidarité entre États membres comme nouveau principe supérieur permettant de juger des décisions prises par les institutions européennes et les États membres 2. Certes, le principe de la solidarité figure à l’article 3.3 du TUE, selon lequel l’Union « promeut la cohésion économique, sociale et territoriale, et la solidarité entre les États membres ». Mais la formulation retenue revêt plus une dimension incantatoire qu’un engagement ferme et précis. Et en matière budgétaire, le §1 de l’article 122 du TFUE prévoit la possibilité de prendre des « mesures appropriées » dans « un esprit de solidarité entre les Etats membres » ; mais la notion de « mesures appropriées » et le champ d’application de cet article sont trop limités pour en faire un outil efficace de solidarité entre Etats Membres. En fait, le débat européen pourrait s’inspirer de la décision de la Conseil constitutionnel en France qui a érigé comme principe à valeur constitutionnelle la fraternité 3. Même si celle-ci se distingue de celle-là en ce que la fraternité est un sentiment que chacun est libre de ressentir, alors que la solidarité est une mesure sociale de l’État imposée à tous 4.
Tout cela pour dire que, à titre d’exemple, la règle d’interdiction du financement des déficits par la BCE posée par l’article 123 du TFUE qui a donné lieu à une longue série de décisions de jurisprudence de la CJUE où la casuistique rencontre l’hypocrisie, constitue une illustration d’une disposition du droit européen inadaptée aux circonstances actuelles. Il en est de même avec l’article 125 du même traité qui interdit à l’Union et à ses membres de répondre des engagements d’un Etat européen ou de les prendre à charge et sur lequel les parlementaires européens demandent des clarifications depuis 2012 5. Il a bien fallu pourtant contorsionner cette disposition pour autoriser le programme Next Generation EU 6.
C’est dans ce contexte que vous publiez cet ouvrage dont le titre, provocateur, rappelle la formule « Enrichissez-vous ! » de François Guizot. En dressant l’inventaire de toutes les dettes, vous rappelez que la dette, conçue comme un rapport d’obligations et comme un des instruments de l’échange, fait partie de la vie de tout individu.
Le livre se veut un essai sur l’endettement, pris dans sa dimension tout à la fois économique, sociologique, historique, religieuse et juridique. Il tente de montrer que chacun s’enrichit en s’endettant. Non pas d’une richesse monétaire, mais d’une richesse humaine. A l’heure où les dettes monétaires atteignent des niveaux jamais atteint dans l’histoire économique, s’interroger sur le sens de la dette et la notion même d’endettement est une nécessité pour préparer l’ « après », c’est-à-dire les années qui viennent et où il faudra bien traiter la question de la dette monétaire issue de la crise du Covid-19. Le livre se veut un appel à reconsidérer la question de la dette et de dépasser sa fonction monétaire pour découvrir les profondeurs de l’altérité.
La connotation négative associée à ce terme serait-elle en partie imméritée ?
Au cours de sa vie, l’homme sera toujours confronté à de multiples créanciers. Il naît débiteur ; débiteur il meurt. Mais la notion de dette est désormais simplement circonscrite à un rapport financier ou monétaire envers un créancier. Si on parle aujourd’hui de crise de la dette en désignant le surendettement des États, il serait plus juste de parler de crise de la notion même de dette.
La dette – monétaire mais aussi toute autre forme de dette – est aujourd’hui perçue comme injuste voire asservissante. Pourtant, la notion de dette est polymorphe. Dette écologique, dette envers ses parents, dette divine, voire dette historique vis-à-vis des peuples colonisés ou opprimés, on comprend aisément à la lumière de ces exemples que la dette renvoie à un rapport d’échanges asynchrones entre deux personnes. La dette, quoi qu’on en dise, fait peser sur le débiteur une obligation de remboursement. C’est en ce sens qu’elle est avant tout un devoir, une obligation même. Les deux mots ont d’ailleurs la même étymologie latine : debere.
On parle bien d’un « dû » s’agissant d’une dette, et le mot devoir se conjugue en dû au participe passé. « Être en dette, avoir une dette » place le débiteur dans une obligation de morale du devoir et d’obligation juridique.
Or, l’homme moderne perçoit la dette comme une limite à la liberté individuelle. Cela tient à l’évolution de nos sociétés occidentales vers individualisme roi qui refuse la dette, parce qu’il s’agit d’admettre que l’organisation sociale repose sur des liens de dépendance. Selon Marcel Hénaff, les différentes expressions de la dette « disent toutes ceci : la dette a rapport à l’ordre du monde, elle est l’indice d’un manque à combler, d’une insuffisance à corriger ou plus exactement, elle est la tâche de rétablir l’ordre qui a été perturbé ».
Les paradigmes développés aujourd’hui s’inscrivent en opposition vis-à-vis de l’école libérale classique qui a toujours considéré que la monnaie et le marché permettaient de libérer les individus des servitudes dans lesquelles ils étaient enfermés. La monnaie rend les relations entre individus impersonnelles, anonymes et transférables. De facto, elle supprime les liens de relations personnelles entre les individus, en conséquence de quoi tout individu est souverain de lui-même.
Nous serions donc contraints de choisir entre une vision purement libérale de la dette, vue sous un seul rapport monétaire, et une critique néo-marxiste de la dette considérée comme source d’oppression, c’est-à-dire l’obligation pour le débiteur de rembourser « à tout prix » ou le refus de se soumettre au pouvoir des créanciers.
Pourtant, la dette n’est pas par nature mauvaise ou bonne. Elle fait partie de la condition humaine ; elle constitue ce que l’on appelle un invariant anthropologique. On ne peut réduire ontologiquement la dette à une somme de flux monétaires entre débiteurs et créanciers. Seul l’excès de dette ou, à l’inverse, le refus de rembourser doit être combattu. Je pense qu’entre ces deux visions manichéennes, une troisième voie est possible parce qu’être en dette, c’est prendre conscience que l’homme seul n’est rien. Il s’agit de tendre vers ce que Louis-Joseph Lebret appelait une « économie humaine ».
Polymorphe, la notion de dette ne serait-elle pas aussi évolutive et dépendante d’un contexte politique et sociologique donné ?
Oui, bien sûr. Pendant des siècles, les dettes entre individus se sont inscrites entre économie du don et économie marchande, entre obligations sociales et obligations monétaires. La dette était d’abord une forme de lien social où la relation d’échanges ne se limitait pas à un simple transfert monétaire. La charité chrétienne mais aussi la libéralité aristocratique déterminaient sous l’Ancien Régime les relations et modèles de conduite entre les individus. De même, la question des rapports de crédits dans le cadre des sociétés pré-industrielles a été finement analysée par une économiste Laurence Fontaine dans son essai « L’économie morale ». Il est saisissant de constater la situation quasi généralisée d’endettement de la société tant le tiers-état que la noblesse.
Pour autant, cet endettement chronique ne semble pas avoir conduit à des crises majeures même si la pauvreté était une menace permanente pour 80 % de la population. Comment expliquer cela ? C’est la force des liens sociaux. D’ailleurs, dans son essai sur l’autonomie de la volonté, Esther Duflo constate exactement la même force des liens sociaux dans le développement du microcrédit en Inde. En fait, dans les sociétés pré-industrielles, l’endettement a lieu au sein de communautés dont ses membres sont liés fortement entre eux que cela soit de manière verticale ou horizontale. De plus, à mesure que l’endettement s’accroît, le cercle des créanciers s’élargit et les dettes sont échelonnées dans le temps. Il est assez fréquent de transmettre ses dettes à la génération suivante. Il ne faut pas être toutefois naïf, ces liens sociaux ne doivent pas être idéalisés. Si ces derniers exprimaient la solidarité d’individus, ils étaient aussi lieu de domination et de pouvoir. Ce subtil équilibre va être progressivement remis en cause au XVIIIème siècle où va se développer une approche plus mercantiliste et financière de la dette. Le crédit devient ainsi une opération commerciale et la dimension sociale de ce dernier est totalement occultée. Le XXème siècle inscrit définitivement la dette comme une opération financière et commerciale dans laquelle le créancier attend désormais un rendement.
A contrario, dans nos sociétés modernes, un double mouvement se fait sentir.
D’un côté, nous faisons face à un développement sans précédent de droits subjectifs, dont la liste ne cesse de s’accroître au fur et à mesure des revendications sociales et des avancées sociétales, à tel point que l’on a tendance à confondre « les droits à » avec « les droits de ». Raymond Aron faisait la juste distinction entre les droits-créances et les droits-libertés. Nul doute que les droits-créances prennent le dessus sur les droits-libertés. Cette évolution de la conception des droits de l’homme pousse de plus en plus à la communautarisation de la société et non à son bien commun. Notre société moderne oublie que l’individu est un être de devoirs avant d’être une personne bénéficiant de droits. Justement, la création de tous ces droits constitue un chèque en blanc pour la génération future dans la mesure où, ces droits étant constitutionnellement garantis, leurs bénéficiaires peuvent demander réparation monétaire pour violation ou pour non-exécution de ces derniers. Un rééquilibrage s’avère plus que jamais nécessaire.
De l’autre côté, la crise de l’endettement n’est que le reflet le plus global de la crise des pays occidentaux dans un monde globalisé qui leur échappe. La crise économique qui frappe le monde depuis 2008, et celle qui suivra la Covid-19 mettent en exergue les tensions structurelles de la société occidentale : « cupidité, égoïsme et individualisme ». Ce relativisme permanent, qu’il soit politique, culturel et moral, correspond au nihilisme défini par Nietzsche. En d’autres termes, nous assistons à l’abandon de la confrontation au réel avec ses troubles et ses interrogations pour la fuite dans un monde fictif fondé sur des valeurs de circonstances et utilitaristes qui justifient tout et suppriment le doute. Cette crise que traverse la société s’illustre particulièrement dans le phénomène de financiarisation de la dette. En ce sens, la crise des subprimes de 2008 a parfaitement démontré que, sans mise en place de garde-fou par l’État, le marché était incapable de s’auto-réguler.
Vous rappelez que la dette a été un champ d’analyse tant pour le religieux, la sociologie, l’économie et le droit. Or vous rappelez que la financiarisation de la société et les différentes crises économiques, financières ou politiques ont profondément érodé l’inscription de la dette dans un rapport de confiance entre créancier et débiteur. Surtout, vous dressez les traits d’une théorie d’une « dette juste », là où elle est le plus souvent associée aujourd’hui à des rapports d’inégalité et de domination. Pourriez-vous revenir sur ce concept, absent des disciplines précitées, et en esquisser les traits ?
Il n’existe pas de doctrine de la dette juste. Aucun juriste, aucun philosophe ne s’est aventuré à esquisser une définition de la juste dette. Pourtant, à mon sens, une telle doctrine serait nécessaire parce qu’elle permettrait de tracer les limites entre une dette juste et injuste, celle qui est légitime et celle qui ne l’est pas, celle qui oblige et celle qui autorise à ne pas s’obliger. Aborder la notion de dette juste, c’est se placer tant du côté du débiteur que du créancier.
Pour le débiteur tout d’abord, la dette juste est celle qui ne lui fait pas supporter une charge trop lourde mais, au contraire, un poids supportable, c’est-à-dire qui ne place pas le débiteur dans une situation où le remboursement de sa dette devient impossible sauf à aliéner une partie de sa condition humaine. Cette définition vaut pour n’importe quel type de dette, qu’elle soit écologique, monétaire voire parentale. C’est en ce sens que l’usure n’est pas juste puisque cette dernière contraint le débiteur à une situation de dépendance extrême vis-à-vis de son créancier et le conduit à s’appauvrir ou le maintenir dans une situation de précarité. La dette juste est aussi la dette dont les échéances sont remboursées aux termes convenus, même si cela conduit à des sacrifices et qu’il faut vendre une partie de son patrimoine ou diminuer son pouvoir d’achat. En définitive, le débiteur juste est celui qui place son engagement vis-à-vis de son créancier comme une obligation non seulement juridique mais également morale et humaine.
Quant au créancier juste, ce dernier doit tenir compte des difficultés de l’emprunteur et aménager le remboursement de sa créance, voire même consentir un abandon de sa créance, afin qu’il puisse supporter la dette.
Encore faut-il définir ce qui est juste. L’objet de ce livre est de démontrer que la dette n’est pas simplement une valeur d’échanges contractualisée. Comme évoquée ci-dessus, la dénaturation du rapport créancier/débiteur à travers une substitution du lien social par un lien purement financier a mis à mal l’acceptabilité sociale de la dette. Pour aider à la construction d’une notion de dette juste, il faut, à mon sens, se tourner vers la notion de juste prix, élaborée par la philosophie grecque notamment Aristote puis par les théologiens médiévistes, en particulier Saint Albert le Grand et Saint Thomas d’Aquin.
En s’appuyant sur les concepts aristotéliciens de justice distributive et de justice commutative, le juste peut être défini « tout en étant une sorte d’égal, et l’injuste une forme d’inégal, n’est pas cependant l’égal selon la proportion géométrique mais selon la proportion arithmétique, car la loi n’a d’égard dans les transactions privées qu’au caractère distinctif du tort causé ». Dit autrement, la règle qui définit les prix et qui les définit comme justes traite à égalité les deux parties de l’échange qui, du point de vue distributif, sont cependant inégales. C’est sur cette base conceptuelle que la doctrine chrétienne du juste prix s’est développée.
La doctrine du juste prix doit ainsi concilier à la fois la justice commutative, soit l’équité dans les échanges, et la justice distributive, la juste répartition des richesses au sein de la communauté. Pour la doctrine chrétienne, seul un prix déterminé en fonction de la valeur objective des choses et résultant de choses communes permet d’aboutir à un juste prix.
À la lumière de ces éléments, une dette juste est donc une dette qui, non seulement enrichit son créancier, mais aussi son débiteur, monétairement, moralement, historiquement et sociologiquement. Dans une dette juste, le débiteur doit s’enrichir de ce qu’il doit rembourser. En d’autres termes, le remboursement au créancier doit conduire à ce que les débiteurs reçoivent plus que ce qu’il doit rembourser. Cet enrichissement ne doit pas être simplement entendu comme un enrichissement financier, il peut prendre différentes formes selon le type de dette. Ainsi, le débiteur s’enrichit des générations passées, de l’histoire de sa communauté, du respect de ses propres engagements et, de manière plus contemporaine, de la conservation de la nature. Réciproquement, une dette juste est une dette pour laquelle le créancier se place dans une logique de justice distributive acceptant dans certaines circonstances de procéder à une remise partielle ou totale de sa créance.
Il s’agit de dépasser la justice procédurale, source d’inégalités, et d’aller vers une justice équitable, encore parfois appelée justice organisationnelle.
En définitive, je propose une grille de lecture de ce que peut constituer une dette juste pour les différents types de dette déjà évoqués. L’essai n’est pas un livre de recettes miracles ; il suggère des critères d’appréciation de ce que constitue une dette juste et permet, tant au créancier qu’au débiteur, de s’interroger sur le sens de sa dette. Et si la dette est injuste, d’en tirer les conséquences, y compris juridiques, conduisant pourquoi pas à une nullité de l’engagement ou, à tout le moins, à la possibilité pour le débiteur de ne pas rembourser une dette injuste ; et le devoir pour le créancier de ne pas exiger le paiement de ce type de dette. En attendant une reconnaissance juridique de cette notion de dette juste, chacun reste libre d’apprécier dans la situation qui est la sienne et sous le regard de l’autre la dette dont il est tributaire.
Face à la récession mondiale causée par la pandémie et du double choc fiscal qu’elle a entraîné (avec une hausse des dépenses publiques et une baisse des recettes), des voix se sont élevées en faveur de l’annulation ou du moins de la restructuration de la dette des pays africains notamment. Le moratoire du service de la dette pour 77 pays, annoncé le 15 avril 2020 par les ministres des finances du G20, a répondu au moins partiellement aux problèmes de liquidité que rencontraient les pays les plus pauvres. Que faut-il penser de cette situation et – de manière connexe – d’un possible retour des dettes perpétuelles ?
Tout d’abord, les annonces du G20 ne portent que sur le paiement des intérêts, et non sur le remboursement du principal. Ce n’est pas là une réponse appropriée au regard de la situation d’endettement de certains pays conduisant à considérer que certaines de ces dettes ne sont plus justes.
Ensuite, la dette souveraine se distingue de la dette privée dans la mesure où, c’est l’ensemble des citoyens, et pas uniquement les contribuables, qui est concerné par le niveau d’endettement, du fait des impacts du niveau d’endettement sur la société. La dette souveraine, par rapport aux dettes privées, a cette particularité que les payeurs ne sont pas ordonnateurs de la dette. La relation à la dette s’en trouve alors profondément modifiée puisque le débiteur (l’État) est certes contractant à la dette mais il n’est pas au final le payeur (le contribuable) de la dette. D’habitude, dans une relation de dette monétaire, il s’agit d’une relation bilatérale et réciproque. En matière de dette publique, il s’agit d’une relation à trois : les créanciers, le débiteur et les payeurs. Néanmoins, émettre de la dette souveraine est un attribut de la souveraineté. Il en découle que la dette publique jouit d’un régime juridique particulier même si ce dernier tend de plus en plus à disparaître. Par exemple, l’immunité d’exécution est réduite à la portion congrue. L’émission de la dette soumis à son propre droit n’est qu’une réalité que pour une poignée d’États à tel point que de nombreux États se retrouvent soumis le plus souvent au droit de l’État de New York et se mettent entre les mains des juges étrangers, nouvelle forme de colonisation par la justice occidentale. Cette question a d’ailleurs fait l’objet d’un long contentieux entre certains fonds d’investissement et la République d’Argentine. Paradoxalement, une puissance publique ne peut être en faillite, il n’existe pas de définition juridique d’une faillite d’un État.
Dans cette logique, la recherche logique d’une restructuration de la dette souveraine a pris le pas sur l’approche purement contractuelle sur le strict respect des stipulations des contrats d’émission. Ce paradigme part de l’idée que seul l’aménagement entre créanciers et débiteurs permet au pays endetté de repartir sur des bases nouvelles et saines lui permettant de rembourser une partie de ce qu’il doit. Néanmoins, cette restructuration de la dette a un coût, elle s’accompagne bien souvent de mesures budgétaires drastiques imposées par les créanciers pour que les pays endettés effectuent des réformes jugées indispensables pour permettre un remboursement selon un calendrier précis de la dette restructurée. Il s’agit, en quelque sorte, d’une punition (dette = faute : die Schuld et l’analyse de Nietzsche). Le trinôme de la dette publique a comme conséquence que ce sont les populations les plus pauvres qui trinquent. Si on prend l’exemple de la Grèce, c’est toute sa société dans son ensemble qui a subi les conséquences des mesures imposées par les institutions internationales. Ce qui manque ici, c’est l’altérité dans le traitement de la dette. Ne pas s’arrêter aux ratios d’endettement, être capable de solidarité, y compris en prenant des actes forts par les créanciers, comme prononcer l’annulation d’une partie de la dette. En fait, c’est vers un nouveau Jubilée des dettes souveraines que nous devrions tous converger, comme celui de l’année 2000 avait essayé de le faire, avec un engouement inversement proportionnel au résultat obtenu. Le prochain Jubilée pourrait être celui de 2025, au moment où le monde en aura le plus besoin compte tenu des effets économiques de la crise du Covid-19.
Pourtant, on entend de plus en plus de voix proposer des solutions radicales : ne convient-il pas de répudier la dette existante en refusant de la rembourser ? Ou bien, continuer à s’endetter sans limite puisque les taux d’intérêts sont négatifs et que la charge de la dette n’a jamais été aussi faible et qu’il suffit de voir dans la dette un seul flux de paiement des intérêts, sans se préoccuper du principal ? Dans les deux cas, il s’agit de la manifestation du refus de l’idée même de la dette, comme évoqué plus haut. Une autre illustration de cette attitude réside dans l’idée qu’à défaut de pouvoir rembourser la dette souveraine, il suffirait de la transformer en dette perpétuelle. Dans ce cadre, les créanciers donneraient leur accord pour ne pas être remboursés et ne recevoir que des intérêts (comme une rente). Si on suit la logique développée par certains, le principal créancier des dettes souveraines de la zone euro étant la Banque Centrale Européenne, il « suffirait » de convertir le stock de dette dans son bilan par une nouvelle dette perpétuelle pour que la question du remboursement ne se pose plus. Mais une dette perpétuelle est un oxymore financier puisqu’il est question d’une dette mais aussi d’éternité, du moins, en théorie. Car si les États ont une durée de vie plus longue que les humains, ils ne sont, eux non plus, pas éternels. Une dette non remboursable n’est pas une dette, le principe même d’une dette reposant sur l’obligation de remboursement au créancier. Les économistes en faveur de cette solution avancent de nombreux arguments pour essayer d’emporter la conviction, mais tous pêchent sur un point capital : la mesure de la défiance suite à cette conversion en dette perpétuelle : si même l’Etat ne rembourse plus ses dettes, pourquoi vous et moi serions alors obligés de rembourser nos dettes et de nous saigner à blanc ?
À mon sens, la dette perpétuelle est une chimère juridique et une bombe à retardement pour les générations futures. Seule une approche de justice distributive permettra de résoudre la question de la dette, y compris souveraine.
Sources
- Pour rappel, l’article 140 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne prévoit une situation des finances publiques jugée « soutenable », et un budget ne présentant pas de « déficit excessif », précisé dans le Protocole n°12 comme un déficit public annuel ne devant pas excéder 3 % du produit intérieur brut (PIB), et la dette publique (de l’Etat et des agences publiques) 60 % du PIB. Certes, depuis 1992, de l’eau a coulé sous les ponts, et le Pacte budgétaire européen, aussi appelé traité sur la stabilité, la coordination et la croissance (TSCG), prévoit des règles de gouvernance économique et budgétaire et fixe une « règle d’or budgétaire » : les pays s’engagent à voter chaque année des budgets en équilibre ou en excédent. Les objectifs de 3 % et 60 % sont maintenus, mais l’enjeu principal est précisé : le déficit structurel ne doit plus dépasser 0,5 % du PIB (ou 1 % pour les pays dont la dette ne dépasse pas 60 % du PIB).
- Dernier exemple, l’arrêt qui consacre le droit pour un Etat membre de refuser des soins médicaux dès lors que ce refus est justifié par la nécessité de protéger l’équilibre financier du système de santé national : CJUE, 29 oct. 2020, affaire C-243/19, A contre Veselības ministrija (ministère de la santé, Lettonie).
- Cons. const. 6 juillet 2018, M. Cédric H et autre, n° 2018-717/718 QPC : https://www.conseil-constitutionnel.fr/decision/2018/2018717_718QPC.htm
- M. Borgetto, « Fraternité et Solidarité : un couple indissociable ? », in : Solidarité(s) : Perspectives juridiques, Presses de l’Université Toulouse 1 Capitole, 2009, ISBN : 9782379280023.
- P.E., Rapport sur la faisabilité de l’introduction d’obligations de stabilité, 6 déc. 2012 : https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-7-2012-0402_FR.html
- Cf. Assemblée Nationale, Rapport d’information portant observations sur le projet de loi autorisant l’approbation de la décision (UE, Euratom) 2020/2053 du Conseil du 14 décembre 2020 relative au système des ressources propres de l’Union européenne, 19 janv. 2021 : https://www.assemblee-nationale.fr/dyn/opendata/RINFANR5L15B3775.html#_Toc256000014

