Historiciser l’agir climatique
En matière de changement climatique, les sociétés occidentales ne sont pas nées de la dernière pluie. Dès l’époque moderne, le changement climatique a en réalité été pour elles une préoccupation centrale. C’est cette longue histoire des interrogations et des réponses scientifiques et politiques face aux « révoltes du ciel » que Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher se proposent de retracer.
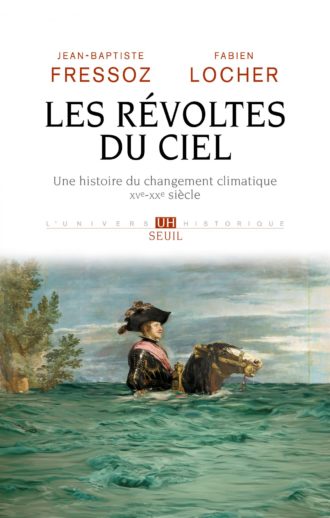
Avec les Grandes découvertes émerge la croyance en « l’agir climatique » humain. Les premiers colons qui se heurtent à un climat peu hospitalier doivent trouver des arguments pour recevoir les soutiens de la métropole. Ainsi, auprès de la couronne et des compagnies marchandes espagnoles, Christophe Colomb prétend améliorer le climat jamaïcain en abattant des pans entiers de forêts, car, selon une théorie déjà ancrée à l’époque, l’arbre attire les nuages et donc la pluie. Partant, il est responsable des pluies diluviennes qui font obstacle au projet colonisateur. Dans le même temps apparaît un discours qui stigmatise les indigènes, tenus pour responsables, par leur paresse et leur inculture, de l’inhospitalité de leurs terres. Au cœur même de cette prise de conscience des effets de l’action humaine sur le climat se trouve donc cette distinction entre « eux » et « nous », distinction que l’on retrouve dans tous les contextes coloniaux jusqu’au XXe siècle ainsi que dans le contexte de la France révolutionnaire, quand les élites révolutionnaires dénoncent l’exploitation abusive des forêts nationales par les paysans. Fabien Locher et Jean-Baptiste Fressoz invitent ainsi le lecteur du XXIe siècle à se méfier de la propension à accuser un groupe d’être responsable de la dégradation du climat, car une telle accusation est bien souvent un instrument de pouvoir qui ne dit pas son nom. Dans le débat actuel sur le droit d’ingérence écologique par exemple, cette perspective historique permet de prendre le recul nécessaire pour ne pas taxer trop vite d’incompétence les pays qui sembleraient peu actifs dans la lutte contre le changement climatique et de justifier ainsi une restriction des droits d’un État sur son territoire. Inversement, quand, en août 2019, Jair Bolsonaro accuse Emmanuel Macron de « colonialisme » sur Twitter, après que ce dernier a dénoncé l’impéritie du président brésilien face à la « crise internationale » que constitue la dévastation de l’Amazonie par le feu, il se sert efficacement d’un pan important du passé colonial de la France (en Algérie française, le discours sur le déclin climatique servait à justifier l’expropriation des communautés algériennes et à étendre la mainmise de l’administration coloniale sur les forêts) pour discréditer son ennemi politique.
La France, d’abord métropolitaine puis coloniale, est en effet l’un des théâtres principaux de cette histoire globale. La démocratie représentative y est née dans l’angoisse du changement climatique, car les catastrophes climatiques (hivers longs et froids, étés pluvieux…) y ont été nombreuses au tournant des XVIIIe et XIXe siècles, au cours de ce que les historiens appellent communément, depuis les travaux d’Emmanuel Le Roy Ladurie, « le petit âge glaciaire ». Fidèles en cela à certaines thèses du naturaliste Buffon, selon qui l’histoire de la Terre est celle d’un refroidissement progressif et global contre lequel l’homme doit lutter, plusieurs personnalités révolutionnaires, des députés notamment, accusent tour à tour l’Ancien régime et les paysans de dérégler le climat français en portant atteinte aux forêts. À l’inverse de l’époque précédente, c’est bien la déforestation qui est pointée du doigt. Cet épisode révolutionnaire initie plusieurs décennies de luttes au sein de l’espace politico-médiatique français, au gré des crises climatiques et des émeutes frumentaires. Les débats au sein des assemblées législatives sont houleux, et les controverses scientifiques s’enchaînent. C’est à cette époque troublée que des idées et concepts sont inventés pour mettre en place de véritables politiques environnementales. Les deux historiens analysent ainsi la circulaire n°18, qui, en 1821, ordonne aux préfets de collecter le plus d’informations possible pour confirmer ou infirmer l’hypothèse d’un refroidissement climatique depuis la Révolution : pour la première fois, le changement du climat devient l’objet d’une enquête publique nationale.
Cette histoire recoupe largement l’histoire des sciences, mises au défi de rendre raison de ces « révoltes du ciel ». Mais le sujet est brûlant en ce qu’il touche au plus près la vie des populations : les travaux scientifiques répondent donc à une demande sociale et politique pressante. Ce champ scientifique peine donc à se constituer, même si l’idée d’un Dieu tantôt clément, tantôt vengeur, encore profondément ancrée du temps de Christophe Colomb, pour qui Dieu sanctifiait l’œuvre colonisatrice en rendant le climat américain tempéré, laisse place à une étude centrée sur les phénomènes physiques et chimiques. Ceux qui prétendent connaître les causes du changement climatique défendent plutôt la conception d’une science pour et par le peuple, conception qui trouve un certain écho en France, dans la première moitié du XIXe siècle. François-Antoine Rauch est alors l’archétype de l’entrepreneur de cause militant pour la reforestation, du lanceur d’alerte médiatique dont les idées sont largement relayées par la presse, qui fait l’apologie d’une science empirique, historique et populaire et qui exerce une véritable influence sur le monde politique. Toutefois, les caprices du climat sont tels que les observations empiriques donnent souvent des résultats contradictoires, comme en témoigne le destin de la circulaire n°18, enterrée du fait de son inintelligibilité. Parallèlement, des scientifiques éminents sont de plus en plus soupçonnés de politisation : ainsi François Arago, célèbre astronome, « le patron de la science française » qui intervient publiquement auprès des députés en 1836 pour les dissuader de voter la suppression de l’autorisation administrative de défrichement, au motif que la déforestation pourrait peut-être nuire à l’équilibre des climats, est discrédité du fait de ses convictions républicaines. C’est pourquoi la promotion d’une science ouverte aux observations de tous les Français cède bientôt la place à l’apologie de l’expertise en la matière. D’une part, des scientifiques tels que Moreau de Jonnès, directeur de la Statistique générale de la France, font désormais tout pour dépassionner le débat et pour fonder une météorologie rigoureuse. Les observateurs sont alors réduits à de simples producteurs de nombres et les outils d’analyse sont perfectionnés D’autre part, d’autres sciences (la paléontologie, la stratigraphie, l’étude des âges glaciaires) s’approprient l’étude de l’évolution des climats sur longue période et insistent de plus en plus sur la lenteur des évolutions que les hommes perturbent à peine voire pas du tout. Par exemple, le botaniste Adolphe Brongniart démontre en 1822 que certaines plantes fossiles découvertes en Europe relèvent d’une végétation tropicale ; mais l’étude des couches géologiques sous-terraines montre que le carbonifère date de quelques centaines de millions d’années… Voilà donc que la science réfute « le paradigme de l’agir climatique » sur la base lequel s’étaient crispées les peurs et les tensions relatives aux dérèglements du climat, ce qui va se révéler lourd de conséquences.
Si l’on a pu croire à tort que l’essor relativement récent de la conscience écologique dans les sociétés occidentales était une réaction à une modernité indifférente au changement climatique, c’est qu’entre-temps, à partir de la deuxième moitié du XIXe siècle en métropole et à partir de la deuxième moitié du XXe siècle dans les mondes coloniaux, l’angoisse face aux transformations du climat s’est effectivement estompée. Non seulement parce que le climat est devenu plus clément et les disettes plus rares, parce que l’arbre, que l’on considérait comme la variable principale du changement climatique, perd sa centralité dans les sociétés industrielles, parce que les scientifiques imposent l’idée que les changements climatiques s’étalent sur des périodes très longues excédant de très loin une vie humaine, mais surtout parce que les progrès technologiques et économiques des sociétés occidentales ont engendré une forme d’apathie face aux risques climatiques. Car le climat n’est plus l’enjeu vital qu’il était, du temps où le spectre de la famine se profilait derrière le dérèglement des saisons. L’homme s’est enorgueilli de sa puissance technique qui lui confère une capacité d’adaptation inédite.
Le récit de Jean-Baptiste Fressoz et Fabien Locher s’arrête à ce moment où les sociétés industrielles ont voulu se croire invulnérables : le réveil écologique de la fin du XXe siècle, dont les auteurs ne traitent pas, retrouve ainsi sa juste place au sein de la longue histoire des tumultes engendrés par les « révoltes du ciel ». Le mythe d’un mouvement écologique s’insurgeant contre des siècles d’exploitation abusive et inconsciente de la nature, d’une unique « rupture à l’intérieur de la modernité » (Ulrich Beck, La société du risque) se trouve dès lors ébranlé. Le progrès pensé par les sociétés modernes l’a été conjointement avec ses effets sur le climat ; l’amélioration du climat était même considérée comme l’une des dimensions du progrès. Pour autant, il est certain que les sociétés occidentales sont sorties de l’apathie écologique à laquelle elles s’étaient abandonnées, car la découverte de l’effet de serre a réactualisé « le paradigme de l’agir climatique ». Encore une fois, c’est la science qui se trouve au cœur d’un processus complexe de prise de conscience écologique. Et comme autrefois, les angoisses climatiques se retrouvent sur le devant d’une scène publique élargie récemment par les réseaux sociaux, vastes chambres d’écho relayant les peurs liées au changement climatique. Si le réchauffement climatique ne met pas immédiatement nos vies en péril, la peur de l’apocalypse climatique s’est propagée au sein d’une sphère publique internationale active. Mais, au regard de l’histoire de nos sociétés, nous vivons aujourd’hui une situation éminemment paradoxale : alors que la certitude que le changement climatique a en partie une origine humaine est désormais très répandue, alors que le changement climatique et ses causes humaines n’ont jamais été autant mesurés, chiffrés, expliqués, l’angoisse que le réchauffement climatique suscite ne trouve pas de traduction politique aussi immédiate et résolue qu’autrefois, d’où une défiance croissante des environnementalistes envers leurs gouvernements successifs. Certes, l’impératif de lutte contre un effet de serre global excède la seule capacité des États. Sans doute est-ce lié aussi au « désencastrement » de l’économie, selon la fameuse expression de Karl Polanyi, dont le fonctionnement est moins dépendant des choix politiques des États. Surtout, aujourd’hui, les sociétés occidentales ne sont plus les seuls maîtres de l’Histoire et elles ne sont plus les seules à modifier en profondeur le climat. Or, les nouvelles puissances ne partagent pas les mêmes préoccupations climatiques des démocraties représentatives naissantes à la charnière des XVIIe et XVIIIe siècles. Et elles regardent d’un mauvais œil les réprimandes que leur adressent des puissances occidentales car elles rappellent à certaines d’entre elles la superbe du colonisateur.
Le livre nous rappelle enfin que l’anxiété des sociétés face au changement climatique demeure fragile. Si le paradigme de l’effet de serre fournit une base solide à la réflexivité, le climato-scepticisme contemporain montre que cette dernière n’est pas totalement acquise. En outre, le progrès technique pourrait peut-être, avec le temps, en permettant aux hommes de s’adapter aux variations des températures, à nouveau, apaiser plus qu’il ne faut les esprits inquiets.

