Les temporalités de François Hartog
Florian Louis a interrogé François Hartog à propos de son dernier livre Chronos.
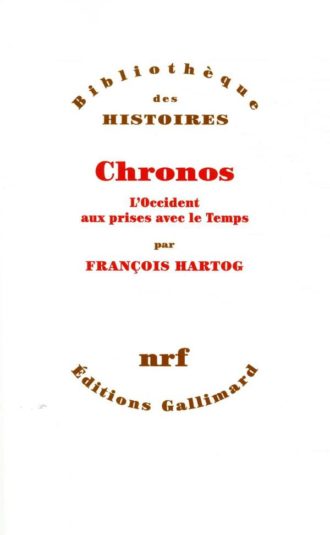
Dans votre dernier ouvrage, Chronos, qui vient de paraître aux éditions Gallimard, vous poursuivez l’investigation entamée il y a dix-sept ans dans Régimes d’historicité sur l’évolution de notre rapport au temps. Dans les deux ouvrages, vous prenez le parti d’aborder cette question par le biais des « crises » ou des « brèches » qui, par moment, affectent le cours du temps. Qu’entendez-vous par là et pourquoi privilégier cette porte d’entrée dans le sujet plutôt, par exemple, que de procéder à une présentation typologique des différents régimes d’historicité ?
Je n’ai jamais cherché à écrire un traité sur le temps ou une histoire du temps, même pas une histoire philosophique du temps comme celle qu’avait faite Krzysztof Pomian dans son grand livre sur l’« ordre du temps ». Ma question, depuis que je m’intéresse au temps, a toujours été : que se passe-t-il aujourd’hui, dans mon contemporain ? Je suis parti, il y a maintenant près de vingt-cinq ans, d’une interrogation sur ce qu’il en est de notre rapport au temps. C’est cette question initiale qu’au fond, j’ai reconduite jusqu’aujourd’hui. Il était clair qu’il y avait une interrogation, une perte d’évidence des repères, que la manière d’articuler, d’ordonner les unes par rapport aux autres les catégories du présent, du passé et du futur avaient perdu de leur évidence antérieure. C’est cela que j’appelle une crise du temps. Pour la diagnostiquer, je m’étais servi des travaux de Hannah Arendt autour de ce qu’elle appelle les « brèches » (gap) du temps, soit les moments de remise en question que sont juillet 1789 ou la Résistance en France ou 1956 en Hongrie. Pourquoi ces moments ? Parce qu’ils sont particulièrement révélateurs. Par le trouble qui s’installe, ce qui paraissait évident, par exemple la domination de la catégorie du futur dans ce que j’ai appelé le régime moderne d’historicité (qui s’est mis en place dans le monde occidental à la fin du XVIIIe et a duré jusqu’au dernier quart du XXe siècle), devient problématique. Une mise en question qui s’est traduite, à la fin des années 1970 et au début des années 1980, par l’expérience partagée de plus en plus largement d’un avenir qui se fermait. Ce qui paraissait acquis, à savoir qu’on marchait vers un avenir porteur de progrès, tout d’un coup, perdait sa forte évidence. Simultanément, on a vu une montée de la catégorie du présent, qui a rapidement tendu à cannibaliser les autres catégories, celles du passé et du futur, pour venir s’installer en position omnipotente. Ces moments de crise, de brèche entre ce qui n’est plus et ce qui n’est pas encore, sont difficiles à vivre, mais, pour qui essaye de comprendre ce qui est en train d’advenir, ils sont particulièrement révélateurs. Michel de Certeau a cette formule que je rappelle au début de Chronos selon laquelle une société « dit ce qu’elle est en train de construire avec les représentations de ce qu’elle est en train de perdre ». C’est de ce décalage, de ce déphasage, dont la brèche temporelle est une manifestation. On ne sait pas comment dire ce qui advient puisqu’on n’a pas les mots pour le dire et que les seuls mots dont on dispose sont ceux qui viennent, pour employer une expression du jour, du « monde d’avant ». Ce sont toujours ces moments d’instabilité, de discordance, de désaccord, de faille qui m’intéressent particulièrement : les crises du temps.
Ce sont toujours ces moments d’instabilité, de discordance, de désaccord, de faille qui m’intéressent particulièrement : les crises du temps.
François Hartog
Dans Chronos, vous vous appuyez précisément sur des mots provenant d’un monde d’avant, de très longtemps avant : la Grèce. Un trinôme conceptuel charpente en effet toute la réflexion que vous déployez dans cet ouvrage : Chronos, Kairos et Krisis. Quel sens donnez-vous à chacune de ces trois notions et quels rapports établissez-vous entre elles ?
Essayant de saisir ce qu’il en était du temps aujourd’hui, j’ai fait, comme j’aime bien le faire, un grand pas en arrière vers les temps les plus lointains. C’est ce que j’avais pratiqué dans Régimes d’historicité en partant d’Ulysse et de ce moment fondateur de la rencontre chez les Phéaciens avec le barde. Justement quand Ulysse n’a pas encore les mots pour dire le passé. Non pas qu’il ne sache pas ce qu’il a fait la veille, mais le passé comme tel, son concept, n’est pas à sa disposition, si bien qu’il n’arrive pas à relier l’Ulysse qu’il était lors de ce moment glorieux que fut la prise de Troie et le « pauvre type » qu’il est aujourd’hui, qui a tout perdu jusqu’à son nom. C’est lors de ce moment exceptionnel au cours duquel l’aède chante la prise de Troie, la ruse du cheval de bois, qu’Ulysse parvient finalement à relier les deux en disant « c’était moi, c’est moi ». C’est ce que j’ai appelé la découverte de l’historicité, c’est-à-dire cette non-coïncidence principielle de soi à soi. Tel a été le point de départ du concept de « régime d’historicité ». Dans Chronos, il m’est apparu que, pour comprendre ce qu’il en était du temps dans ce qui est devenu le monde occidental, il n’était pas possible de ne pas s’arrêter longuement sur le temps chrétien. J’ai donc essayé d’abord d’établir ce qu’on peut définir comme le régime chrétien d’historicité, ce qui m’a amené à lire tous les premiers textes du christianisme et même, un peu plus loin en amont, les principales apocalypses juives.
Or, la manière d’appréhender le temps dans ces textes met en œuvre trois concepts : Chronos, Kairos et Krisis. Trois concepts grecs, qui sont passés au monde de la Bible au moment de la traduction de la Bible en grec à Alexandrie à partir du IIIe siècle avant notre ère, qui donne naissance à la Septante. Le choix de ces concepts est intéressant et plus encore l’usage qu’en font les chrétiens, qui n’est pas le même que celui qu’en faisaient les Grecs. Dans le monde grec classique, le couple principal est celui formé par Chronos – le temps ordinaire, le temps de la vie, le temps qui s’écoule – et Kairos – l’instant décisif, l’occasion à saisir. En Grèce, c’est la combinaison de Chronos et Kairos qui permet de penser l’action. Une action réussie, c’est une action qui sait conjoindre Chronos et Kairos. Krisis – le jugement, qui vient trancher un différend, inscrit dans le temps un avant et un après – a lui été surtout mobilisé, dans la Grèce ancienne, par la médecine hippocratique. L’art du médecin consiste, en effet, à reconnaître le rythme de la maladie et, en particulier, à identifier les « jours critiques », ceux qui peuvent voir la maladie basculer vers une issue fatale ou vers la guérison. Il s’agit bien d’une sorte de jugement. C’est fort de ce savoir que le bon médecin peut agir « au bon moment ». On retrouve le concept de Kairos.
L’art du médecin consiste, en effet, à reconnaître le rythme de la maladie et, en particulier, à identifier les « jours critiques », ceux qui peuvent voir la maladie basculer vers une issue fatale ou vers la guérison. Il s’agit bien d’une sorte de jugement. C’est fort de ce savoir que le bon médecin peut agir « au bon moment ».
François Hartog
En quoi l’usage chrétien de ces trois concepts diffère-t-il de celui qu’en faisaient les Grecs ?
Quand ces trois concepts se trouvent mobilisés par les traducteurs de la Bible, ils changent en même temps qu’ils entrent dans un autre univers. Chronos continue à exister sous la forme du temps ordinaire, du temps des saisons, du temps des labours, du temps de la vie. Kairos lui, quitte le monde du moment opportun pour prendre une force beaucoup plus grande et se rapprocher de Krisis qui, lui-même, se trouve absolutisé pour désigner, dans une perspective apocalyptique, le Jugement par excellence, le Dernier : celui qui solde tous les comptes, met fin au monde tel qu’il était, mais aussi ouvre sur un monde tout autre, celui du Royaume sans fin. Dans les apocalypses juives, comme dans le livre de Daniel par exemple, Kairos va être comme attiré par Krisis et désigner l’arrivée de ce temps nouveau. Les premiers chrétiens, cette petite secte apocalyptique juive, vont reprendre ces trois concepts mais vont leur donner une portée différente. Chronos va demeurer le temps ordinaire, Krisis, le Jugement, va également garder la même acception, seul Kairos va se déplacer. La grande nouveauté chrétienne, c’est ce déplacement : Kairos va désigner le moment de l’Incarnation. En s’incarnant Jésus entre dans le temps Chronos (avec une naissance et une mort). Ce moment-là devient le moment central : le Kairos avec majuscule.
Pourquoi ce parcours qui pourrait sembler un long détour nous éloignant de la question initiale sur quel temps aujourd’hui ? Parce qu’en Europe le temps moderne est sorti, à tous les sens du terme, du temps chrétien. Il en vient et il l’a quitté. Il n’est donc pas inutile de retracer comment s’est construit le temps chrétien, sachant qu’il s’est peu à peu imposé au fur et à mesure de la montée en puissance de l’Eglise et qu’il est resté le cadre, l’armature des représentations du temps jusqu’à la fin du XVIIIe siècle. Avant d’être vécu comme un carcan. J’ajouterais une raison annexe : c’est une occasion de « relire » ces premiers textes du christianisme qui ont largement disparu de notre horizon. L’examen de la façon dont les chrétiens ont mobilisé les trois concepts m’a permis de définir le régime chrétien d’historicité comme un présentisme apocalyptique. Cela signifie qu’entre l’Incarnation, qui devient le temps fondateur, et la fin, le moment du Jugement – apocalypse et Parousie dans le langage chrétien – entre ces deux moments, on a, au fond, du présent : rien que du présent. C’est-à-dire un temps qui n’a pas de consistance propre ni vraiment d’importance puisque ce qui compte, c’est de se convertir et d’espérer pour le plus tôt possible ce moment terminal. C’est un présentisme, car il n’y a que du présent. Et un présentisme apocalyptique puisque l’issue, l’horizon, est celui de l’apocalypse. Il suffit de lire l’Apocalypse de Jean ou les épîtres de Paul pour s’en convaincre.
L’examen de la façon dont les chrétiens ont mobilisé les trois concepts m’a permis de définir le régime chrétien d’historicité comme un présentisme apocalyptique.
François Hartog
Ce présentisme chrétien est-il de même nature que le présentisme contemporain dont vous avez mis en évidence l’existence ?
Ce présentisme premier, initial, chrétien, est pris entre les deux concepts de Kairos et de Krisis. C’est un temps que les pères de l’Église ont désigné, en latin, comme un temps intermédiaire (media aetas). Que Pétrarque ait choisit de désigner la période qui est devenue le Moyen-Âge justement comme « temps intermédiaire » montre qu’il voyait le retour à l’antiquité comme l’ouverture d’un temps entièrement nouveau. Comment vivre ce temps pris entre Kairos et Krisis ? La réponse est donnée par Paul : oubliant ce qui est derrière, le chrétien doit être tendu vers ce qui est devant. Ce présent a deux bornes : l’Incarnation et la Parousie. Ce qui veut dire que le temps chrétien est pris entre ces deux bornes. L’Incarnation devient la date pivot, tandis que la question de la date de la Création perd de son importance. Le point essentiel est que l’Incarnation marque l’entrée dans un temps nouveau qui est aussi le dernier. Avec elle commence le temps de la fin, annonçant la fin des temps. C’est là un élément essentiel, dont on trouve la pleine expression chez Augustin lorsqu’il affirme que « le monde est entré dans sa vieillesse ». L’Incarnation pour Augustin, c’est le début du temps de la fin et si on se convertit, alors on a une chance d’être accueilli dans la cité de Dieu.
Telle est la structure à laquelle ne peut échapper le temps chrétien, même s’il l’a largement oublié aujourd’hui. Il y a bien sûr toujours des chrétiens mais ils ne se demandent pas tous les matins « à quand l’Apocalypse ? », en étant persuadés d’être dans la vieillesse du monde. Le présentisme contemporain présente, quant à lui, une tout autre texture. Il est sorti d’une mise en question du futur, du temps moderne comme marchant vers le progrès et n’est donc pas du tout inscrit entre ces deux (anciennes) bornes. Il est pour ainsi dire tellement centré sur son nombril qu’il ignore toute interrogation sur un début et une fin et qu’il fabrique à chaque instant le passé et le futur dont il a besoin. Ce présentisme a été considérablement nourri et accru par la révolution informatique qui, je crois, est foncièrement présentiste par suite de la simultanéité et de l’instantanéité qui sont sa marque de fabrique. Ce présentisme est très différent du présentisme chrétien. Ce qui n’interdit, évidemment pas, au contraire même, de chercher, en le confrontant au présentisme chrétien, à mieux comprendre de quoi il est fait.
Dans l’histoire du christianisme occidental, la réforme protestante a constitué un tournant majeur. Max Weber y voyait l’origine d’un nouveau rapport au monde, d’une nouvelle éthique. En va-t-il de même s’agissant du rapport au temps ? Peut-on distinguer un régime d’historicité catholique et un régime d’historicité protestant ?
C’est une question considérable à laquelle, de prime abord, je répondrai par la négative. Il n’y a pas de différence, on reste dans le régime d’historicité chrétien puisqu’il est évident, pour Luther, qu’on demeure enserré dans ce cadre chrétien, entre ces deux bornes que sont l’Incarnation et l’Apocalypse. Il prétend même retrouver ce que l’Église a perdu en chemin au fil des siècles. En s’insérant trop dans le temps Chronos, le temps mondain, elle a perdu son rapport au temps Kairos. La Réforme, dans son projet, vise à retrouver ce régime chrétien d’historicité dans sa pureté. La Réforme de Luther est une reformatio, une quête de la forme originelle. Il se trouve qu’elle est aussi devenue une rupture, ce qui n’était pas du tout le projet initial de Luther. En conséquence, le protestantisme dans toute sa diversité s’est construit dans une distance croissante avec le catholicisme. C’est là que s’enracinent les différentes manières d’être au monde qui ont été celles, en particulier, du calvinisme et des catholiques autour de la question de l’économie. Dans ce temps présent qui n’avait pas de consistance ou d’importance, puisque tout ce qui comptait était d’être prêt à une fin pouvant survenir à tout instant, il fallait être comme le veilleur, ne pas se laisser surprendre par la nuit, autant d’images présentes dans les Évangiles. Mais ce temps du monde, ce temps chronos, il a bien fallu faire avec lui, négocier avec lui. Les catholiques l’ont fait à leur façon, et j’étudie un certain nombre des opérateurs auxquels les clercs ont eu recours avant et après la Réforme. Les protestants ont, pour leur part, négocié d’une autre façon. La prédestination, l’idée qu’on ne savait pas ce qu’il en serait de nous, aurait pu les conduire à l’inaction : puisqu’on ne sait pas, ce n’est pas la peine de faire quoi que ce soit. Au contraire, face à l’angoisse de cette incertitude radicale, les protestants ont recherché une espèce d’assurance dans les œuvres et la réussite matérielle. D’où la thèse de Max Weber sur « l’esprit du capitalisme ». Passer de la prédestination à l’idée que ce sont les œuvres, le travail et l’accumulation qui peuvent vous fournir une forme d’assurance dans cette existence, a quelque chose de paradoxal, et n’a pas d’équivalent chez les catholiques.
La Réforme, dans son projet, vise à retrouver ce régime chrétien d’historicité dans sa pureté. La Réforme de Luther est une reformatio, une quête de la forme originelle. Il se trouve qu’elle est aussi devenue une rupture, ce qui n’était pas du tout le projet initial de Luther.
François Hartog
Vous souligniez le fait que rares sont aujourd’hui les chrétiens à s’inquiéter au quotidien de l’advenue de l’Apocalypse. Nombreux sont ceux, toutefois, chrétiens ou non, qui, des « collapsologues » aux « survivalistes », semblent persuadés que la fin du monde est proche et qui s’activent pour l’empêcher ou s’y préparer. Doit-on voir dans de telles attitudes une forme de sécularisation, au sens schmittien d’une transposition des catégories théologiques dans l’univers laïque, d’un mode d’appréhension du monde propre au régime d’historicité chrétien ?
Il y a quelque chose de cet ordre. L’apocalypse reste présente tout au long des siècles ne serait-ce que parce que les mouvements millénaristes n’ont jamais disparu. Le millénarisme a été constamment présent dans l’histoire du monde occidental. Avec cette singularité pour l’Eglise : on ne peut sortir de ce cadre et, en même temps, il faut désapocalyptiser autant que possible le temps. L’Église n’a cessé de répéter que la date et l’heure sont l’affaire du Père seul. Toute spéculation sur la fin est non seulement vaine mais relève de l’hérésie. En conséquence de quoi tous les millénarismes ont été réprimés par l’Église au fil des siècles. Cela n’empêche pas, au contraire, que l’apocalypse soit restée présente, mobilisée notamment dans les périodes de crise grave. En temps de crise, l’apocalypse est une référence que l’on peut facilement jeter dans le débat. Comme le disait Emmanuel Mounier à la suite de l’utilisation de la bombe atomique en 1945. Face à l’inédit de l’événement, « on fait donner l’apocalypse ». C’est une espèce de dernier recours lorsqu’on n’arrive pas à comprendre, à maîtriser la conjoncture. Aujourd’hui, nombreux sont ceux qui, à leur tour, « font donner l’apocalypse », preuve, s’il en était besoin, que nous traversons un moment de grande désorientation, notamment temporelle. Mais cette façon de brandir l’apocalypse est réductrice, dans la mesure où l’apocalypse dans la perspective aussi bien juive que chrétienne est un cataclysme dont peu réchappent mais qui ouvre sur du tout autre, « une nouvelle terre et un autre ciel » comme dit Jean. L’apocalypse chrétienne est donc tout sauf négative. Dans les mobilisations contemporaines, l’apocalypse est uniquement négative. C’est une fin sans après. L’un des moments modernes de mobilisation de l’apocalypse s’est noué lors de la Première Guerre mondiale. On a fortement fait donner l’apocalypse à ce moment. Léon Bloy écrit dans son journal à la fin de l’année 1915 qu’il attend « les cosaques et l’Apocalypse ». Le chrétien qu’il est sait bien sûr que Guillaume II n’est pas l’Antichrist mais la guerre et ses malheurs le conduisent à mobiliser cette figure de l’apocalypse. Et elle demeure présente depuis lors, réactivée dans les années 1930 ou, après 1945, dans les réflexions autour de la bombe atomique chez un Günther Anders par exemple qui désigne les humains comme les « seigneurs de l’Apocalypse ». De nos jours, certains collapsologues et autre catastrophistes, tendent eux aussi, à faire donner l’Apocalypse.
De nos jours, certains collapsologues et autre catastrophistes, tendent eux aussi, à faire donner l’Apocalypse.
François Hartog
Vous pointez le fait que l’apocalyptique contemporaine, à la différence de son aïeule chrétienne, n’ouvre pas sur un après. Pourtant, depuis le début de la crise pandémique que nous traversons, les discours sur le « monde d’après » ont proliféré dans l’espace public. Au point qu’on pourrait se demander si la situation exceptionnelle que nous traversons n’est pas en passe de rouvrir l’horizon d’attente dont l’obstruction est l’une des caractéristiques du présentisme contemporain. Serions-nous en passe de renouer avec le futur ?
Cette tendance à opposer un monde d’avant à un monde d’après, cette propension à voir dans chaque catastrophe l’opérateur d’une rupture entre un avant et un après, ne me semble pas excéder le présentisme. Cela signifie en effet qu’on passe de l’avant à l’après en un instant. Ce sont des facilités de pensée qui n’impliquent aucune prise en compte d’un véritable futur, d’un futur qui serait non pas atteint en une minute mais qu’il faudrait inscrire dans un processus de transformation qui prendrait nécessairement du temps chronos. On est en présence d’un usage présentiste de l’avant et de l’après. Dans le monde occidental, particulièrement en France, on a volontiers mobilisé l’idée d’une rupture, d’une brèche. Si l’on se tourne vers la Chine ou l’Inde, dont je ne suis nullement spécialiste, je pense que l’horizon temporel n’est pas structuré de cette manière. Il n’y a pas d’apocalypse dans le temps chinois. Pour Xi Jinping, cela ne veut rien dire et pas seulement parce qu’il se réfère uniquement à Confucius ou à la continuité du temps impérial. Cette façon de penser le rapport au temps doit être mise en perspective en fonction des lieux. Ce temps avec des brèches, avec des perspectives de fin, n’a pas grand sens ou pas le même sens hors de l’Occident. Le rapport à la pandémie et à son après ne sont pas les mêmes en Chine ou en Inde que dans le monde occidental.
Il existe certes des manières divergentes d’envisager la crise à laquelle est confrontée l’humanité selon le lieu d’où on la vit et la pense. Toutefois, la pandémie nous rappelle que cette humanité, par-delà sa diversité fondamentale, est confrontée à des défis communs. C’est aussi ce que nous rappellent les penseurs de l’Anthropocène qui, en bouleversant notre conception des âges géologiques, font vaciller notre rapport au temps.
La prise de conscience et la réflexion sur l’Anthropocène sont récentes, en particulier chez les historiens qui n’ont pas été les premiers à s’en soucier. Du point de vue du temps, on est en présence d’une nouvelle crise, d’un de ces moments où il arrive quelque chose que l’on ne sait pas dire et qu’on doit appréhender tant bien que mal avec les mots de ce qui est en train de disparaître. Il ne s’agit pas pour moi d’aller plaquer le régime chrétien sur l’Anthropocène mais je pense qu’il peut l’éclairer. Le temps moderne, tel qu’il s’est dégagé depuis le XVIIIe siècle avec des gens comme Buffon, Condorcet ou Darwin, est un temps qui s’est débarrassé des bornes qui étaient celles du cadre chrétien. En amont, la borne de la chronologie biblique : on a vécu jusqu’au XVIIIe siècle, officiellement, dans un univers qui ne pouvait pas avoir plus de six mille ans. On y croyait ou pas mais c’était resté ce à quoi il fallait adhérer et, encore en 1778, Buffon a eu des problèmes avec la Sorbonne lorsqu’il a publié ses Époques de la nature. La géologie a fait sauter la borne des six mille ans. En aval, l’autre borne a aussi sauté lorsque Condorcet introduit dans son Esquisse d’un tableau historique des progrès de l’esprit humain l’idée de progrès indéfinis. Notez qu’il parle toujours de progrès au pluriel et pas encore du Progrès au singulier. Le temps moderne est caractérisé par cette double ouverture vers l’aval et vers l’amont. Or, avec l’Anthropocène, on fait l’expérience de la réintroduction de bornes puisqu’il peut y avoir une fin, non pas de la Terre, mais du monde tel que nous l’avons organisé. Et dès lors qu’on pose qu’il peut y avoir une fin sous la forme d’une sixième extinction des espèces, par exemple, on introduit aussitôt un temps de la fin. S’il y a une fin possible ou prévisible, cela signifie qu’on est entré dans un temps qui est celui de la fin et que ce temps qui s’est ouvert occupe une place analogue à celle de l’Incarnation : nous sommes poussés à calculer combien de temps il reste. Et de fait, les publications sur ce thème prolifèrent aujourd’hui. Le parallèle avec le temps chrétien peut aider à mieux comprendre le trouble contemporain dans le rapport au temps.
S’il y a une fin possible ou prévisible, cela signifie qu’on est entré dans un temps qui est celui de la fin et que ce temps qui s’est ouvert occupe une place analogue à celle de l’Incarnation : nous sommes poussés à calculer combien de temps il reste.
François Hartog
Ce trouble lié à l’entrée dans ce qui est perçu comme un temps de la fin peut-il contribuer à niveler les dissensions propres à l’humanité compte tenu du défi global auquel il la confronte ?
Cette prise de conscience du fait que les humains comme espèce sont devenus une force géologique ne signifie pas qu’ils n’agissent plus dans le monde. C’est là que la distinction proposée par Dipesh Chakrabarthy entre le monde (World) et la planète (Planet) me semble éclairante. L’espèce humaine est une force géologique qui, en tant que telle, a des effets sur le système de la Terre, mais l’humanité, comme ensemble de collectivités, continue à agir dans le monde et à devoir composer avec des temporalités multiples, conflictuelles, antagonistes. Toute la difficulté est de penser les deux ensemble. On ne peut pas se contenter de dire que, puisque nous sommes entrés dans l’Anthropocène, tout le reste n’a plus d’importance. Pas plus qu’on ne peut, pour ainsi dire, « reverser » le temps propre de l’Anthropocène dans celui du monde, comme on le fait lorsqu’on dit qu’il vaut mieux parler de Capitalocène que d’Anthropocène. Bien sûr que le capitalisme a un rôle important dans cette évolution mais ça ne règle pas la question de l’espèce humaine comme agent géologique. Vous pourrez supprimer le capitalisme et le remplacer par ce que vous voulez, la question n’en continuera pas moins à se poser : nous avons déjà modifié le climat pour les 100 000 ans à venir. Cela ne veut pas dire qu’il ne faut pas réfléchir aux enjeux de la justice climatique, mais celle-ci ne peut pas répondre à cette autre dimension et à cette autre temporalité qui est celle de l’espèce humaine comme force géologique et qui met en œuvre des temporalités incommensurables avec celles du monde moderne. À partir du XVIIIe siècle, on a découvert le temps extrêmement long de la Terre et de la Nature, mais on s’en est séparé : Condorcet, de fait, ne s’intéresse qu’au temps des humains. Le monde moderne s’est enfermé dans le temps qu’il a fabriqué et qui s’étend sur quelques siècles, tout au plus sur quelques millénaires mais pas davantage. Le surgissement de l’Anthropocène bouleverse ce cadre puisqu’on est en présence d’un temps immense qui se compte en millions voire en milliard d’années. Un temps sur lequel on n’a aucune prise : comment se représenter un temps chronos se comptant en milliards d’années ? Mais un temps où, malgré tout, les humains comme espèce jouent un rôle.
Cette question de la responsabilité de l’humanité vis-à-vis de son environnement terrestre est au cœur de l’écologie politique. Cette dernière développe un discours volontiers anxiogène porté par le motif de l’urgence et l’idée qu’il faudrait agir au plus vite pour ne pas dire précipitamment. Dans le même temps, elle fait l’éloge des vertus du ralentissement, qu’il s’agisse de la circulation automobile ou de la production industrielle. N’y a-t-il pas là une contradiction ?
On est effectivement dans cette espèce d’injonction contradictoire qui veut qu’il soit urgent de ralentir. On reste dans la perspective de l’urgence qui est un des traits du présentisme, au même titre que l’injonction à accélérer toujours plus. À cet impératif de l’accélération répond le programme d’un ralentissement qui, parti de l’Italie, avec la slow food, s’est propagé dans de nombreux autres domaines. Ces aspirations à sortir du présentisme, qui préexistaient à la prise de conscience de l’Anthropocène, ont été renforcées par elle dans la mesure où ne pas les suivre reviendrait à accélérer la survenue de la catastrophe. La perspective de l’environnement reconduit encore celle du partage entre la nature et la culture. Avec l’anthropocène, nous sommes amenés à considérer qu’un tel partage n’est plus tenable. Il y a les vivants et les non-vivants, les humains et les non-humains qui tous sont embarqués sur le même bateau, la même Terre. La question de la responsabilité des humains se pose donc en des termes différents. Pour emprunter encore à Chakrabarty, je dirais que la question est moins désormais celle du « durable » ou du « soutenable » que de « l’habitable ». Faire en sorte que la planète soit encore « habitable » ou, au sens propre, vivable.
Ces derniers mois ont été marqués, des deux côtés de l’Atlantique, par de nombreuses polémiques mémorielles qui se sont cristallisées autour de la place de la statuaire commémorative dans l’espace public. Que vous ont inspiré les débats sur le sujet ?
Le rapport ordinaire aux statues est celui de l’invisibilité. On passe devant sans les voir. Elles font partie du paysage urbain. Qui voyait jusqu’à il y a peu la statue de Galliéni devant les Invalides ? Or, tout d’un coup, à la suite d’un événement, à l’occasion d’un anniversaire ou autre, des protestations s’élèvent, des manifestations s’organisent, remettant en cause la présence de tel ou tel personnage dans l’espace public. L’honorer, c’est imposer, disent ceux qui s’y opposent, une version officielle, mensongère ou, au moins partiale, de l’histoire. C’est à partir du présent et au nom d’un jugement moral qu’est prononcée la condamnation qui devrait conduire à la suppression de ladite statue. Ces manifestations sont l’expression d’une « archipellisation » (Guillaume Fourquet) de l’espace public. Pour pouvoir s’y reconnaitre, chacun y voudrait son chez soi. On a là un développement du combat (ancien déjà) de la mémoire contre l’histoire : mémoire qui a été ignorée, massacrée, portée aujourd’hui par des victimes ou par leurs descendants.
La perspective de l’environnement reconduit encore celle du partage entre la nature et la culture. Avec l’anthropocène, nous sommes amenés à considérer qu’un tel partage n’est plus tenable.
François Hartog
L’érection de statues relevait du grand modèle de l’histoire maîtresse de vie : fournisseuse d’exemples. A cet égard, la IIIe République a beaucoup œuvré pour établir un paysage illustrant l’histoire d’une France dont elle était l’aboutissement et célébrant les grands hommes qui en avaient été les agents : Histoire de Lavisse, monuments historiques, statues, tout cela formait un ensemble marchant, si j’ose dire, du même pas. Cet ensemble s’est défait depuis longtemps, mais il n’a jamais été vraiment remplacé ni même repensé. Les villes ont plus été dans une logique d’accumulation, de juxtaposition, de patriotisme local et, plus récemment, de patrimonialisation. On a ajouté des noms, des statues, supprimé parfois (après 1945 notamment). Mais, plus généralement, que faire alors même que dans les centres villes l’espace est très contraint ? Un nouveau promu n’a droit qu’à quelques mètres de chaussée ! Si la table rase n’est pas une option, le simple maintien en l’état ne l’est pas non plus. Quant à ajouter, comme certains le suggèrent, des notices qui viendraient corriger en quelques lignes, l’exemplarité dont la statue était porteuse, cela me semble peu convaincant : ce type exemplaire, en fait, ne l’était pas tant que ça ! Le Galliéni qui était honoré par la Ville de Paris était celui des Taxis de la Marne, pas le boucher de Madagascar… J’observe que se sont développés ces dernières années les monuments éphémères, expressions d’émotions partagées (à la suite d’attentats ou d’assassinats) : ces installations en l’honneur de victimes sont-elles appelées à jouer le rôle de lieux de mémoire (forcément temporaires) dans un monde encore présentiste qui va d’une crise à une autre, d’une émotion à une autre ?
Vous avez été un compagnon de route de la revue Le Débat dans laquelle vous avez publié de nombreuses contributions. Comment avez-vous réagi à l’annonce de l’arrêt de sa publication ? Partagez-vous le diagnostic dressé par Pierre Nora et Marcel Gauchet pour le justifier, à savoir l’arrivée à obsolescence du modèle de la revue généraliste d’une part et l’appauvrissement de la qualité du débat d’idée de l’autre ?
L’annonce de la fin du Débat s’est trouvée prise elle-même dans autre chose, compte tenu du caractère éruptif du mot fin. Fin du Débat, fin de la vie intellectuelle, voire fin d’un ancien monde ! Ces phénomènes d’emballement sont un symptôme du fonctionnement médiatique et des simplifications qu’il génère. Le Débat, ce sont trois personnes qui pendant quarante ans ont fait une revue avec tout ce que cela implique comme labeur : composer des sommaires, trouver des auteurs, relire des articles, les amender, etc.. Pierre Nora a bientôt 90 ans, Krzysztof Pomian en a 86 et Marcel Gauchet 75. Qu’ils aient décidé d’arrêter, ils en ont tout à fait le droit, et nul ne le leur a imposé. Antoine Gallimard n’a pas dit « c’est terminé ». Ces trois personnes n’ont jamais souhaité fonctionner autrement, et c’était leur droit le plus strict. C’est pourquoi le Débat n’a jamais été un milieu à la différence d’Esprit, par exemple, qui a toujours privilégié le collectif. Le diagnostic à retenir au fond, c’est qu’aujourd’hui une revue généraliste n’a plus beaucoup de pertinence. Le travail d’une telle revue, c’est de repérer et de traiter des thèmes, des questions qui émergent, font problème, en ouvrant largement le compas. La revue a un rôle de veille et de banc d’essai (des auteurs peuvent lancer, mettre à l’épreuve des hypothèses, des interprétations). Or, aujourd’hui, la mise en ligne des revues fait qu’on consulte moins la revue ou un numéro de la revue qu’un article, dont a besoin pour telle ou telle raison. Si bien que tout le travail d’élaboration d’un sommaire, d’une problématique passe par pertes et profits dès lors qu’un article (repéré à partir d’une bibliographie ou d’une base de données) est consulté isolément, sans plus tenir compte de ce qui vient avant ou après dans le sommaire. Quant à l’appauvrissement du débat d’idée, c’est difficile à évaluer. Le Débat a été fondé il y a quarante, au lendemain de la mort de Sartre, dans un contexte d’un rapide déclin du marxisme, à partir du slogan « Et si revenait le temps du débat ! ». L’idée était qu’on allait enfin ou à nouveau pouvoir débattre sans être d’emblée assignés à des positions antagonistes ou tout simplement idéologiques. Je crois qu’un tel espace a existé. Il faudrait reprendre justement tous les sommaires pour en suivre les évolutions au fil des quarante années. Aujourd’hui, si on se focalise sur les plateaux des chaînes de télévision en continu, la dégradation de la qualité du débat ne fait pas de doute. Mais est-ce que cela signifie pour autant qu’il n’y a plus de débat dans d’autres enceintes et sous d’autres formes ? Certainement pas, et peut-être que le Grand Continent est une forme nouvelle de faire en sorte qu’il puisse y avoir encore du débat. À vous de vous y employer !

