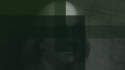La dénonciation de l’application extraterritoriale du droit américain est un thème récurrent auprès des dirigeants politiques et économiques français et, plus récemment, des autorités européennes. On est cependant en droit de s’interroger sur la pertinence, et plus encore sur l’efficacité de cette dénonciation, demeurée jusqu’ici largement rhétorique.
Pertinence tout d’abord, en ce que l’application extraterritoriale d’un droit national n’est pas en elle-même contraire au droit international, et qu’elle est au contraire appelée à devenir de plus en plus la norme dans une économie mondialisée ignorant les frontières nationales et territoriales. Ainsi, de nombreux domaines du droit européen, tels le droit de la concurrence ou la réglementation des données personnelles et de l’univers numérique plus généralement, sont-ils d’application extraterritoriale à l’instar de certaines législations américaines. Ce n’est donc pas le principe de l’extraterritorialité, mais ses éventuels abus qui sont en cause.
Efficacité ensuite, en ce que cette dénonciation récurrente et souvent excessive est restée jusqu’ici dépourvue de conséquences pratiques, dès lors que les autorités françaises et européennes n’ont pas de doctrine claire face aux demandes des procureurs américains et qu’elles sont absentes des seuls théâtres concrets où se joue parfois le débat sur la légitimité de l’application extraterritoriale du droit américain, à savoir les juridictions fédérales des États-Unis. Les termes de ce débat et les moyens d’y prendre part sont l’objet du présent article.
I. L’extraterritorialité dans les prétoires américains : un parcours du combattant
Les dossiers à caractère pénal donnant lieu à un contentieux judiciaire en matière d’application extraterritoriale du droit américain sont relativement rares, dans la mesure où la plupart d’entre eux concernent des entreprises et se soldent par des transactions entre ces dernières et les autorités de poursuite américaines, hors de l’arène judiciaire. Le parquet fédéral américain peut alors prendre des positions très agressives en matière d’extraterritorialité, sans craindre d’être contredit par les juridictions fédérales. Les entreprises s’y soumettent, préférant des amendes financières, aussi lourdes soient-elles, ainsi que la protection de leurs dirigeants, au coût et aux conséquences dommageables d’un long procès.
Dans ce scénario dominant, l’absence de doctrine et les divisions au sein des autorités françaises compétentes (Chancellerie, ministère de l’Économie…) sur l’attitude plus ou moins coopérative à adopter face aux exigences des procureurs américains favorisent d’éventuels abus dans l’application extraterritoriale du droit américain.
L’absence de doctrine et les divisions au sein des autorités françaises compétentes (Chancellerie, ministère de l’Économie…) sur l’attitude plus ou moins coopérative à adopter face aux exigences des procureurs américains favorisent d’éventuels abus dans l’application extraterritoriale du droit américain.
laurent cohen-tanugi
Pour être beaucoup moins fréquent que les résolutions négociées, le contentieux de l’application extraterritoriale du droit américain n’en existe pas moins devant les juridictions fédérales. Il concerne alors généralement non plus les entreprises, mais leurs dirigeants et autres salariés. En réponse aux critiques visant l’impunité des dirigeants d’établissements bancaires à l’origine de la crise financière mondiale de 2007-2008, la politique pénale américaine s’est efforcée depuis de rechercher la responsabilité et la sanction des personnes physiques, parallèlement aux transactions conclues avec les personnes morales.
Cette nouvelle orientation a été formalisée dans le Yates Memorandum de 2015 du Département de la justice américain (DoJ). Les personnes physiques peuvent ainsi se trouver visées par les autorités de poursuite américaines pour des fautes personnelles, mais elles le sont le plus souvent pour des faits commis dans l’exercice de leurs fonctions et sur instruction de leur hiérarchie.
Dans un premier type de situation, ces personnes peuvent se trouver arrêtées sur le territoire américain et se voir incarcérées dans l’attente de leur procès et en vue d’obtenir des informations permettant d’inculper des personnes plus élevées dans la hiérarchie, voire l’entreprise qui les emploie elle-même. La libération sous caution leur est généralement refusée en raison du risque de fuite qu’elles présentent et ces personnes se voient souvent, de surcroît, abandonnées par leurs entreprises dès leur inculpation, quand l’entreprise n’a pas elle-même contribué à cette inculpation en faisant du salarié un bouc émissaire commode en vue de la négociation d’une transaction. L’intéressé(e) ne peut alors se défendre qu’avec des moyens financiers limités et finit par plaider coupable pour s’en sortir. C’est la mésaventure survenue, entre autres, à Frédéric Pierucci, ancien salarié d’Alstom, qu’il relate dans son livre Le piège américain.
Le second cas de figure fait intervenir des dirigeants ou salariés d’entreprise inculpés aux États-Unis pour des faits commis dans leur propre pays et absents du territoire américain lors de leur inculpation. Ces personnes se trouvent alors face à une alternative peu enviable : soit se présenter aux États-Unis pour se défendre, avec la quasi-certitude d’y être détenues pendant toute la durée de leur procès ; soit demeurer indéfiniment sous le coup de leur inculpation, avec l’impossibilité pratique de quitter leur territoire national, pour autant qu’à l’instar de la France, le pays de leur nationalité n’extrade pas ses propres nationaux. Cette impossibilité et la stigmatisation associée à une inculpation pénale ont notamment souvent pour conséquence aggravante l’incapacité à retrouver un emploi.
La seule planche de salut qui reste à l’intéressé(e) consiste alors à tenter de faire invalider son acte de mise en accusation sans comparaître en personne aux États-Unis, sur le fondement de moyens de droit techniques en nombre limité, tels que la prescription, l’exigence constitutionnelle américaine de due process, qui requiert un lien suffisant entre la personne inculpée et les États-Unis, ou encore l’absence de base légale à l’application extraterritoriale de la législation en cause. Dans un important arrêt datant de 2010, Morrison v. National Australia Bank, la Cour Suprême des États-Unis a en effet posé le principe selon lequel les lois américaines sont présumées d’application territoriale, sauf mention explicite de leur portée extraterritoriale. Faute d’une telle mention, l’application d’une loi américaine à des faits localisés hors des États-Unis est dépourvue de validité.
Aussi fondés soient-ils, de tels moyens de défense se heurtent cependant au tir de barrage que constitue la fugitive disentitlement doctrine, que le DoJ ne manque pas d’opposer à tout défendeur étranger cherchant à assurer sa défense sans comparaître en personne sur le territoire américain. Cette doctrine jurisprudentielle vise à dissuader les fuites en privant tout fugitif de ses droits de la défense, y compris les plus fondamentaux. Visant traditionnellement, au stade de l’appel, les seules personnes ayant fui le territoire américain après leur inculpation ou ayant au moins commis les actes incriminés sur ce territoire, cette doctrine se trouve de plus en plus fréquemment appliquée en première instance à des défendeurs non américains n’ayant aucunement fui le territoire américain, pour des actes commis dans leur pays de résidence habituelle.
Cette extension de la définition traditionnelle du fugitif à l’instigation des procureurs américains a pour effet de priver de tout contrôle judiciaire l’application extraterritoriale du droit américain, sauf à ce que le défendeur accepte de se présenter sur le territoire américain pour y être détenu puis jugé, hypothèse hautement improbable. L’invalidité potentielle de l’inculpation d’un ressortissant étranger dépourvu de lien avec les États-Unis risque ainsi de n’être jamais sanctionnée.
L’invalidité potentielle de l’inculpation d’un ressortissant étranger dépourvu de lien avec les États-Unis risque ainsi de n’être jamais sanctionnée.
laurent cohen-tanugi
Avalisée par certaines décisions fédérales de première instance, cette extension de la fugitive disentitlement doctrine ne fait heureusement pas l’unanimité au niveau des cours d’appel fédérales. Elle pourrait en conséquence être un jour soumise à l’arbitrage de la Cour suprême des États-Unis, tant elle met en cause les droits fondamentaux de la défense ainsi que la souveraineté judiciaire des autres États. Encore faut-il pour cela que les cours d’appel fédérales acceptent de se déclarer compétentes pour examiner les décisions de première instance négatives sur ce sujet, face à l’invocation par le parquet d’une autre règle procédurale : la final judgment rule.
Cette règle de bonne administration de la justice s’oppose à ce qu’il soit fait appel de décisions d’étape, avant une décision définitive de première instance sur l’ensemble d’un dossier. Là encore, une exception étroite existe pour surmonter l’obstacle : la collateral order doctrine, qui permet aux juridictions d’appel de se déclarer compétentes pour juger de décisions collatérales au fond de l’affaire, dès lors que l’appel de ces décisions deviendrait sans objet au terme du procès. Il en est ainsi de décisions refusant une libération sous caution ou précisément de décisions déniant à un individu le droit de se défendre en le déclarant « fugitif ».
C’est donc au terme d’un véritable parcours du combattant que le défendeur étranger pourra – s’il a pu franchir tous les obstacles évoqués ci-dessus – faire juger la légalité de l’application extraterritoriale du droit américain à son encontre. Si la législation concernée est explicitement d’application extraterritoriale, la question sera vite tranchée. Dans le cas contraire, le parquet s’efforcera de plaider qu’il est fait une application « domestique » (territoriale) de la loi, aussi ténu que soit le lien entre les faits incriminés et le territoire américain.
Que conclure de tout ceci ? Que les positions souvent agressives prises par le parquet fédéral américain en matière d’extraterritorialité sont rarement testées en justice, que les juridictions sont généralement favorables au parquet, au moins en première instance, et que l’appel de ces décisions pour un défendeur étranger refusant de comparaître aux États-Unis est extrêmement difficile, et ce, malgré une position de principe de la Cour suprême faisant de l’extraterritorialité l’exception.
Les entreprises s’accommodent de cette situation en transigeant avec les autorités de poursuite, car elles y trouvent leur compte : une grosse amende contre l’évitement d’un procès pénal et la protection de leurs hauts dirigeants. La situation est différente pour les individus, notamment les cadres de niveau intermédiaire, qui servent souvent de boucs-émissaires sans réelle possibilité de se défendre.
Les positions souvent agressives prises par le parquet fédéral américain en matière d’extraterritorialité sont rarement testées en justice, que les juridictions sont généralement favorables au parquet, au moins en première instance, et que l’appel de ces décisions pour un défendeur étranger refusant de comparaître aux États-Unis est extrêmement difficile, et ce, malgré une position de principe de la Cour suprême faisant de l’extraterritorialité l’exception.
laurent cohen-tanugi
Plusieurs décisions judiciaires récentes témoignent cependant d’une attitude critique de certaines juridictions fédérales à l’égard des prises de position et des pratiques du DoJ. Ainsi, dans une décision United States v Connolly, le juge McMahon a dénoncé la tendance du DoJ à sous-traiter l’enquête interne servant de base aux poursuites au cabinet d’avocats de l’établissement financier concerné. Au stade du jugement sur les peines encourues par deux anciens traders britanniques de la Deutsche Bank, le juge a sévèrement critiqué les positions du DoJ et refusé de suivre ses réquisitions, en soulignant le traitement discriminatoire infligé aux défendeurs résidant hors des États-Unis relativement aux défendeurs américains, du fait de la détention préventive imposée aux premiers.
Par ailleurs, un récent article du Wall Street Journal se faisait l’écho d’une alerte lancée par un ancien procureur fédéral, selon lequel le DoJ utiliserait abusivement les traités d’entraide judiciaire multilatérale pour demander la communication de preuves à l’étranger aux seules fins de suspendre artificiellement le délai de prescription applicable à certaines infractions pénales. Les communications intergouvernementales en la matière étant stipulées confidentielles, les personnes visées n’ont aucun moyen de détecter et de se prévaloir de ces abus.
Enfin, sur le fond, dans une récente décision Prime International Trading Ltd v BP P.L.C., la Cour d’appel fédérale du 2e Circuit a confirmé que l’application d’un texte de loi n’ayant pas de portée extraterritoriale à une situation de fait localisée hors des États-Unis ne pouvait être qualifiée d’application « domestique » de ce texte, comme le prétendaient les demandeurs.
Ces différents développements montrent qu’il est possible de faire pièce aux autorités de poursuite américaines sur le terrain judiciaire, même s’il est naturellement bien préférable d’intervenir en amont d’un procès.
II. Pour une réponse stratégique et opérationnelle
Face à cette situation, les autorités françaises sont jusqu’ici restées passives, accédant ou s’opposant aux demandes d’entraide judiciaire de leurs homologues américaines en fonction de positions de principe à l’égard de la coopération avec les États-Unis, ou encore en considération de leur appréciation de l’atteinte potentielle aux « intérêts économiques essentiels de l’État », plutôt qu’en considération de la situation juridique des personnes concernées, et s’abstenant d’intervenir en leur faveur dans les procédures contentieuses ultérieures.
Ainsi le récent Rapport Gauvain dénonçait-il l’absence de contrôle réel sur les informations communiquées par la Chancellerie aux autorités américaines dans le cadre du Traité d’entraide judiciaire en matière pénale du 10 décembre 1988 : « Ce principe de coopération a eu un impact fort dans les États monistes tels que la France où les traités priment sur le droit interne. L’objectif légitime de ce principe a souvent fait perdre un peu de vue la nécessité de veiller à ce que la coopération ne porte pas atteinte à la souveraineté de l’État et ce faisant, à la protection des citoyens et des entreprises : la mission a ainsi pu observer que les circuits de cette veille n’étaient pas organisés et les intérêts à protéger pas clairement définis. »
Le Bureau de l’Entraide Pénale Internationale « a admis auprès de la mission avoir longtemps transmis de nombreux éléments dans le cadre de l’entraide pénale, sans véritablement examiner ni filtrer leur contenu. »
La préservation des « intérêts économiques essentiels de l’État » – c’est-à-dire, en pratique, la protection de groupes industriels ou bancaires nationaux potentiellement coupables de violations de la législation américaine, voire du droit français – peut également entrer en conflit avec les intérêts et les droits de la défense des individus impliqués dans les dossiers concernés. À titre d’exemple, un refus de coopération de la part des autorités françaises au titre de la loi de blocage de 1968 est susceptible de résulter en l’inculpation de ressortissants français aux États-Unis. En conséquence, le respect du droit et de la justice est sans doute le meilleur guide de l’action des pouvoirs publics français.
Un refus de coopération de la part des autorités françaises au titre de la loi de blocage de 1968 est susceptible de résulter en l’inculpation de ressortissants français aux États-Unis. En conséquence, le respect du droit et de la justice est sans doute le meilleur guide de l’action des pouvoirs publics français.
laurent cohen-tanugi
Au-delà des préconisations du Rapport Gauvain, il est cependant possible d’envisager une approche plus stratégique et opérationnelle de la part des autorités françaises, dans un contexte de géopolitisation croissante du droit.
En amont, au stade de l’enquête et des demandes d’entraide, les autorités françaises pourraient, avec le concours d’experts, procéder à une première évaluation de la légitimité de l’application extraterritoriale de la législation invoquée au regard du droit américain, en vue de calibrer leurs réponses en conséquence et d’ouvrir une négociation avec leurs interlocuteurs américains.
En aval, en cas d’inculpation, les autorités françaises pourraient intervenir au soutien de la défense de leurs ressortissants personnes physiques, notamment sous forme de mémoires amicus curiæ sur les questions de principe. Mieux encore, la France pourrait prendre l’initiative de la négociation d’un accord bilatéral avec les États-Unis sur la définition d’un fugitif, la délimitation des critères d’une application extraterritoriale du droit américain à une situation de fait, ou encore la levée de la confidentialité des échanges au titre de l’entraide judiciaire lorsqu’une question sérieuse de prescription est en jeu.
Tout ceci suppose une doctrine claire sur les positions à adopter et sur la résolution des conflits d’intérêts et des contradictions entre protection des entreprises, respect des droits individuels et respect de la loi, ainsi qu’une connaissance fine de la politique pénale et de la jurisprudence américaines. Une telle approche requiert également des ressources humaines dotées des compétences nécessaires pour arbitrer les conflits d’intérêts et négocier avec les procureurs américains. Nous en sommes encore très loin.
À terme, l’entrée en scène des autorités européennes dans les affaires de délinquance économique et financière internationale, avec un parquet européen doté de compétences pénales, demeure la voie royale pour rétablir l’égalité des armes avec les États-Unis, et demain la Chine, comme c’est déjà le cas en matière monétaire, de droit de la concurrence ou de commerce international, domaines dans lesquels l’Union dispose de compétences quasi fédérales.