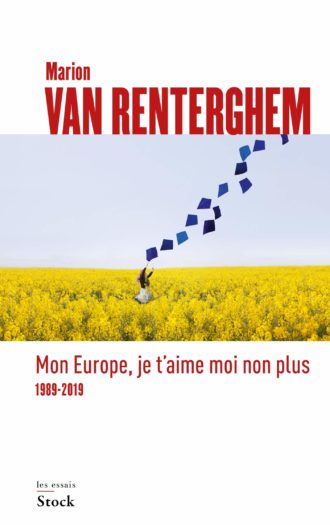Mon Europe, conversation avec Marion Van Renterghem
Dans son dernier livre, Marion Van Renterghem compile trente ans de souvenirs et de portraits européens en tant que journaliste. Elle nous livre aujourd’hui son sentiment sur cette période, qu’elle décrit comme un lent passage de l’euphorie à la lassitude, sans toutefois effacer la vitalité des figures qu’elle a croisées.
Marion Van Renterghem est grand reporter. Au cours des quelque trente années qu’elle a passées comme journaliste au Monde, ses pérégrinations l’ont conduite aux quatre coins de l’Europe et menée au livre qu’elle publie aujourd’hui, Mon Europe, je t’aime moi non plus, une autobiographie européenne en trente ans de voyages et de rencontres, de la chute du mur de Berlin aux replis nationalistes-populistes d’aujourd’hui. Elle est lauréate du prix Albert-Londres, entre autres prix de journalisme. Sa biographie d’Angela Merkel (L’ovni politique, éditions Les Arènes/Le Monde, 2017) a été couronnée par le prix Simone-Veil/Mairie du 8e.
Mon Europe, je t’aime moi non plus raconte l’Europe telle qu’elle a changé dans les trente dernières années. L’année 1989 marque la chute du mur du Berlin et un renouveau d’espérance inédit depuis la fin de la Deuxième guerre mondiale : « le dernier des deux grands totalitarismes était vaincu, la colonisation était terminée, les empires avaient lâché leurs prises de guerre. L’Europe, coupée en deux après Yalta, était réunifiée. (…) Tout se dérangeait. On allait vers le nouveau. C’était excitant. C’était beau. » Aujourd’hui, cette euphorie semble avoir disparu derrière « le bruit et la fureur, la peur, la haine, le replis, l’exclusion » à mesure que les nationalismes reviennent, les grands partis politiques s’effilochent, les institutions sont ébranlées et les démocraties minées de l’intérieur.
Au gré d’une galerie de portraits d’Européens, où évoluent un président de la République français, un chiffonnier grec, un commerçant irlandais, un patron de la presse d’État polonaise, un ministre de la justice roumain, une ancienne présidente de la Lettonie et quelques irréductibles révolutionnaires pour la démocratie, Marion Van Renterghem pose la question : « Qu’avons-nous fait de nos trente ans ? »
Existe-t-il, selon vous une culture européenne ?
Oui, je pense qu’il existe une singularité sur le territoire européen, forgée par une civilisation gréco-romano-judéo-chrétienne, à laquelle est en train de s’ajouter une culture musulmane. Cette mixité est unique au monde. Elle donne lieu à des paysages, des musées, des œuvres imprégnées de cette civilisation mélangée. Quand on voyage en Europe, on rencontre à la fois des églises, des temples, des synagogues, des mosquées, des musées, un urbanisme et une manière de vivre comme il n’y en a nulle part ailleurs.
Ce socle civilisationnel est très fort et nous constitue, qu’on le veuille ou non, comme peuple européen. Or, Il y a un défaut flagrant de pédagogie à ce sujet. Nous n’enseignons pas aux enfants, dès leur plus jeune âge, ce qui fait notre culture commune. De mon côté, je surprends toujours mes interlocuteurs lorsque je leur dis me sentir européenne avant de me sentir française.
« Quand on voyage en Europe, on rencontre à la fois des églises, des temples, des synagogues, des mosquées, des musées, un urbanisme et une manière de vivre comme il n’y en a nulle part ailleurs. »
Marion Van Renterghem
Un de vos personnages, John Corcoran, propriétaire d’un magasin de chaussures à Dublin, incarne le contraire de ce que vous ressentez. Il vous parle de son indifférence à l’idée de l’Europe, d’une identité européenne à laquelle il puisse appartenir. Le sentiment d’une identité européenne est-il réservé aux élites ?
Le ressenti de John Corcoran est celui d’un homme qui a connu l’Irlande « archaïque », entre guillemets : rurale, pauvre, ultra-conservatrice. Il a réussi à accéder à la classe moyenne à force de travail, en ouvrant un à un plusieurs magasins de chaussures en Irlande, dont un dans la célèbre Grafton Street de Dublin. La crise des subprimes a fauché d’un coup ce qu’il avait construit et il a dû fermer la plupart de ses boutiques.
Lorsque je l’ai retrouvé, nous avons évoqué l’Europe et le Brexit, entre autres choses. Il n’en avait pas une idée précise. Il m’a dit : « Depuis 10 ans, je suis trop occupé par mon business chaque jour pour penser à tout ça. Je n’ai pas voyagé depuis ». Cet Irlandais m’a beaucoup touchée. C’est un citoyen ordinaire qui n’entre dans aucune des caricatures que l’on peut faire de « l’élite » ou du « peuple ». Il ne démontre rien, il raconte sa vie d’Européen frappé par la crise financière.
Le sentiment vis-à-vis de l’Europe est souvent le même que celui qui s’exprime vis-à-vis la mondialisation. Il y a d’un côté ceux qui se sentent à l’aise dans un monde globalisé, et ceux qui s’estiment lésés faute d’avoir les moyens d’y participer. Les premiers, qui parlent une ou plusieurs langues étrangères et ont les moyens de voyager, sont plus familiers de ce grand pays européen qui est le nôtre. Pour les seconds, l’Union européenne est un bouc émissaire commode et c’est la musique qu’on entend partout. Depuis des décennies, les dirigeants politiques de tous les partis et de tous les pays trouvent plus facile de l’accuser de tous nos malheurs pour se dédouaner de leurs propres défaillances.
« Le sentiment vis-à-vis de l’Europe est souvent le même que celui qui s’exprime vis-à-vis la mondialisation. Il y a d’un côté ceux qui se sentent à l’aise dans un monde globalisé, et ceux qui s’estiment lésés faute d’avoir les moyens d’y participer. »
Marion Van Renterghem
Être « Européen » revêt-il la même réalité que l’on soit Grec, Letton, Polonais, ou Anglais ?
On garde le prisme premier du pays dans lequel on vit, c’est normal et légitime. Mais il y a un manque de pédagogie général, déplorable, sur notre identité européenne et notre communauté de valeurs, même si on est sans doute plus concerné par cette éducation européenne dans certains pays comme en Belgique, au Luxembourg, en Allemagne.
L’Europe est traversée de fractures, entre les pays créditeurs du nord et les pays débiteurs du sud, entre les veilles démocraties de l’ouest et celles de l’est, abandonnées pendant quarante ans à la dictature communiste. Cette cicatrice entre l’ouest et l’est de l’Europe ne s’est pas totalement refermée. C’est ce que je raconte dans mon livre. L’élargissement de l’Union européenne à ces pays que l’Histoire avait relégués après la guerre de l’autre côté du rideau de fer ne s’est pas fait dans de bonnes conditions. Nous avons raté quelque chose. C’est une des raisons qui expliquent le nationalisme-populisme d’aujourd’hui.
Mais il ne faut pas confondre la culture européenne et l’Union européenne. Demandez aux Hongrois s’ils veulent rester dans l’Union européenne, ils répondront en majorité par l’affirmative car ils savent qu’ils en tirent profit économiquement. En revanche leur identité européenne disparaît au profit d’un sentiment nationaliste très fort, cultivé et encouragé par le Premier ministre Viktor Orbán qui dénonce les mœurs « libérales » des démocraties occidentales et rogne sur les libertés publiques.
« Il ne faut pas confondre la culture européenne et l’Union européenne. »
Marion Van Renterghem
Comment valoriser l’idée d’une culture européenne dans nos institutions supranationales ?
J’ai eu l’occasion de parler avec Emmanuel Macron peu après la parution de ce livre (qui contient une interview du président de la République), lors d’un déjeuner organisé à l’Élysée avec des intellectuels européens. Nous étions à la veille de la mise en place de la nouvelle Commission européenne et je lui ai suggéré d’oser un acte révolutionnaire : revendiquer pour la France, non pas le poste convoité de commissaire chargé de l’économie ou de la concurrence, mais celui qui est jugé le moins prestigieux, généralement attribué à un petit pays : celui de la culture. Cela aurait été un symbole fort et l’occasion de développer une véritable politique dans toutes les villes et campagnes d’Europe, qui fasse prendre conscience du socle culturel qui fait de nous des Européens. La France a depuis obtenu à la Commission le portefeuille du marché intérieur, objectivement l’un des plus importants : c’est dire comme j’ai été entendue !
Il y a urgence car le monde a changé. Les États-Unis ne sont plus l’allié évident de l’Union européenne, la Russie de Vladimir Poutine veut sa destruction, la Chine veut en prendre possession économiquement, l’Inde émerge. Les replis nationalistes signent notre arrêt de mort. Dans le nouveau monde multilatéral où les grandes puissances s’affrontent, il est totalement illusoire de peser sur la scène internationale ou même de faire survivre une quelconque « souveraineté nationale » autrement qu’en appartenant à l’une de ces puissances – en l’occurrence l’Union européenne.
« Les replis nationalistes signent notre arrêt de mort. »
Marion Van Renterghem
Paradoxalement, les conservateurs semblent avoir compris l’importance du débat culturel en Europe.
Steve Bannon, l’ex-conseiller stratégique de Donald Trump, a fondé en Italie l’institut catholique Dignitatis Humanae, une académie « pour la défense de l’Occident judéo-chrétien », sous la protection de l’Église. Il est lié à Marion Maréchal, qui a elle-même ouvert un établissement d’enseignement supérieur, l’Institut des sciences sociales économiques et politiques. Ils appliquent une théorie du philosophe politique Antonio Gramsci, selon laquelle la révolution culturelle précède la révolution politique. Il faut d’abord préparer le terrain de la victoire en imposant son idéologie, ses références, ses questionnements, avant de pouvoir l’incarner avec succès sur le plan politique.
Je me suis rendue dans la chartreuse de Trisulti, où l’académie de Steve Bannon est installée. J’ai rencontré son directeur, Benjamin Harwell. Le projet est clair : démolir l’Union européenne, renverser les élites mondialisées, fédérer les droites nationalistes, exporter la « révolution trumpienne ». Ce projet a échoué pour l’instant. Les populistes-nationalistes sont divisés et n’ont rien en commun entre eux mise à part leur volonté commune de détruire l’Europe. Ils ne s’entendent pas sur la conception de l’économie ou de la famille, ni sur une stratégie à mener au sein du Parlement européen, ni même sur la manière de stopper l’immigration, qui est pourtant leur grand thème commun.
Aujourd’hui, les populistes nationalistes sont parfois des purs produits de l’élite européenne : Boris Johnson a étudié à Eton et Oxford, Viktor Orbán à Oxford, grâce à une bourse de la fondation Soros. Vous accordez à ce dernier une place de choix car vous l’avez fréquenté.
Je suis partie vivre à Budapest sur un coup de tête, à 24 ans, où j’ai vécu pendant un an. Je fréquentais une bande de jeunes Hongrois de sensibilité cosmopolite et libérale, dont les parents avaient combattu la dictature communiste. Viktor Orbán faisait partie de leurs amis. Il venait de fonder son petit parti libéral, le Fidesz : le même qui a aujourd’hui la majorité au Parlement en étant devenu le contraire de ce qu’il était au début, un parti conservateur nationaliste populiste.
Orbán est en partie le produit du ratage de l’élargissement de l’Union européenne de 2004, dont j’ai parlé plus haut. La réunion de l’Est et de l’Ouest a créé une disharmonie économique, politique et sociale et engendré des frustrations des deux côtés. À l’Est, Viktor Orbán est l’incarnation de cette boucle, de l’espoir démocratique né lors de la chute du mur de Berlin, à la désillusion et aux replis nationalistes auxquels on assiste aujourd’hui.
« Orbán est en partie le produit du ratage de l’élargissement de l’Union européenne de 2004. »
Marion Van Renterghem
Vous développez la notion de « démocratie illibérale » pour expliquer les évolutions politiques des pays de l’Est.
Ce concept est théorisé par Viktor Orbán et inspiré par Vladimir Poutine : « L’âge de la démocratie libérale est terminé », avait-il annoncé au Parlement hongrois après son élection en 2018. La démocratie illibérale se définit par opposition à nos sociétés post-soixante-huitardes, libérales, cosmopolites et attachées aux droits de l’homme, aux contre-pouvoirs et aux libertés publiques, ce qui dérange sa conception autoritaire du pouvoir. Au nom du nationalisme, il refuse toute immigration et au nom d’un conservatisme chrétien, il remet en cause le droit des minorités religieuses, ethniques et sexuelles.
Vous utilisez l’histoire d’un conte pour enfant pour illustrer les relations entre les pays de l’ancien bloc soviétique et l’Europe de l’ouest. Il s’agit de l’histoire de Serpolette, une jeune fille qui achète le silence de ses meubles avec une cuillère de chocolat chaque fois que son amoureux lui rend visite en cachette. Un jour, elle oublie de donner une cuillère de chocolat chaud à la petite poubelle de sa chambre qui, exclue, vexée, furieuse, la dénonce. Ce sentiment anti-européen et la montée des populismes tient-il à un sentiment d’humiliation similaire ?
Il existe, à l’est de l’Europe, un sentiment d’abandon et d’humiliation et l’expression d’un ressentiment. Je l’ai mesuré notamment en parlant avec László Trócsanyi, qui était mon patron lorsque je travaillais dans un cabinet d’avocats à Budapest et que j’ai retrouvé quand il est devenu ministre de la Justice de Viktor Orbán – il est maintenant proposé par la Hongrie pour être commissaire européen.
Ces pays se sont sentis rejetés par une Europe occidentale qui à leurs yeux s’est comportée avec arrogance, en détentrice des clefs de la démocratie. Ils n’ont pas oublié ce moment où le président français Jacques Chirac les a grondés comme des enfants, estimant qu’ils avaient « perdu une bonne occasion de se taire » en 2003, quand ils avaient décidé de suivre les États-Unis et le Royaume-Uni pour faire la guerre à l’Irak. Ces mots de Jacques Chirac, combien de fois les ai-je entendus lors de mes voyages en Europe !
Je suis frappée par le fait que la liberté, que mon éducation m’a conduite à considérer comme une valeur suprême, est de moins en moins considérée comme telle dans nos démocraties occidentales. Des sondages l’indiquent : les régimes autoritaires emportent l’adhésion au détriment de démocratie libérale. L’un de mes anciens amis de Budapest, Miklós Konrád, qui est maintenant professeur à l’université, me l’a confirmé : « La liberté, m’a-t-il dit, les Hongrois n’ont pas assez d’argent pour s’en servir. En revanche, ils découvrent le paiement des impôts – qui n’existaient pas – l’insécurité, le chômage. Comment convaincre les gens que l’on vit mieux dans un pays libre, quand le seul vrai gain visible, c’est d’avoir accès à la société de consommation occidentale, en pratique inaccessible pour une grande partie de la population ? » Ils ont la nostalgie d’un communisme relativement doux – celui de Janos Kadar, qui a marqué chez eux les dernières années de la dictature – et qu’ils idéalisent maintenant malgré la liberté dont ils étaient privés, parce qu’il leur paraît plus confortable qu’une société économiquement libérale.
« Je suis frappée par le fait que la liberté, que mon éducation m’a conduite à considérer comme une valeur suprême, est de moins en moins considérée comme telle dans nos démocraties occidentales. »
Marion Van Renterghem
Comment expliquer le désamour entre l’Union européenne et les pays d’Europe centrale et de l’Est ?
Le souvenir de la Deuxième Guerre mondiale et de l’oppression soviétique s’éloigne au fur et à mesure que les populations vieillissent. L’Europe souffre d’amnésie. Nous prenons la paix et ses privilèges comme des acquis : c’est dangereux. La paix n’est jamais acquise ! Elle est douloureuse, laborieuse, exigeante. Nous avons mis des décennies à la conquérir. Mais les dernières élections européennes ont manifesté ce qui ressemble à un réveil : non seulement la montée en puissance des partis écologistes a exprimé la prise de conscience que la planète était mortelle, mais le taux de participation, le plus important depuis vingt ans, a exprimé la prise de conscience que l’Union européenne, elle aussi, était mortelle. L’urgence a au moins cela de bon qu’elle incite à réagir.
« La paix n’est jamais acquise ! Elle est douloureuse, laborieuse, exigeante. Nous avons mis des décennies à la conquérir. »
Marion Van Renterghem
Ce sursaut démocratique n’advient-il pas trop tard ?
Je ne crois pas. Le spectacle affligeant du Brexit et de l’incapacité des Britanniques à réaliser une sortie de l’Union européenne – qu’ils ont votée par référendum sans que personne n’ait réfléchi auparavant à ce que le Brexit voulait dire –, a au moins une vertu : il a calmé les velléités, ailleurs en Europe, de sortie de l’Union. Même Marine Le Pen n’en parle plus. C’est carrément sorti de son programme.
Le Premier ministre britannique Boris Johnson, dont vous avez fait le portrait en 2013, reste, lui, campé sur ses positions. Au point d’avoir tenté de suspendre le Parlement en septembre au motif que ce dernier l’empêchait de mener à bien son plan de sortie de l’Union européenne avant le 31 octobre.
Boris Johnson ne reste pas campé sur ses positions, pour la simple raison qu’il n’a jamais eu de position. C’est un cynique et un opportuniste sans convictions. Dans mon portrait de 2013, il m’expliquait au contraire que personne n’était assez « cinglé » à Londres pour vouloir sortir de l’Union… Le mensonge comme stratégie politique est la caractéristique première du populisme et c’est le mensonge qui a conduit Boris Johnson à la victoire. Joseph Goebbels, ministre de l’Éducation, du Peuple et de la Propagande pendant le IIIe Reich en avait fait sa doctrine : « Plus le mensonge est gros, plus il passe ». Hannah Arendt a théorisé le danger en démocratie de la sorte : le fascisme commence lorsque le rapport d’une société à la vérité n’a plus d’importance. Aujourd’hui, on voit des Le Pen, des Orbán, des Johnson, asséner des contre-vérités sans scrupules. Le plus désespérant est que les électeurs n’en prennent même pas ombrage, comme si la vérité ne leur importait plus.
Votre ouvrage est composé d’une galerie de portraits conçus en opposition : pourriez-vous nous en dire plus sur votre procédé d’écriture ?
En tant que journaliste, j’aime beaucoup le portrait. C’est un genre qui permet de concentrer des éléments de reportage, d’enquête, d’analyse. Il rend sa place à l’humain, qu’on a parfois tendance à négliger alors qu’il a son rôle partout, même dans les rapports de force géopolitiques. L’Union européenne est un bon exemple : on a tendance à la réduire au fonctionnement des institutions et à l’étude des directives, et on oublie les Européens. La faiblesse, les défaillances, les psychologies, les petites bassesses ou les grandeurs humaines… tous ces éléments viennent s’ajouter à la politique institutionnelle et permettent de comprendre à quel point l’histoire du monde se décide parfois sur des détails.
Le portrait permet aussi d’aller au plus près de la vie quotidienne, et celle-ci est souvent représentative d’une réalité plus large. Les personnages présentés dans mon livre sont à leur manière des incarnations d’une société, d’un pays, d’une histoire qui les dépasse. Par exemple, j’ai fait les portraits croisés de deux frères polonais, Jarek et Jacek Kurski. Ils sont ennemis. L’un est patron de Gazeta Wyborcza, le grand journal des élites démocratiques polonaises. L’autre est à la tête de la télévision publique, donc un serviteur du pouvoir ultraconservateur. J’oppose aussi Vaira Vīķe-Freiberga, l’ancienne présidente de la Lettonie et celui qui fut son ennemi intime, le président russe Vladimir Poutine. Ou encore László Trócsányi, mon ex-patron avocat maintenant au service de Viktor Orban, à Miklós Konrád, professeur d’histoire juive, désespéré de voir son pays perdre des libertés si chèrement acquises.
Tous ces personnages représentent différentes facettes d’une même population : ceux qui embrassent le système, ceux qui le défient, mais aussi des citoyens ordinaires que la politique n’intéresse pas, ou des dirigeants politiques qui la vivent et la commentent, comme Tony Blair ou Emmanuel Macron. Le portrait permet cela : offrir un éclairage sur le monde sans l’enfermer dans un jugement définitif et théorique.