La Marche de Radetzky
La Marche de Radetzky de Joseph Roth nous ramène à la fragilité des Empires, autant qu'à leur manière de survivre longtemps à leur mort. Une réalité oubliée par l'Union européenne.
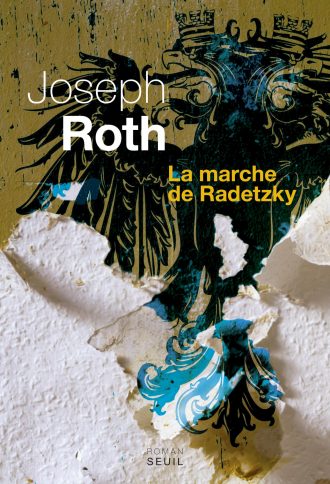
Il y a encore quelques années, au croisement de la rue Amyot et de la rue Lhomond, dans le cinquième arrondissement, on trouvait une plaque charmante et mystérieuse qui disait : « Ici vécut une femme qui n’a pas marqué les livres d’histoire ». Une épitaphe similaire conviendrait très bien aux personnages principaux de La Marche de Radetzky, que Joseph Roth publia en 1932. Ce roman doux-amer raconte la vie de trois générations d’une famille d’obscurs serviteurs de l’Empire : les Trotta.
Leur chemin croise celui des Habsbourg lorsque le sous-lieutenant Joseph Trotta, fils d’un paysan slovène, sauve la vie de François-Joseph à la bataille de Solférino, en 1859. Alors même que l’affaire se solde par une défaite qui marque le début du retrait autrichien de la péninsule italienne, le jeune sous-lieutenant voit son sacrifice récompensé – il prend dans l’épaule la balle destinée à l’empereur – il est alors fait capitaine et anobli. Comble d’ironie, il est désormais connu comme le « héros de Solférino ». À sa suite, son fils et son petit-fils vont à leur tour servir l’Empire, tous deux écrasés par l’ombre du héros incarnée par un portrait que celui-ci a commandé à un peintre, ami de son fils. Ce dernier devient préfet impérial, dans la petite ville de W., où il mène une existence réglée entourée du vieux valet de son père, Jacques, d’une gouvernante qu’il hait et de son fils. Prénommé Charles-Joseph et destiné par son père à une carrière militaire, il devient un médiocre sous-lieutenant de cavalerie. Après quelques années de service à la frontière, il est finalement tué pendant les premiers affrontements de l’été 1914. Quelques années plus tard, le préfet meurt à son tour, alors que François-Joseph agonise après un règne de soixante-huit ans. Les Trotta ne peuvent survivre à l’empereur qui les a faits et qu’ils servent depuis la défaite de Solférino.
À travers ces trois personnages, Joseph Roth fait la chronique narquoise et nostalgique d’un Empire en lente décomposition. Ancien sujet de l’empereur, pour qui il s’est battu entre 1916 et 1918, il raconte la quotidienneté du déclin. Autour des vies médiocres des trois Trotta s’articulent de nombreux personnages – domestiques et aristocrates, militaires et paysans – dont les vies sont bien réglées par la tradition et les hiérarchies, les deux piliers sur lesquels se construisit le conservatisme de François-Joseph. Pourtant, le vernis d’ennui tranquille qu’évoque Joseph Roth se craquelle tout le long du roman, révélant un Empire épuisé, des rituels incompréhensibles et un empereur, car François-Joseph apparaît à quelques reprises, de plus en plus sénile et ridicule.
Autour des vies médiocres des trois Trotta s’articulent de nombreux personnages – domestiques et aristocrates, militaires et paysans – dont les vies sont bien réglées par la tradition et les hiérarchies, les deux piliers sur lesquels se construisit le conservatisme de François-Joseph.
Ainsi La Marche de Radetzky de Roth est une réponse à la Marche originale, celle que Johann Strauss père composa en l’honneur du maréchal Joseph Wenzel Radetzky von Radetz. Il y célébrait l’écrasement des armées sardes à la bataille de Custoza, en 1848, dans un morceau triomphal dont le rythme était si entraînant que, bien vite, les officiers de l’armée impériale l’accompagnèrent en battant des pieds et des mains – une tradition qui se perpétue encore aujourd’hui lors des matchs de l’équipe de football autrichienne et à la fin du célèbre concert du Nouvel An qui se donne au Musikverein de Vienne. La Marche met en musique une Autriche triomphante, dont le conservatisme politique a été consolidé par l’écrasement du printemps des peuples, et dirigée par un empereur de dix-huit ans, François-Joseph.
En faisant commencer son roman onze ans plus tard, à la bataille de Solférino, qui marque le début de la déliquescence de l’Empire des Habsbourg, c’est délibérément que Joseph Roth choisit de montrer le revers de l’Empire triomphal que compose Strauss. Entre cette défaite, dont Trotta devient le pathétique héros, et la mort de François-Joseph, l’Empire, insensiblement, se délite. Ce roman nous rappelle que, le plus souvent, les Empires s’écroulent en silence.
Ce roman nous rappelle que, le plus souvent, les Empires s’écroulent en silence.
Étrange affirmation pour un Français tant nous sommes habitués à voir nos Empires comme nos institutions s’écrouler bruyamment, dans le fracas des guerres et des Révolutions. Que l’on parle de la chute de l’Ancien régime, de la bataille de Waterloo ou de la disparition de ce qui fut notre empire colonial, ce sont des guerres et des massacres qui nous viennent à l’esprit, accréditant l’idée qu’un régime politique ne peut disparaître que brutalement. Il ne s’agit bien sûr pas de nier la part de l’évènement, guerre ou révolution, dans la fin d’un régime politique, quel qu’il soit. Joseph Roth n’aurait pu le nier, lui qui avait vu l’Autriche-Hongrie disparaître à la fin de la Première Guerre mondiale, emportée par la défaite et l’affirmation des nationalités. Mais, il remet l’évènement à sa juste place, à la fin d’un processus presqu’imperceptible. C’est ce lent délitement, qui s’étire sur plusieurs générations, qu’il nous donne à voir au point qu’il ne raconte même pas la chute, à proprement parler, de l’Empire, puisque le roman se clôt avec les morts parallèles de François-Joseph et du vieux préfet von Trotta, qui l’a servi toute sa vie, avec tant de diligence que son visage précocement vieilli rappelle celui de l’empereur octogénaire. C’est le récit de cette déliquescence silencieuse qui doit nous interpeller aujourd’hui.
Ce que Joseph Roth décortique, sans presque jamais l’expliciter, c’est la manière dont l’idée impériale se vide peu à peu de son sens pour ne plus être qu’un songe creux, un conte de vieille femme auquel plus personne ne croit. Tout au long du roman, cette idée s’incarne dans le portrait de François-Joseph, un motif omniprésent, qui fascine le jeune Charles-Joseph dans ses villes de garnison. Un portrait qui en rappelle un autre, celui de l’aïeul, de l’écrasant « héros de Solférino ». Bien souvent, pourtant, son regard est aimanté par le portrait dans les lieux les plus déplacés : un tripot minable à la frontière russe ou un bordel pour officiers avinés dans une ville de garnison. Ce galvaudage de l’image de l’empereur est une des traces de ce délitement qui se produit sous les yeux hébétés d’alcool des officiers de François-Joseph.
Mais plus encore que les manifestations de cette décadence, ce que Joseph Roth saisit avec une extraordinaire acuité c’est la cécité de ceux qui incarnent l’Empire et ses valeurs devant l’essoufflement de celui-ci. Alors même que le roman tourne très largement autour du médiocre Charles-Joseph, la figure du préfet est fascinante d’aveuglement. Ce personnage n’est rien d’autre que sa routine. Sa promenade quotidienne, le temps passé à table, le concert hebdomadaire que la fanfare lui dédie ou la lettre bimensuelle qu’il envoie à son fils le définissent. Il est l’archétype du fonctionnaire de l’Empire : plus automate qu’humain, attaché aux formes et aux apparences qui, seules, déterminent ce qui est bon et ce qui ne l’est pas. Il est si profondément les valeurs impériales que lorsqu’il se rend compte, à son tour, que l’Empire n’est plus, avant que la guerre n’ait éclaté, il semble au lecteur que le dernier pilier des Habsbourg vient de s’effondrer.
C’est la glaçante réussite de ce roman de rendre intelligible un fait crucial : l’Empire était mort bien avant de s’effondrer. Dès les premiers pas de Charles-Joseph à l’académie militaire, l’illusion maintenue par son père est brisée, dévoilant un Empire mort-vivant, une sorte de structure organique qui tient parce que rien ne la menace profondément.
Bien sûr, Joseph Roth écrivit ce roman en 1932, et certains demi-habiles ne manqueront pas de rappeler qu’il est plus facile d’être lucide et clairvoyant lorsque tout est consommé. De même, il est entendu qu’à aucun moment, il ne tente de faire un travail d’historien. C’est plutôt le contraire, tant il cherche à se prémunir de l’histoire, ne donnant à lire presqu’aucune date ou aucun lieu précis et en racontant la vie de personnages qui, même s’ils n’avaient pas été inventés, n’ont aucune ampleur historique. Il cherche simplement à traduire un sentiment de délabrement, illustrée par cette coquille vide, l’Empire, dans laquelle se débattent des personnages médiocres. Il ne cherche pas, du reste, à avoir des accents pathétiques et le roman est plus souvent drôle que mélancolique et il est bien difficile de rester impassible devant la description sarcastique des mécaniques rouillées du cérémonial militaire ou du protocole impérial.
Un siècle après la chute des Habsbourg, il y a quelque chose de familier dans cette image d’un Empire s’enivrant d’une Marche de Radetzky triomphale plutôt que de constater sa propre mort. Les fonctionnaires de l’Union européenne devraient relire ce roman s’ils ne veulent pas, comme le préfet von Trotta, se réveiller un jour et constater que l’Union est morte depuis des années. Dans son dernier ouvrage, Le destin de l’Europe, Ivan Krastev rappelait que les Européens de l’est savent mieux qu’à l’ouest qu’une structure peut s’effondrer en quelques jours sans qu’on s’y attende. Il pensait alors à l’empire soviétique. En lisant la Marche de Radetzky, on apprend que dans l’ancienne Autriche-Hongrie, au moins, on sait qu’un Empire peut survivre longtemps à sa propre mort. Si longtemps, du reste, que la Marche de Radetzky retentit toujours à Vienne

