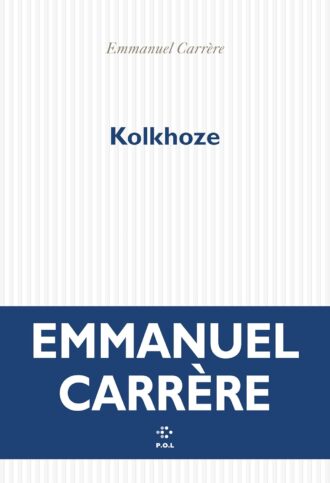Un extrait de « Kolkhoze », d’Emmanuel Carrère
En attendant la remise du Prix Grand Continent le 5 décembre, nous vous offrons des extraits des cinq œuvres finalistes.
Aujourd'hui, Kolkhoze d'Emmanuel Carrère — ou l'irruption brutale de la guerre d'Ukraine dans une vaste fresque familiale.
Le 5 décembre 2025, au cœur des Alpes, le Prix Grand Continent sera remis à un grand récit européen contemporain, dont il financera la traduction et la diffusion en cinq langues. À cette occasion, nous vous offrons des extraits des cinq finalistes de ce prix européen. Aujourd’hui, ce sont des bonnes feuilles de Kolkhoze (P.O.L, 2025).
Kolkhoze est le roman vrai d’une famille sur quatre générations, couvrant plus d’un siècle d’histoire, russe et française, jusqu’à la guerre en Ukraine.
En plongeant dans les abondantes archives de son père après le décès de sa mère, Emmanuel Carrère se passionne pour sa propre généalogie ; la trajectoire de cette famille, ballottée par l’histoire — de la révolution bolchevique à la Russie impériale de Poutine et ses guerres — conduit alors l’écrivain-biographe à une méditation sur ses attaches : de manière trouble, la vie et la mort des siens se mêle à l’amour filial.
Chapitre 25 — Les premiers jours de la guerre
Le 24 février 2022
Ce jour-là, je devais me rendre à Moscou pour tenir un petit rôle dans un film adapté de mon livre Limonov. À 6 h 30 du matin, Vladimir Poutine a annoncé à la télévision russe le début d’une « opération militaire spéciale » visant à démilitariser et dénazifier l’Ukraine. Avant même qu’il ait fini son discours, des missiles ont commencé à tomber sur Kiev et Kharkov – comme on appelait encore Kyiv et Kharkiv – tandis que des blindés russes franchissaient la frontière. Mon vol était prévu à 11 heures, j’avais mis l’alarme de mon téléphone sur 7 heures, mais j’ai été réveillé un peu avant par un appel de François, mon agent, qui avait mis sur pied toute cette affaire d’adaptation et avec qui je devais faire le voyage. Passé le moment de stupeur partagé, nous nous sommes demandé ce qu’il fallait faire.
François a pris sa grosse voix des grands jours pour dire : plus question de partir. « Est-ce que tu serais allé faire un caméo à Berlin en 1938, le jour même de l’Anschluss ? » L’argument se tenait, d’une façon générale les arguments de François se tiennent, et Charline quand elle s’est réveillée était d’autant plus d’accord qu’elle-même devait partir pour New York, où son premier film était présenté dans un festival, et regrettait que je ne puisse l’y accompagner : puisque je n’allais plus à Moscou, cela devenait possible. Mais à peine dépassée l’heure de l’embarquement, j’ai commencé à regretter mon choix. Quand François a prévenu les producteurs, ils ont dit qu’évidemment ils respectaient notre décision mais que poursuivre le tournage était un acte de résistance, que ma défection compromettait. Vu l’importance de ma scène, cinq répliques, j’ai pensé qu’ils exagéraient un peu la portée de cette résistance, mais c’était un prétexte suffisant pour me raviser et j’ai dit que, d’accord, je prenais le prochain avion.
À l’hôtel Ukraine, 3
L’hôtel Ukraine, rappelez-vous, est ce majestueux gratte-ciel stalinien où ma mère est descendue lors de son premier voyage en URSS, en 1958, puis retournée avec moi dix ans plus tard. Dans le scénario du film, c’est à l’hôtel Ukraine que son éditeur russe loge l’aventureux écrivain Édouard Limonov, de retour dans son pays en 1991, alors que la perestroïka est en train de tourner au chaos. En apprenant mes deux pages de texte, j’étais tout excité de retrouver ce lieu dont je gardais un souvenir enchanté. Déception : on ne tourne pas la scène dans le véritable hôtel Ukraine, devenu beaucoup trop luxueux et occidental, mais en studio, dans la banlieue de Moscou. Le décorateur et la directrice de casting, cela dit, ont bien travaillé. La cafétéria où je prenais le petit-déjeuner avec ma mère, cinquante-cinq ans plus tôt, a été minutieusement reconstituée, dans ces tons marronnasse et verdâtre qui étaient la couleur de l’Union soviétique. La babouchka qui jette dans votre assiette des plâtrées de kasha est renfrognée à souhait : on croirait la vraie. C’est en faisant la queue avec mon plateau que je suis supposé reconnaître et aborder Limonov. La logique voudrait que je le fasse en français car mon personnage est un intellectuel français, que Limonov lui-même a vécu en France et parle français, mais cette logique n’a pas cours dans une production internationale, entièrement anglophone, c’est donc dans mon mauvais anglais que je lui tiens un petit discours humaniste qui se termine ainsi : « … Ces changements sont extraordinaires, votre peuple est magnifique, mais il ne faudrait pas qu’il se laisse prendre au piège de notre société de consommation. Il ne faudrait pas qu’il vende son âme contre des burgers et du Coca-Cola, n’est-ce pas ? » Le jeune acteur anglais Ben Whishaw, qui incarne Limonov de façon très convaincante, me toise avec mépris : « C’est ça, comme en Afrique : si les indigènes ne se promènent plus en pagne, ça sera dommage pour les photos de vacances. » Sur quoi il se lève, s’en va. Je le suis des yeux, médusé, et repose ma tasse de thé. Je la reposerai six, sept, huit fois de suite. Six, sept, huit fois de suite, on crie : « Motor ! Kamera ! Sniato ! » – sur un plateau français, ce serait : « Moteur ! Action ! Coupez ! » – et puis le metteur en scène, Kirill Serebrennikov, considère que c’est bon : ma scène est finie. On en tourne ensuite une autre, plus complexe, avec beaucoup de figuration. Je reste dans les parages, saisissant toute occasion de parler avec la costumière à qui je rends ma veste, avec les techniciens, avec les figurants, tous effondrés. À la fin de la journée, le producteur convoque toute l’équipe, la remercie, annonce qu’on arrête le tournage. On ne sait ni quand ni où il reprendra. Ni comment ça se passera pour les salaires, la situation est inédite, on verra, on fera au mieux. Après, le producteur et Serebrennikov se sentent obligés de m’emmener dîner mais le cœur n’y est pas. Ils sont déjà en train de se demander ce que paieront les assurances, s’il vaudra mieux reprendre le tournage en Lettonie ou en Bulgarie, où la main-d’œuvre est bon marché et les crédits d’impôts élevés, et ils se débarrassent de moi en me confiant à Elena, l’assistante de production chargée du rapatriement des acteurs étrangers – le plus exigeant, parmi ceux-ci, étant Ben Whishaw, qui ne veut pas passer une nuit de plus dans un pays en guerre. La solution, dit son agent, ce serait un jet privé. Je ne sais pas s’il l’a obtenu.
La Corée du Nord ?
Le lendemain matin, Elena et moi errons d’un terminal à l’autre de l’aéroport Cheremetievo, bondé. À chaque étape, elle me pose comme un colis en souffrance sur une banquette pendant qu’elle va parlementer, d’un guichet à l’autre, d’une compagnie à l’autre. Mon vol prévu pour Paris est soit complet, soit annulé, impossible de savoir, en tout cas Air France n’opère plus. On oublie Paris. On essaie Vienne, on essaie Rome. Chaque fois on croit que c’est bon, puis le vol disparaît des tableaux d’affichage. L’ambiance, à première vue, évoque un grand départ en vacances. En réalité, c’est un exode. Venu pour trois jours, je n’ai qu’un bagage à main, les familles russes autour de moi des chariots surchargés de valises, de malles, d’énormes sacs, et en les écoutant je comprends que l’idée n’est pas de changer d’air quelques semaines, le temps que ça se tasse, mais de s’expatrier pour de bon. Quelque chose m’échappe : fuir son pays parce qu’il a été envahi par un autre, d’accord. Mais parce qu’il en a envahi un autre ? Si précipitamment, alors qu’il n’y a pas de danger immédiat… Pourquoi ? Qu’est-ce que vous risquez ? Concrètement ? « Concrètement ? me répond Elena. Concrètement, Poutine a dit : “Vous allez connaître des choses que vous ne pouvez même pas imaginer”, et là-dessus on peut lui faire confiance. Même s’il n’y a pas de guerre nucléaire, les sanctions vont être très lourdes, tout le monde va être contre nous, notre pays va devenir la Corée du Nord, je ne veux pas y élever mes enfants. Moi aussi je vais tout faire pour partir, tant que c’est possible. » Une petite fille, sept ou huit ans, tient dans ses bras un petit chat. Elle pleure en le caressant parce que le petit chat n’a pas le certificat nécessaire à l’évacuation des animaux et qu’il n’est pas certain qu’elle puisse l’emmener. Ses parents ne veulent pas lui mentir, ils ont les larmes aux yeux aussi. Si le petit chat est refoulé ils ne savent même pas ce qu’ils vont en faire, à qui le confier. Est-ce qu’ils vont l’abandonner dans un terminal de l’aéroport Cheremetievo ? Leur sort à eux n’est pas plus fixé que celui du petit chat. Les heures passent. Les files d’attente s’allongent. Les chariots tournent, se percutent comme des autos tamponneuses, des bagages en tombent. La tension monte. Dans nos trajets répétitifs d’un terminal à l’autre, que relient de longues boucles autoroutières, nous gardons désormais le taxi, un homme obèse et goguenard qui chaque fois qu’il nous dépose ne dit plus « bon voyage » mais, avec une lourde ironie, « à tout à l’heure ». Je commence à me dire qu’un grand pays qui bascule dans la guerre, on n’a pas souvent l’occasion de voir ça, et lorsque Elena, après des heures de négociations, revient vers moi triomphante, brandissant une carte d’embarquement à bord d’un avion pour Dubaï qui semble bien devoir décoller, je rassemble mon courage pour lui dire que tout bien réfléchi je préfère rester. Elle ne comprend pas. Puis comprend, et se met en colère : d’abord c’est de la folie, ensuite je lui ai fait perdre une journée alors que c’est la guerre et qu’elle a des milliers de choses à faire, enfin c’est son travail de me trouver un avion, de me mettre dans cet avion, et maintenant qu’elle l’a trouvé elle entend bien que j’y monte. Je propose de signer une décharge expliquant que la production a assuré mon exfiltration, que j’y renonce de mon propre chef et qu’à partir de là elle n’est plus responsable de moi. Pendant le trajet du retour vers Moscou, elle ne me parle plus.
À l’hôtel Ukraine, 4
L’hôtel Ukraine s’appelle maintenant le Radisson Royal Hotel, et je comprends pourquoi il n’était pas question d’y tourner le film. L’essence même, menaçante et grandiose, de l’Union soviétique a été ravalée à la banalité feutrée d’un cinq étoiles américain. J’y retrouve une petite bande d’expatriés, mes vieux et pas très fréquentables camarades, et la femme russe de l’un d’entre eux, Irina. Seul manque à l’appel Jean-Michel qui, après ses ennuis avec le FSB et son année de taule, s’est exilé en Géorgie. La question qu’ils se posent tous : mais qu’est-ce qui lui a pris ? Qu’est-ce qui lui est passé par la tête ? À quoi est-ce qu’il s’attendait ? À ce que les Ukrainiens accueillent les soldats russes en libérateurs ? Maintenant qu’ils ripostent, les Ukrainiens, et que tout le monde en Occident commence à parler de ce Zelensky que personne ne connaissait comme si c’était Churchill, est-ce qu’il ne se dit pas qu’il a fait une très très grosse connerie ? Est-ce qu’il ne rêve pas, la nuit, de pouvoir appuyer sur la touche rewind ? Georges secoue énergiquement la tête. Georges est le doyen des aventuriers français à Moscou. Son rire, une sorte de reniflement qui enfle par paliers, est, dans cette petite société, mythologique. Arrivé au tout début des années quatre-vingt-dix, il a monté quelque chose dont personne ne savait que ça pouvait exister, une radio libre, qui a extraordinairement bien marché. Il est devenu très riche, très en cour. Poutine a été son témoin de mariage. Il ne faut pas dire de mal de Poutine devant Georges. « Il y avait deux solutions, explique-t-il, la mauvaise et la pire. La mauvaise, c’est celle qu’il a choisie : la guerre contre l’Ukraine. La pire, ç’aurait été la guerre sur le territoire russe, que préparait la CIA. Il n’avait pas le choix, il fallait attaquer le premier. Et pour ce qui est de savoir si c’était une connerie, je vous donne rendez-vous dans trois ans. » (J’achève ce livre exactement trois ans plus tard, en février 2025, et il n’est pas agréable de se demander si Poutine se mord vraiment les doigts d’avoir déclenché cette guerre.) On commande des sushis effroyablement chers et de nouvelles tournées de saké, de whisky, de vodka, de grands bourgognes – au point où on en est. Les téléphones bipent au rythme des sanctions qui tombent depuis trois jours comme les missiles sur Kyiv. Chaque fois, c’est un nouvel éboulement dans un monde qu’on croyait aussi fiable qu’une voiture allemande. La réalité se défait comme dans un roman de Philip K. Dick. On pouvait imaginer une guerre mondiale, à la rigueur, mais pas que tout cela disparaisse : Volkswagen, BMW, Warner Bros, Disney, Netflix, Nike, Spotify, IKEA, Airbnb, Vuitton, Shell, Carlsberg, Boeing, Exxon, eBay, Bloomberg, CNN, la BBC, Twitter… Il y a quelques années, raconte Irina, qui occupe un poste senior dans l’industrie du luxe, un magazine branché a fait un reportage ironique sur le thème : peut-on survivre une semaine en ne consommant que des produits russes ? Réponse : on ne peut pas. Il faudra bien, pourtant, puisqu’on ne trouvera bientôt plus dans les supermarchés russes aucun produit étranger. Irina me montre son téléphone. « Tu vois, j’ai le dernier iPhone. » J’ai l’esprit lent, je crois qu’elle veut dire le dernier modèle. Elle aussi rit : « Tu n’as pas compris. Celui-là, dans ma main, c’est le dernier iPhone. » Je dis, me croyant intelligent : « Ça non, je n’y crois pas. Les gens peuvent supporter un tas de choses, la dictature s’il le faut, mais la consommation ils en ont pris l’habitude, c’est une drogue dure, si on la leur retire ils vont devenir fous. » Georges-le-poutinien : « N’importe quoi. C’est pas les électeurs de Poutine, c’est les bobos comme vous qui vont dépérir sans Netflix, sans camembert, sans voyages à l’étranger. Mais le Russe de base ? Il n’est jamais allé à l’étranger, jamais sorti de son trou, il n’a pas de passeport, qu’est-ce que ça peut lui foutre qu’on ne puisse plus rouler en Jaguar, boire du Dom Pérignon et skier à Courchevel ? »
Un boomer russe
Notre ami Guivi nous rejoint. Géorgien, veste de cuir, l’air tanné et railleur, correspondant de guerre depuis trente ans. « J’ai déjà vu ça quand j’étais tout jeune journaliste, dit-il. Mon premier poste, c’était Bagdad. L’Irak était un pays prospère, un des plus agréables à vivre du Moyen-Orient. On savait que Saddam gazait un peu ses Kurdes, on regardait ailleurs. Il a cru en envahissant le Koweït qu’on protesterait un peu pour la forme et que ça passerait, business as usual. Mais ça n’est pas passé, le monde entier s’est ligué contre lui. Embargo, sanctions, le pays prospère est devenu un pays paria, retourné à l’âge des cavernes, il y est toujours. C’est ça qui est en train de nous arriver. C’est dingue, ce qu’aura vécu un boomer russe. Vous vous rendez compte ? Un type comme moi qui a été adolescent en Union soviétique et qui a connu ce miracle total, totalement inimaginable, de la fin des années quatre-vingt. Passer d’un coup de Tchernenko à Gorbatchev, et puis le putsch, les chars dans Moscou, la thérapie de choc, les premières boîtes de nuit, les premiers voyages à l’étranger. Le fric à flots, le crime, la folie des années Eltsine. Vous n’avez aucune idée de ça en France, aucune. Qu’est-ce que vous avez vécu pendant ce temps-là, mes pauvres petits ? L’élection de Mitterrand ? J’ai peur de Le Pen, oh là là ! Un type de mon âge en Russie, il a des expériences pour dix vies, et voilà, on croyait qu’on pouvait se reposer, qu’il ne nous arriverait plus que les choses normales de la vie, acheter une datcha, vieillir, tomber malade, mourir, et il nous arrive ça, au pire la fin du monde, au mieux on va retourner dans notre trou à rats. »
Le Sud global
Je renchéris : « Guivi a raison. Poutine est complètement isolé maintenant : un paria. » Georges rit, de son hennissement triomphal et lugubre : « Tu n’as vraiment rien compris. Ce n’est pas Poutine qui est isolé, c’est vous. C’est vos pauvres petites démocraties à bout de souffle dont plus personne ne veut qui sont encerclées par le reste du monde. C’est-à-dire, excuse-moi de te le dire, par nous. » (La notion, récemment apparue, de « Sud global » enchante Georges. Il pense que le Sud global, c’est lui.)
Sergueï Narychkine passe un mauvais quart d’heure
Sur nos derniers iPhone, on se repasse comme une scène culte dans un film de gangsters, entre Scarface et Les Tontons flingueurs, la retransmission de la réunion du Conseil de sécurité qui a eu lieu le 22 février, deux jours avant l’invasion. Cela se passe dans une salle très haute de plafond, avec des colonnes à l’antique, qui pourrait être un décor de péplum. Poutine, du haut d’une très haute chaire, domine une dizaine de dignitaires assis en demi-cercle à au moins 20 mètres de lui, et leur annonce son intention de reconnaître l’indépendance des territoires russophones du Donbass, à l’est de l’Ukraine – l’étape suivante étant évidemment leur annexion. Il ordonne de se lever à Sergueï Narychkine, le chef des services de renseignements extérieurs – l’équivalent de notre DGSE – et lui demande s’il soutient cette mesure, pure provocation au regard du droit international. On comprend que Narychkine n’a aucune envie de la soutenir mais il hésite, essaie de noyer le poisson. Il dit que si ça arrive, oui, probablement, très probablement, il soutiendra. Poutine, avec un sourire menaçant et cauteleux, il fait vraiment peur : « Allons, ne finassez pas, Sergueï Evguenievitch, parlez sans détour : vous soutiendrez ou vous soutenez ? » Narychkine, homme de grand pouvoir et d’assez belle prestance, balbutie, les mains tremblantes, des choses incompréhensibles, et finit par lâcher :
« Je soutiens, je soutiens… – Eh bien voilà. Ce n’était pas si difficile. Vous pouvez vous rasseoir. » Moment extraordinaire, shakespearien : le pur sadisme du chef, humiliant son vassal devant ses pairs, devant le monde entier. C’était la première fois que je voyais la tête de Narychkine, mais je me suis rappelé ce soir-là une conversation que j’avais eue quelques mois auparavant avec ma mère. Je lui demandais qui à son avis pourrait succéder à Poutine, puisqu’il faudra bien que quelqu’un lui succède, un jour ou l’autre. Quand j’ai cité les grandes figures de l’opposition – l’oligarque Khodorkovski, qui avait passé dix ans en prison, ou Alexeï Navalny qui venait d’y entrer après avoir survécu à une tentative d’empoisonnement –, elle a dit, comme on s’adresse à un demeuré : « Khodorkovski, Navalny, évidemment pas, ça n’arrivera jamais. En revanche, quelqu’un comme Narychkine… » À l’appui de cette hypothèse, elle avait un argument qui m’a laissé songeur, c’est que ce Narychkine dont je n’avais jamais entendu parler n’était pas seulement un homme des services secrets mais portait un grand nom aristocratique, qu’on retrouvait dans la famille de Pierre le Grand et, collatéralement, dans notre famille à nous. « Et ça, pour les Russes, ce n’est pas rien », a dit ma mère sur le ton à la fois convaincu et pensif de qui voit se dessiner de grandes choses. J’aurais peut-être exprimé des doutes si elle m’avait affirmé avec le même accent d’autorité qu’être duc de Talleyrand-Périgord pouvait aider, en France, à se faire élire président de la République, mais à partir du moment où il s’agissait du pouvoir en Russie, c’était son domaine de compétence, je m’inclinais. Je voulais bien croire que pour succéder à Poutine c’était un gros atout de faire partie de notre famille – et quand j’en ai reparlé avec elle j’ai bien compris qu’elle avait détesté voir notre parent, fût-il lointain, passer un aussi mauvais quart d’heure. Elle-même, cela dit, ne passait pas un bon quart d’heure non plus. Une semaine avant l’invasion, alors que les troupes russes se massaient aux frontières de l’Ukraine, elle avait donné à la télévision française un très long entretien, presque une heure, un de ces exposés de géopolitique riches de perspectives historiques, éblouissants de clarté, qui ont fait d’elle une institution nationale, et à un moment, presque en passant, comme une évidence ne méritant pas qu’on s’y arrête, elle avait dit : « Et puis vous savez, il n’est pas fou, Poutine, il ne va quand même pas envahir l’Ukraine ! » Certains s’étaient moqués. Je l’ai appelée plusieurs fois au cours de mon séjour à Moscou. Cette femme si optimiste, par tempérament et par principe, je ne l’ai jamais entendue si désemparée. Elle répétait : « Je ne comprends pas. Je ne comprends plus. » Depuis vingt ans, elle voyait Poutine comme un autocrate et un interlocuteur brutal mais fiable à sa façon, avec qui on peut discuter si on connaît et accepte les règles de la Realpolitik. Un joueur d’échecs rusé, pas un type qui quand on s’attend à ce qu’il roque se lève brusquement, renverse la table et l’échiquier et sort un revolver dont il vous colle le canon sur le front. Elle n’a pas été seule à se tromper.
Les hôtesses de l’air
Le rouble ayant vertigineusement dévissé, je devrais avec mes euros être le roi du pétrole mais ma carte de crédit est refusée deux fois sur trois, alors je mets tout ce que je peux sur ma note d’hôtel, sans être certain de pouvoir la payer quand je partirai. Confortable sans être luxueux, cet hôtel attire normalement une clientèle d’hommes d’affaires qui s’est du jour au lendemain évaporée, en sorte que je suis seul dans la salle du petit-déjeuner, à regarder les informations sur Pervy Kanal, la première chaîne russe.
« Surréaliste » est un des adjectifs, avec « kafkaïen », « jubilatoire » et « nauséabond », que j’évite en principe d’utiliser, mais là il semble difficile de s’en passer. Des loteries, des documentaires animaliers à l’infini en pleine guerre, oui, c’est surréaliste. Selon une blague que me rapporte l’ex-correspondant de guerre Guivi, des centaines de civils, dont des dizaines d’enfants, ont déjà été tués en Ukraine, mais l’ouverture du journal de Pervy Kanal, c’est qu’un portier d’immeuble à Novgorod souffre d’un ongle incarné. Une loi est passée, réprimant les fake news. Il n’y a pas de guerre, mais une « opération militaire spéciale », donc écrire ou prononcer le mot « guerre », c’est trois ans de prison, cinq si c’est sur les réseaux sociaux, et quinze si ça a « des conséquences publiques » – allez savoir ce que c’est, des conséquences publiques. Et puis un beau matin – le 2 mars, si j’en crois mes notes –, au lieu d’animaux ou de jeux télévisés on ne voit plus que des blindés, des incendies, des corps sanglants sur des civières, et même en parlant aussi mal le russe que moi on ne peut pas se tromper quand on entend en boucle : « nazis nazis nazis, génocide génocide génocide », et, de temps à autre, pour varier, le verbe ounitchtojat’, anéantir. Un type effrayant qui s’appelle Vladimir Soloviev – homonyme d’un de ces philosophes orthodoxes et barbus qu’admirait tant ma pauvre grand-mère – anime deux heures d’antenne par jour et hurle : « Ça fait huit ans qu’on est gentils et conciliants avec l’Occident, ça suffit ! » Un invité dit : « L’opération militaire spéciale ne montre pas notre agressivité mais notre miséricorde. – Absolument ! vocifère Soloviev : notre miséricorde sera impitoyable ! » Mon camarade Georges-le-poutinien me dit : « Ne te laisse pas avoir par la propagande occidentale », et je suis toujours le premier à penser que les choses sont complexes, qu’il y a des zones grises, que la vérité n’est jamais dans un seul camp, mais Poutine et les siens, personne dans son bon sens ne peut croire que la vérité est, même un peu, de leur côté. Enfin, c’est mon impression, peut-être que le regard de l’histoire me donnera tort, qui sait ? Je sors me promener, il fait incroyablement beau, froid sec, soleil, le bleu du ciel presque aveuglant. Tout semble normal, les gens vaquent à leurs activités, pas de tension particulière. Une amie parisienne, au téléphone, me demande : « Et le peuple ? Pas les intellos comme toi ou moi : les vrais gens. Est-ce qu’ils sont complètement désinformés ? Est-ce qu’ils sont pour la guerre ? Pour Poutine ? » Difficile de se faire une idée, c’est toujours un problème, les vrais gens. Nous vivons dans nos bulles. Un autre de mes amis, italien, me disait : « Mon pays a été dirigé dix ans par Berlusconi et je n’ai jamais rencontré quelqu’un qui vote pour Berlusconi. » Mes copains les expatriés français sont ou étaient poutiniens mais ils ne sont pas du tout pour la guerre, qui ruine leurs vies. Mes amis russes sont partis ou ne répondent pas, alors mon seul moyen de rencontrer des vrais gens c’est de prendre des taxis. Un tiers des chauffeurs refusent tout échange – surtout au début, quand j’employais le mot voïna, guerre, parce que je ne savais pas encore que rien que l’entendre pouvait vous envoyer au trou. Deuxième tiers : ceux qui répètent ce que dit la télé sur le génocide des Russes dans le Donbass, les nazis qu’il faut éradiquer, Poutine qui ne désire que la paix et fait de son mieux pour sauver le monde. Le troisième tiers, le plus gros tiers, dit que c’est des conneries, tout ça. Guerre ? Quelle guerre ? Regardez, il fait beau, les gens sont dehors, ils se promènent, ils font leurs courses. C’est ça, la guerre ? La guerre, c’est Stalingrad. Vsio normal’no : tout est normal – mais normal’no, un des mots les plus usités en russe, veut dire beaucoup plus que « normal ». En gros : c’est OK, tout est sous contrôle, les gens dont c’est le métier de gérer gèrent, ils savent ce qu’ils font, circulez. Normal’no. Je rentre à l’hôtel, je remonte dans ma chambre, la dame responsable de l’étage a pleuré, elle dit que ce qui se passe est oujasno, affreux. J’essaie d’écrire le reportage que j’ai promis à l’Obs, l’hebdomadaire pour lequel je suis au long cours, cette année, le monumental procès des attentats du 13 novembre 2015, à Paris. C’est la première fois que je manque les audiences, j’ai promis de les reprendre à mon retour, mon article est supposé paraître la semaine prochaine mais personne ne sait à quoi ressemblera la semaine prochaine, ni même s’il y aura une semaine prochaine. Le 6 mars au petit-déjeuner, toujours sur Pervy Kanal, Poutine qu’on n’avait plus vu depuis son grand discours paranoïaque, à l’aube du 24 février, reparaît à la télévision, repoussant les frontières du surréalisme parce qu’au lieu de se tenir en haut d’une très haute chaire, écrasant ses vassaux, ou séparé de son interlocuteur par une table de 15 mètres, il est cette fois familièrement attablé avec une délégation d’hôtesses de l’air et leur explique où on en est de la guerre. Les hôtesses de l’air sont une vingtaine autour de lui, attentives et pimpantes, jolies sans excès, tout ce monde au coude-à-coude et lui-même détendu, avunculaire, buvant du thé – la prochaine fois, on se dit qu’il aura comme Staline des petits enfants sur les genoux. Avec ça, il dit les choses sans ambages mais pas comme un paranoïaque, cette fois, plutôt comme un type énergique et franc du collier, qui aime les affaires rondement menées. Il dit par exemple que les sanctions, ça commence à bien faire, si ça continue on va considérer que c’est un acte de guerre – et donc que ça n’est plus seulement avec l’Ukraine que la Russie, malgré sa patience, est en guerre, mais avec tous les pays qui soutiennent l’Ukraine. Avec nous par exemple, nous la France. Ce qu’il dit est hallucinant, mais il le dit aux hôtesses de l’air sur un ton raisonnable, humain, et si on trouvait déjà terrifiant que notre sort à tous dépende d’un homme aux abois, on se demande tout à coup si ce n’est pas encore plus terrifiant qu’il n’ait pas du tout l’air aux abois.
Le rêve de Macha
« Quand j’étais petite, je rêvais que je me cachais dans la cave d’une maison bombardée, à moitié en ruine. J’entendais, dehors, des rafales de mitraillettes. Ceux qui tiraient, c’étaient les nazis. J’avais peur qu’ils me trouvent et me tuent comme ils avaient tué ma famille. Depuis le début de la guerre, je refais ce rêve mais il est pire. Parce qu’il y a un moment où je comprends que si on me recherche pour me tuer c’est parce que c’est moi la nazie, et je me réveille en criant. » Macha, mon ex-éditrice avec qui, rappelez-vous, j’ai assisté à la remise des médailles dans l’ordre « Gloire de la Russie », est en face de moi dans le hall de l’hôtel. Elle a toujours son élégance excentrique, sa finesse nerveuse, sa voix éraillée, mais ce qui a disparu, c’est l’ironie qui était sa manière d’être par défaut. Elle dit : « Le monde entier nous hait maintenant, nous les Russes. » J’essaie de la réconforter, je lui dis que les gens, enfin les gens, je ne sais pas, mais beaucoup de Français comme moi sont parfaitement capables de faire la différence entre les Russes et leur président. Elle est sceptique : « Tu crois vraiment qu’ils font la différence ? Moi, ce que je peux te dire, c’est que les Ukrainiens, je les envie. Ce sont des héros, ils sont prêts à se battre et à mourir. Ils agissent. Nous on vit soit dans la folie soit dans la peur et la honte. » Elle se met à pleurer. « Ne fais pas attention, dit-elle, je n’arrête pas de pleurer maintenant. » Le rêve qu’elle vient de me raconter, elle l’a écrit sur sa page Facebook – quand il y avait encore Facebook. Sa mère l’a appelée, terrifiée, furieuse, parce qu’elle les mettait tous en danger. La plupart de ses amis se sont désinscrits de son compte. Elle les a tous perdus.
« C’est comme vous le 11 septembre 2001, tout le monde en Russie se rappellera jusqu’à sa mort ce qu’il faisait le matin du 24 février 2022. Moi j’étais en Géorgie pour le mariage de ma meilleure amie, Sonia. On était toute une bande, qui nous connaissons depuis longtemps. Sonia est riche, son nouveau mari aussi, ils avaient privatisé un hôtel magnifique, peut-être le plus bel hôtel où j’aie jamais dormi, au pied du mont Kazbek, si tu as l’occasion d’y aller un jour ne rate pas ça. On était inquiets, la veille. Comme tout le monde, on parlait de la situation mais on a quand même fait la fête, on s’est couchés vers 4 heures, 4 h 30 du matin, et puis à 7 heures Olga a frappé à ma porte et elle m’a dit : « Réveille-toi, c’est la guerre. » Je suis descendue, tout le monde était rassemblé dans le merveilleux restaurant de l’hôtel. On pleurait, on se serrait dans les bras, on avait tous compris que la vie assez cool qu’on menait jusqu’à présent c’était fini. On ne savait pas à quel point, on ne savait pas que ça irait si vite. Le jour s’est levé sur les montagnes, la neige, c’était sublime. Il y en a plusieurs de notre bande qui soutiennent la guerre maintenant, on ne peut plus se parler. On est devenus des ennemis. Et ceux qui ne la soutiennent pas ils sont partis. Beaucoup à Tbilissi. – Mais toi, tu ne veux pas partir ? » Elle hausse les épaules : « Pour aller où ? Pour faire quoi ? Je n’ai pas d’argent, pas de visa, j’ai cinquante-deux ans, ma fille en a seize – heureusement, ce n’est pas un garçon, elle ne risque pas d’être mobilisée. Elle essaie de mener avec ses copains sa vie d’adolescente mais ils ont déjà compris, elle et ses copains, que maintenant commence la vie sans Netflix, la vie sans TikTok, un voyage dans le temps et vers les ténèbres. La seule chose qui me rassure, c’est que notre pays est très grand. Tu sais, moi je suis née à Magadan… » Non, je ne savais pas. C’est souvent comme ça en Russie, on n’a pas besoin de gratter beaucoup pour que s’ouvre sous une case sociologique rassurante – édition, classe moyenne moscovite – la trappe de la grande et terrible histoire soviétique. Magadan, au nord de Vladivostok, c’était comme le savent les lecteurs de Soljenitsyne et de Chalamov la porte d’entrée du goulag. Macha en est partie à cinq ans, ce sont des souvenirs flous pour elle mais elle envisage sérieusement d’y retourner, avec sa fille. « C’est très loin, très froid, on peut s’y cacher. Peut-être que là-bas on apprendra à vivre autrement. Peut-être que ce sera bien. » Macha éclate en sanglots.
La seule vérité
Avant de partir, elle me dit : « Moi, je crois aux derniers instants de la vie, au regard que chacun porte sur la sienne quand il la quitte. Est-ce que j’ai bien vécu ou non ? Est-ce que j’ai fait plus de bien que de mal ? C’est la seule vérité. Je n’aimerais pas être celui qui a commencé ça. »
Chapitre 26 — La Nouvelle Rome
[…]
Z
De tous les événements historiques dont j’ai été contemporain, aucun ne m’a autant passionné que la guerre en Ukraine. Je n’en ai suivi aucun avec autant de vigilance. Darius Rochebin, sur LCI, ne se contentait pas d’inviter ma mère et les dizaines d’experts, diplomates et militaires, qui jouissaient de leur quart d’heure de gloire comme en avaient joui, deux ans plus tôt, les médecins autoproclamés spécialistes du Covid. Ses journalistes documentaient aussi, heure par heure, les combats, dans le Donbass, pour 100 mètres de terrain, pour un pont, pour une carcasse d’immeuble dans une ville réduite en cendres. J’avais bien conscience que toutes ces vidéos filmées par des drones ou des caméras fixées aux casques des soldats n’aidaient en rien à comprendre ce qui se passait – mais comprendre ce qui se passait n’était en réalité pas difficile, et pas difficile non plus, pour une fois, de choisir son camp. Je préférais éviter ce sujet avec ma mère, mais il me semblait clair que toutes les nuances et complexités historiques qui lui étaient si chères ne changeaient rien à quelque chose de très simple, c’est qu’il y a dans cette affaire un agressé et un agresseur, un faible qui n’a rien demandé et un fort décidé à imposer sa loi, une démocratie imparfaite, corrompue tant qu’on veut, mais une démocratie, et une dictature de moins en moins dissimulée. (J’écris cela, au printemps 2024, juste après l’assassinat d’Alexeï Navalny et c’est pareil : Navalny d’un côté, Poutine de l’autre, il n’y a ni ambiguïté, ni zone grise, ni torts partagés. Ce qui est en revanche surprenant c’est que le héros ait à ce point une tête de héros et le méchant à ce point une tête de méchant : dans un film, on n’oserait pas.) Si j’essaie de réfléchir à ce qui se joue pour moi dans cette affaire, je vois bien que j’admire la résistance des Ukrainiens et souhaite leur victoire, mais que ce qui me passionne et me terrifie, au fond, ce qui explique cette addiction médusée, c’est le visage que cette guerre révèle de la Russie. Pas seulement celui qu’on voit au front : les cadavres de civils découverts à Boutcha, mains liées dans le dos, les femmes violées, les enfants déportés, le sadisme permis et même encouragé par le commandement, ce marécage de boue et de sang où pataugent et s’entre-tuent des volontaires héroïques, des pauvres gars envoyés dans le hachoir à viande et des serial killers tirés de prisons russes. C’est la guerre, cela, et la guerre est horrible. C’est le front, et le front est atroce. Mais à l’arrière du front il y a le pays. Il y a le peuple russe, et c’est toujours la même question : que pense-t-il, le peuple russe ? Est-ce qu’il soutient Poutine ? Dans quelles proportions ? Cette question est sans réponse car les statistiques, en Russie, ne valent rien. Mais si on a gardé des liens avec des amis restés là-bas, si on se branche sur la télévision et surtout les réseaux sociaux russes, comme le fait mon camarade l’écrivain Iegor Gran, ce qu’on entrevoit, c’est un peuple qui bascule dans une gigantesque dystopie. Dans 1984, chacun doit chaque jour participer à deux minutes de haine collective. La télé russe martèle cette haine 24 heures sur 24. 24 heures sur 24, c’est la même incantation : l’Occident veut la mort de la Russie mais la Russie vaincra comme elle a toujours vaincu parce qu’elle est la Troisième Rome et que sa vie est misérable mais que son âme est forte, alors que la vie de l’Occident est agréable mais son âme faible, dégénérée, minée par les LGBTQ+, les woke, les écologistes, les nazis et les pédophiles. « La raison de l’opération militaire spéciale, dit le ministre des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov – celui avec qui Salomé se flattait de négocier dans le respect mutuel –, la raison de l’opération militaire spéciale réside dans le contentement de soi des pays occidentaux depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale. » « Vous avez la belle vie, nous on vit dans la merde » : c’est ce qu’on me disait déjà à Kotelnitch. Mais à Kotelnitch, au début de ce siècle, ils avaient encore honte de vivre dans la merde. Ceux qui vivent dans la merde, Poutine leur a rendu la fierté. Vivre dans la merde est le signe de leur élection. Ils sont le sel de la terre. Ils font peur à nouveau : aux pédés, aux trans, à tous ces déviants dont le « contentement de soi » offense la Russie. Il est bon de faire partie de cette foule qui fait peur, il est bon de haïr ceux qui n’en font pas partie. Ceux-là, on leur pourrit la vie sur les réseaux sociaux, on les pourchasse, on trace de grands Z sur leurs portes. La lettre Z, à l’origine un marquage militaire, est devenue le symbole du soutien à l’opération spéciale, aux soldats, au président. On la voit partout. On en badigeonne les blindés, les murs, les statues de Lénine, les portes de salon de coiffure. On se la tatoue sur le front, on se rase le crâne en traçant sa marque. Les enfants des écoles se rassemblent pour former d’immenses Z, qu’on voit du ciel et montre à la télévision. Le Z est la croix gammée du poutinisme. Entre Z et non-Z, la division est partout : au travail, dans les familles. Le mari ne parle plus à la femme, le frère pas à la sœur. On s’est fait des illusions en pensant que le poutinisme était simplement un régime mafieux, mû par cette chose somme toute rassurante qu’est la cupidité. Il s’agit de tout autre chose. Il s’agit de créer et d’exposer aux yeux du monde un homme nouveau, un vrai Russe habité par le ressentiment, la violence, l’ignorance crasse et la fierté mauvaise d’avoir compris que la vie, c’est la guerre de tous contre tous. Sur le blog d’un historien russe en exil : « La Russie voulait être la Troisième Rome, elle est devenue le Quatrième Reich. »