« La consultation gynécologique constitue un haut lieu d’argumentation », une conversation avec Aurore Koechlin
Dans le monde de la santé et du soin, le suivi gynécologique occupe une place à part. Pour essayer de comprendre cette spécificité, la sociologue Aurore Koechlin a mené une enquête au long cours dont elle présente les résultats dans son nouveau livre La norme gynécologique, paru en septembre chez Amsterdam. Dans cet entretien, elle revient notamment sur ce que cette étude nous dit de la « carrière gynécologique », fruit d'une construction sociale et créatrice de normes.
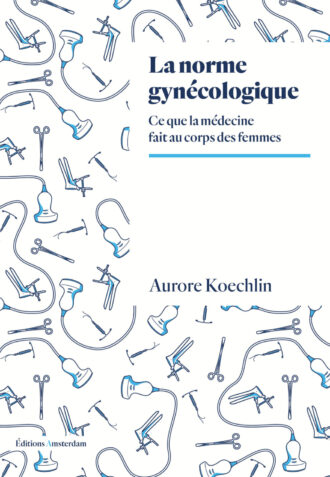
Qu’est-ce que la norme gynécologique et comment se développe-t-elle ?
J’ai nommé « norme gynécologique » la norme qui enjoint les femmes à consulter régulièrement un ou une professionnelle de santé pour le suivi gynécologique, centré sur la contraception et le dépistage. Le suivi gynécologique a lui-même une triple particularité : d’abord, il instaure une temporalité particulière, idéalement une fois l’an, sans qu’il y ait, ensuite, nécessité d’un motif de consultation, et, il est enfin genré, puisque l’andrologie ne met pas en place une telle prise en charge.
Il s’agit d’une norme dans un triple sens. Premièrement, c’est un construit social et historiquement situé. Il existe, deuxièmement, une pression sociale exercée par différentes instances pour s’y conformer. Enfin, le corollaire à cela est que si on y déroge, on est rappelé à l’ordre de la norme.
Dire qu’il s’agit d’une norme ne veut pas dire qu’elle est mauvaise en soi. C’est le propre de toute société humaine que de se doter de normes, et le rôle de la sociologie, qui les met en lumière, n’est pas d’abord de les remettre en question mais déjà de les visibiliser pour ce qu’elles sont.
En effet, ce qui m’interrogeait en faisant cette recherche, c’était moins l’existence en tant que telle de cette norme que son invisibilisation en tant que norme, et sa justification implicite : l’idée que les corps des femmes nécessiteraient un tel suivi, parce qu’ils seraient plus pathologiques que les autres corps, ou en tout cas davantage à contrôler. Je m’intéressais aussi aux effets d’une telle norme, qui étaient là également peu interrogés.
Ce qui m’interrogeait en faisant cette recherche, c’était moins l’existence en tant que telle de cette norme que son invisibilisation en tant que norme, et sa justification implicite.
Aurore Koechlin
Dès lors, je démontre dans mon livre les trois points précédents :
1. La norme gynécologique a une histoire ; elle émerge au moment de la légalisation de la contraception, qui est obtenue notamment avec l’idée que la contraception permettra de prévenir les avortements. Pour ce faire, il faut donc que sa prise soit encadrée, et c’est aux médecins, et en particulier aux gynécologues, qu’on confie cette tâche. Parallèlement, comme on manque de recul sur les effets sur le long terme de la contraception, la pratique systématique du frottis et de la palpation des seins se développe au même moment. C’est alors qu’émerge la norme gynécologique.
2. La norme gynécologique est produite et reproduite par un certain nombre d’instances – les médecins, évidemment, mais aussi la famille, en particulier la mère, les pairs, l’école dans une moindre mesure, et les patientes elles-mêmes. Elle est donc le fruit d’un travail incessant pour parvenir à suivre et à être suivie.
3. Les femmes qui dérogent à cette norme, en tout cas de ce que j’ai pu en observer, sont rares, montrant bien par là la force de la norme.
Qu’est-ce qui a mené à la dénonciation de cette norme à travers les « résistances » que vous évoquez dans le dernier chapitre de votre ouvrage, et en particulier à la dénonciation des violences gynécologiques ?
Depuis quelques années, la gynécologie traverse un certain nombre de controverses médiatiques, qui viennent l’interroger. Elle est d’abord remise en question dans ses moyens, avec ce qu’on a appelé « la crise de la pilule » de l’hiver 2012-2013, suite au dépôt de plainte contre les laboratoires pharmaceutiques Bayer d’une patiente qui lie son AVC à la prise de la pilule. Au-delà de la remise en question d’un modèle contraceptif français centré sur la pilule, on a pu assister également à une interrogation quant aux effets des hormones en général, qui sont l’instrument clé de la spécialité.
Questionnée, la gynécologie l’est ensuite dans ses méthodes, ce qui peut prendre la forme paroxystique de la dénonciation des violences obstétricales et gynécologiques. On voit qu’à chaque fois, ce n’est pas la norme gynécologique qui est directement remise en cause. Néanmoins, ces enjeux sont présents en filigrane. Le soupçon porté sur les hormones semble moins être la manifestation d’une promotion du naturel que la demande d’une contraception moins médicalisée, et par là, davantage accessible. De la même façon, la remise en cause des violences gynécologiques montre implicitement ce que l’existence de cette norme peut avoir de violent.
Au-delà de la remise en question d’un modèle contraceptif français centré sur la pilule, on a pu assister également à une interrogation quant aux effets des hormones en général, qui sont l’instrument clé de la spécialité.
Aurore Koechlin
Comment la norme gynécologique s’articule-t-elle avec le concept de « carrière gynécologique », et comment pourrait-on définir ce dernier ?
Le fait de suivre la norme gynécologique implique d’entrer dans une carrière de patiente et de la poursuivre idéalement tout au long de sa vie. La notion de carrière a en fait été une arme dans mon entreprise de dénaturalisation de la norme gynécologique. L’usage du terme de carrière de patientes est assez classique dans la sociologie de la santé. Il permet de mettre en lumière trois choses. D’abord, l’aspect construit et social de la maladie. Dire qu’on entre dans une carrière de patient, c’est montrer qu’il y a des éléments qui ne se réduisent pas à des enjeux biologiques : on est pris en charge par les médecins, par une institution (l’hôpital), qui a des effets propres. Ensuite, le travail spécifique du patient, qui n’est pas un simple réceptacle du soin, mais à qui on confie des tâches et un rôle tout au long de sa carrière. Enfin, ce concept souligne un élément important, la temporalité de la carrière. On entre, on demeure, et on sort de la carrière. Cela implique d’étudier cette temporalité spécifique.
Dans le cas de la gynécologie, nous sommes face à une carrière de patientes qui par bien des aspects ressemble à une anti-carrière : contrairement à la majorité des carrières de patients – non genrées, liées à un diagnostic, et le plus souvent courtes, qu’elles se résolvent par la guérison ou par la mort, sauf dans les cas de maladies chroniques – la carrière gynécologique est liée au genre, et dure idéalement toute la vie. C’est pourquoi il a pu être difficile d’objectiver les différentes étapes de cette carrière, en particulier l’entrée, lors des entretiens que j’ai menés avec des patientes : la plupart d’entre elles n’avaient pas de souvenir d’avoir commencé à consulter. J’ai surmonté cette difficulté notamment par le biais des observations, que j’ai pu croiser avec les entretiens. L’usage du terme a néanmoins été utile, à la fois pour séquencer et rendre intelligible les grandes étapes de cette carrière, et pour ne pas les naturaliser. En effet, le suivi gynécologique se présente souvent comme un suivi de l’évolution biologique des corps : il s’agirait d’accompagner médicalement leurs évolutions, tout au long de la vie (puberté, grossesse, ménopause, pour le dire rapidement). En réalité, il s’agit bien plus souvent d’un suivi de l’intervention médicale sur ces corps : la contraception en premier lieu, la prise d’hormones plus en général, et enfin les examens de dépistage.
La carrière gynécologique est liée au genre, et dure idéalement toute la vie. C’est pourquoi il a pu être difficile d’objectiver les différentes étapes de cette carrière.
Aurore Koechlin
De même, la norme gynécologique s’articule avec d’autres concepts, ceux de « norme contraceptive » et de « norme préventive ». Ces différents concepts peuvent s’opposer, se superposer, et se combiner de différentes manières avec la norme gynécologique. Pouvez-vous revenir sur ces articulations ?
La norme contraceptive a été théorisée par Nathalie Bajos et Michèle Ferrand comme la norme qui enjoint à se contracepter si on ne veut pas avoir d’enfant. La norme préventive, elle, a pu être définie par Gabriel Girard comme une norme « élaborée historiquement autour de la promotion du préservatif », centrée sur la prévention des IST. J’en propose un usage élargi à la prévention non seulement des IST, mais aussi des cancers : il s’agit de la norme qui implique que tout individu doit se faire dépister quand il a un comportement à risque ou quand il fait partie d’une population à risque.
Dans mon livre, je montre comment l’entrée dans la carrière gynécologique repose sur la simultanéité de trois entrées – dans la sexualité hétérosexuelle, dans la contraception et dans la carrière gynécologique. On prend rendez-vous chez la gynécologue lorsque l’on commence à avoir des rapports hétérosexuels afin d’avoir accès à la contraception médicalisée. On voit donc comment la norme contraceptive joue ici dans le sens de la norme gynécologique. Une autre entrée est néanmoins possible, cette fois-ci par la norme préventive. Celle-ci peut alors s’associer à la norme contraceptive – par exemple au moment de l’entrée dans la sexualité hétérosexuelle, en commençant une contraception et en réalisant un dépistage des IST –, ou la remplacer si elle n’a pas fonctionné pour diverses raisons : les patientes peuvent ainsi entrer dans la carrière gynécologique pour réaliser le frottis. L’âge joue à ce titre un rôle déterminant : plus les patientes avancent en âge, plus la norme contraceptive s’affaiblit au profit de la norme préventive – à la fois parce que la ménopause fait disparaître la nécessité de se contracepter, et parce que l’avancée en âge accroît les risques de cancer.
On prend rendez-vous chez la gynécologue lorsque l’on commence à avoir des rapports hétérosexuels afin d’avoir accès à la contraception médicalisée. On voit donc comment la norme contraceptive joue ici dans le sens de la norme gynécologique.
Aurore Koechlin
Néanmoins, la norme gynécologique repose plus fortement sur la norme contraceptive que sur la norme préventive, pour plusieurs raisons : l’entrée dans la carrière repose sur cette première norme ; dans l’imaginaire collectif, le lien entre gynécologie médicale et contraception est fort. Enfin, la limitation médicale de l’accès à la contraception constitue un instrument très matériel de renforcement de la norme gynécologique. Si la norme préventive est au cœur du mandat que se fixe la gynécologie médicale, elle a pour le moment moins d’efficace que la norme contraceptive, probablement parce que cette dernière repose davantage sur l’initiative des patientes. Ainsi, le décrochage, au moins ponctuel, de la carrière gynécologique, est souvent lié à l’arrêt de la contraception ou à la ménopause, la seule norme préventive n’étant plus suffisamment forte pour maintenir les patientes dans la carrière gynécologique. Elle n’en demeure pas moins un des piliers de la norme gynécologique.
Pouvez-vous préciser le type d’enquête que vous avez mené, et le statut ambigu que vous avez acquis lors de votre travail sur le terrain, celui de « profane experte », dans le cadre d’une enquête sur l’intime ?
J’ai effectué une enquête ethnographique au long cours, entre 2015 et 2018, à partir de cinq terrains. J’ai ainsi mené des observations et des entretiens en Seine-Saint-Denis et à Paris, en Protection Maternelle et Infantile (PMI), en cabinet, et à l’hôpital. Dans ces cadres, j’ai pu assister à des consultations gynécologiques, et mener des interviews avec des professionnels et des professionnelles de santé de différents statuts et avec des patientes. Enfin, j’ai réalisé un petit terrain auprès de praticiennes féministes de l’auto-gynécologie, à partir d’entretiens et d’observations participantes.
Initialement totalement extérieure au monde médical, j’ai ainsi progressivement occupé un statut de « profane experte » sur le terrain. Sans pour autant être médecin, et demeurant une profane représentant les patientes, j’avais la particularité d’être passée de « l’autre côté » par mon insertion dans le groupe médical, et ainsi d’occuper un statut intermédiaire. Dès lors, j’en savais plus que les patientes sur les questions médicales. Inversement, par rapport aux autres médecins, j’avais développé une connaissance des trajectoires des patientes, de l’histoire des endroits observés, j’avais eu progressivement accès à presque tous les témoignages des équipes médicales. Je disposais ainsi d’une expertise particulière : plus le temps passait, plus j’accumulais des connaissances sur la gynécologie et sur le lieu à propos duquel j’enquêtais. Or comme l’a souligné Everett Hughes cité par Howard S. Becker : « Il n’y a rien que je sache qu’au moins un des membres de ce groupe ne sache également, mais, comme je sais ce qu’ils savent tous, j’en sais plus que n’importe lequel d’entre eux. »
Sans pour autant être médecin, et demeurant une profane représentant les patientes, j’avais la particularité d’être passée de « l’autre côté » par mon insertion dans le groupe médical, et ainsi d’occuper un statut intermédiaire.
Aurore Koechlin
Cette position intermédiaire a eu des effets sur le terrain : ainsi les patientes comme les médecins ont pu me demander d’intervenir en diverses circonstances, demandes que j’ai acceptées ou non. Elle est venue dessiner ma position de sociologue également, à mi-chemin entre les médecins et les patientes, et qui du fait de ce statut même, a la capacité de comprendre les logiques contradictoires qui parfois s’affrontent en consultation, et par là de donner des pistes pour résorber le gouffre. J’ai ainsi essayé de me dégager des controverses médiatiques autour de la gynécologie pour faire un pas de côté, essayer d’éclairer les causes mêmes du débat, replacer la position de tel ou tel acteur ou actrice dans un contexte qui l’explique en partie. C’est pourquoi le livre ne s’est voulu ni pour ni contre la gynécologie ou la norme gynécologique. Néanmoins, ma boussole est demeurée les patientes, parce que mon engagement émotionnel s’est d’abord porté vers elles, qui ont accepté ma présence et qui m’ont confié leurs voix, et que j’ai la responsabilité de porter.
Vous montrez qu’il y a des stratégies mises en place pour réactiver, relancer le suivi, ou rattraper une patiente qui en est sortie. Quelles sont-elles ? Il est d’ailleurs intéressant de voir que ces stratégies ne sont pas uniquement mises en place par les gynécologues : les hôpitaux, mais également la famille et les pairs sont des instances qui permettent le maintien dans la carrière gynécologique.
Tout à fait. Les gynécologues, ou plus globalement les médecins, ne sont qu’une instance parmi d’autres, même si elle est centrale, dans la production et la reproduction de la norme gynécologique. Quatre instances jouent principalement dans le maintien dans la carrière, ou dans son retour une fois qu’on a décroché. Du côté des médecins, parvenir à suivre et obtenir que les patientes acceptent d’être suivies est un des objectifs clés de la consultation. Pour ce faire, ils et elles mettent en place une stratégie que j’ai qualifiée, en reprenant les termes d’une enquêtée, de stratégie du « bâton » et de la « carotte » : il s’agit à la fois de menacer et de récompenser pour convaincre.
La consultation gynécologique a ceci de particulier que, comme toute consultation médicale, les patientes en sont à l’initiative, mais que contrairement aux autres consultations médicales, les patientes ne sont que peu contraintes de s’y rendre par le nécessaire traitement des pathologies. Il s’agit moins d’enjeux de santé immédiats que d’enjeux de prévention (frottis, palpation de seins) et de mode de vie (contraception). Dès lors, les professionnelles et les professionnels de santé utilisent le principal moyen à leur disposition pour garantir le maintien dans la carrière gynécologique des patientes, leur monopole de prescription, en particulier de la contraception. Refuser de prescrire ou repousser la prescription à un prochain rendez-vous constitue ainsi l’arme de la profession pour maintenir le suivi.
Les patientes elles-mêmes sont la deuxième instance clé de maintien ou de retour dans la carrière. Socialisées depuis la puberté et/ou leur entrée dans la sexualité à la nécessité de consulter, elles intériorisent la norme et reprennent globalement à leur compte le discours professionnel selon lequel la consultation gynécologique est un moment « désagréable » mais « obligé ».
La consultation gynécologique a ceci de particulier que, comme toute consultation médicale, les patientes en sont à l’initiative, mais que contrairement aux autres consultations médicales, les patientes ne sont que peu contraintes de s’y rendre par le nécessaire traitement des pathologies.
Aurore Koechlin
Troisième instance d’entrée et de maintien dans la carrière : les femmes de la famille et les pairs, en particulier la mère. Les mères prescrivent et proscrivent les conduites, socialisent aux différentes normes, conseillent pour la contraception, poussent à suivre la norme gynécologique : elles poussent à consulter une gynécologue, elles conseillent leur propre gynécologue, elles accompagnent leurs filles en consultation. De façon amusante, en fin de carrière, on assiste à un curieux retournement : ce sont les filles qui re-convainquent leur mère de se conformer à la norme gynécologique. Le retour dans la carrière gynécologique s’effectue comme le miroir inversé de l’entrée dans la carrière.
Enfin, la dernière instance centrale dans la carrière est une instance de rattrapage, l’hôpital. Le rôle de l’hôpital est fondamental car les patientes s’y rendent pour des événements gynécologiques qui ne sont pas liés au suivi, en particulier les urgences gynécologiques, les grossesses, et les IVG. À chaque fois, cela peut être un moment de rattrapage pour les professionnelles et les professionnels de santé : ces derniers et ces dernières essayent alors de faire entrer, de maintenir, ou de faire revenir les patientes dans la carrière gynécologique si elles ont décroché.
La norme gynécologique introduit l’intériorisation du risque chez les patientes, qui peut mener à l’angoisse, à une prévision constante du risque, mais une prévision qui est entachée d’ignorance. Pourriez-vous revenir sur ce paradoxe du risque, la manière dont il affecte les femmes et produit également la norme gynécologique en associant prévention du risque et suivi gynécologique ?
Il y a plusieurs points de tension autour du risque dans le cadre de la consultation gynécologique, qui se déploient par ailleurs certainement dans d’autres espaces médicaux. Tout d’abord, alors que les causes d’augmentation des risques concernant la santé se situent en premier lieu au niveau environnemental et global, le propre de la consultation est d’essayer d’agir sur les comportements individuels. Cette individualisation entraîne un risque de moralisation des comportements, et une responsabilisation très forte, mais pose aussi question : qui décide en dernière instance de prendre des risques ou non – le médecin ou la patiente ?
Par ailleurs, la médecine préventive implique que la patiente joue de plus en plus le rôle de « sentinelle » pour veiller aux différents signes de son corps et qu’elle sache reconnaître certains symptômes, au moins partiellement. Le paradoxe est que dans le même temps, on ne lui donne pas l’entièreté des moyens pour mener à bien ce rôle, puisqu’elle n’est pas médecin, ne sait pas discriminer entre les symptômes, et ne dispose pas des informations nécessaires pour les reconnaître efficacement. Surtout, elle n’est pas extérieure à son propre corps, et peut difficilement endosser pour cette raison même le regard médical, qui s’est construit sur le principe d’extériorité au corps qu’il traite. La patiente se retrouve ainsi dans une position intenable, entre possession et dépossession de son corps, entre connaissance et ignorance, entre capacité d’agir et nécessité de s’en remettre aux médecins.
La patiente se retrouve dans une position intenable, entre possession et dépossession de son corps, entre connaissance et ignorance, entre capacité d’agir et nécessité de s’en remettre aux médecins.
Aurore Koechlin
J’ai interprété l’angoisse que j’ai rencontrée chez beaucoup de patientes comme un symptôme de cette situation paradoxale. En effet, à ma grande surprise, beaucoup d’entre elles ont exprimé en entretien une angoisse forte liée à des actes pourtant aussi quotidiens dans la pratique gynécologique que le frottis, la palpation des seins, ou l’imagerie des ovaires. En observation, j’ai pu assister à des manifestations paroxystiques de cette angoisse, qui pouvaient d’abord apparaître comme dénuées de sens – comme la peur de ne plus avoir d’ovaires, ou que le stérilet n’explose ou ne rouille à l’intérieur de son corps. Mais plutôt que de l’irrationalité, j’y ai lu un symptôme de la contradiction dans laquelle étaient plongées les patientes.
Vous adoptez, dans un de vos chapitres, une lecture « intersectionnelle » de la relation gynécologique. Pourriez-vous nous expliquer en quoi celle-ci consiste ? Il est par ailleurs intéressant de constater que votre étude ne porte pas uniquement sur la relation gynécologique mais également sur la relation entre les internes, pour faire voir les « coulisses d’une profession », pour reprendre l’expression d’Erving Goffman, que vous citez.
Progressivement sur le terrain s’est imposé ce constat : si le genre structure bien sûr la relation gynécologique de part en part, la classe et la race également. J’avais anticipé la question de la classe, notamment en faisant volontairement le grand écart en termes de terrains entre une PMI de Seine-Saint-Denis entièrement remboursée et une clinique des beaux quartiers parisiens avec des dépassements d’honoraire très importants. Mais j’avais moins anticipé à quelle point la race jouait également fortement. C’est pourquoi j’ai essayé de développer une analyse « intersectionnelle », pour reprendre le terme de Kimberlé Crenshaw, de la consultation gynécologique. Ce terme est source de beaucoup de méprise : en sociologie, nous l’utilisons principalement pour dire qu’un rapport de domination sociale ne peut pas être compris isolément, et qu’il faut penser le genre, la classe et la race ensemble, ainsi que leurs articulations.
Sur mes deux terrains en Seine-Saint-Denis, la race structurait de façon très forte les relations aussi bien entre les médecins eux-mêmes (dont les internes), qu’entre eux et leurs patientes. Ce qui était intéressant était que la race pouvait, en fonction des situations, jouer comme signifiant naturalisé de la classe, ou s’autonomiser totalement d’elle, et signifier surtout l’altérité d’origine et/ou de culture. De la même façon, elle pouvait jouer de façon positive ou négative dans la relation gynécologique. Par exemple, elle fonctionnait de façon positive quand une mutuelle racisation créait une proximité avec le médecin, même si ce rapprochement était souvent initié par les patientes. Mais elle pouvait aussi fonctionner négativement quand les médecins, anticipant une difficile communication, pour des raisons de langue et/ou d’origine, tendaient à présenter de façon succincte les enjeux médicaux de la consultation, ce qui provoquait en réalité un désinvestissement des patientes dans l’échange.
Progressivement sur le terrain s’est imposé ce constat : si le genre structure bien sûr la relation gynécologique de part en part, la classe et la race également.
Aurore Koechlin
Cette approche mène à une observation intéressante : les femmes de classes supérieures blanches ont d’importantes ressources et sont très impliquées dans les rencontres gynécologiques, mais cela les amène justement à se conformer – parfois même à l’excès – à la norme gynécologique. Symétriquement, les femmes racisées et d’origine moins favorisée peuvent être moins impliquées mais également opposer un refus plus net à cette norme.
Oui. J’ai voulu montrer que dans un sens comme dans l’autre, ce qui apparaît d’abord comme une ressource peut se retourner contre la patiente, et qu’inversement, ce qui est d’abord considéré comme un handicap peut être mobilisé avec succès par elle. Une moindre implication dans la consultation laisse ainsi paradoxalement moins de prises à l’argumentation – un refus net, celui de la pilule par exemple, peut moins facilement être contesté. Inversement, la patientèle blanche de classes supérieures, qui dispose de beaucoup de capitaux et investit, voire surinvestit la consultation gynécologique, notamment par la parole, ou par un rapport très scolaire au savoir et aux prescriptions médicales, peut finalement se trouver piégée par ses propres avantages. En effet, cela crée une très forte compliance, une parfaite intériorisation de la norme gynécologique, qui peut pousser les patientes à devancer les prescriptions médicales, voire à s’y conformer de façon excessive, de l’aveu même des médecins.
Vous étudiez également plus en détail les violences gynécologiques. Malgré le caractère plutôt exceptionnel qu’elles représentent dans votre étude de terrain, vous souhaitez en étudier les « conditions de possibilité ». Quelles sont-elles ?
Un des éléments centraux de la définition des violences gynécologiques est le non-respect du consentement de la patiente aux actes réalisés, en particulier à l’examen gynécologique. L’expression est un terme rencontré sur le terrain, mais aussi médiatique, politique, et féministe. Il est l’objet de fréquents débats quant à sa définition. Pour toutes ces raisons, il est d’un usage compliqué pour la sociologie. Néanmoins, j’ai pu assister lors de certaines consultations gynécologiques à des moments de tension qui étaient anormaux au regard de l’ensemble des consultations observées. Dans ces moments, la détresse exprimée par les patientes était liée à ce qu’il se passait alors dans la consultation et était tout à fait en excès par rapport au cours habituel des consultations – accompagnée par exemple de cris, de pleurs, etc.
J’ai pu assister lors de certaines consultations gynécologiques à des moments de tension qui étaient anormaux au regard de l’ensemble des consultations observées.
Aurore Koechlin
Ces situations, pour minoritaires qu’elles ont été, ont existé, et il me semblait difficile de ne pas les évoquer. Dès lors, mon traitement des violences gynécologiques participe de cette volonté que j’évoquais plus haut de décaler le regard par rapport aux débats médiatiques. J’ai ainsi essayé d’interroger ce qui rendait possibles ces violences, c’est-à-dire de réfléchir aux conditions structurelles qui expliquent qu’elles peuvent se produire.
J’ai retenu, dans mon livre, trois conditions structurelles des violences gynécologiques, même s’il en existe sûrement d’autres.
Tout d’abord, la consultation gynécologique constitue une socialisation à la douleur : certains actes peuvent être douloureux, certains le sont presque systématiquement en observations comme en entretien. Les professionnelles et les professionnels doivent donc composer avec la douleur pour pouvoir travailler : c’est le cas pour beaucoup d’actes médicaux, mais la particularité de la consultation gynécologique est sa régularité. Dès lors, pour les médecins comme pour les patientes, la douleur est normalisée, et, de ce fait, ne constitue plus le symptôme potentiel d’une situation anormale.
Ensuite, j’ai constaté que les conditions de travail jouaient tout particulièrement sur les violences. Quand le rythme des consultations est accéléré, dans un contexte précarisé, les professionnelles et les professionnels de santé tendent à s’appuyer davantage sur leurs automatismes, ce qui rend plus difficile le fait d’analyser la particularité de la situation. En outre, l’absence de formation à demander systématiquement le consentement avant tout acte provoque également une réaction différenciée aux manifestations non verbales de l’absence de consentement. Celles et ceux qui sont plus sensibles, qui ont une plus grande expérience, sauront décrypter ces réactions des corps ; les autres non. C’est pourquoi il faut harmoniser la formation autour de ces enjeux.
Enfin, le dernier facteur est l’universalisme médical, cet idéal de neutralité et de non jugement qui est au fondement de la définition moderne du médecin. Même s’il part d’une bonne intention, pour la gynécologie, cela a comme effet paradoxal de vouloir traiter les organes génitaux comme n’importe quels organes, alors que de fait ils sont construits socialement comme relevant d’une exceptionnalité. Les corps sont désexualisés, dégenrés, ils deviennent un objet à traiter. Mais cela va à contre-courant du ressenti d’au moins une partie des patientes, qui disent en entretien vivre la consultation comme un moment dont la dimension genrée et potentiellement sexualisée ne peut jamais totalement être effacée. Cet effacement paradoxal peut là encore conduire à des violences.
Les corps sont désexualisés, dégenrés, ils deviennent un objet à traiter. Mais cela va à contre-courant du ressenti d’au moins une partie des patientes, qui disent en entretien vivre la consultation comme un moment dont la dimension genrée et potentiellement sexualisée ne peut jamais totalement être effacée.
Aurore Koechlin
Vous étudiez finalement les résistances à la norme gynécologique et vous parlez de la consultation comme d’un « jeu d’ajustement mutuel ». Les médecins peuvent reprendre les arguments des patientes, notamment sur le caractère « naturel » de certains traitements, tandis que les patientes s’approprient la norme préventive pour affirmer leur propre position : c’est au nom d’un calcul bénéfice-risque qu’elles refusent les traitements hormonaux. Pouvez-vous revenir sur cette relation ?
Dans mon livre, j’ai voulu montrer que la consultation gynécologique constituait un haut lieu d’argumentation, qui socialisait autant les patientes aux raisonnements médicaux, que les médecins aux arguments des patientes. Si bien que les arguments peuvent de part et d’autre s’anticiper, et par là s’échanger.
Ce que j’ai appelé « l’argument du naturel » est un bon exemple de cet échange. J’ai constaté que c’est bien plutôt les médecins qui y avaient frontalement recours, pour conseiller une contraception sans hormones par exemple. Le naturel est alors pensé comme un argument pour convaincre la patiente de suivre la norme contraceptive ou gynécologique. Paradoxalement, les patientes utilisent bien moins l’argument du naturel directement, mais mettent plutôt en avant le refus des hormones. Mais ce faisant, elles mobilisent le plus souvent des arguments médicaux – que la balance risque/bénéfice n’est pas positive, ou que le principe de précaution s’impose au regard des controverses récentes autour des hormones.
Il est donc intéressant de constater que du côté des profanes comme des professionnelles et des professionnels de santé, l’argument du naturel ne renvoie jamais à une vraie nature idéalisée et opposée à la technique humaine, mais sert toujours à exprimer autre chose. La réappropriation par les professionnels et les professionnelles de l’argument du naturel n’est par ailleurs pas univoque : à cette logique répond la réappropriation par les patientes des normes médicales. Ce chassé-croisé des arguments est assez remarquable.

