Réjane Sénac est directrice de recherche CNRS au Centre de recherches politiques de Sciences Po (CEVIPOF) et membre du comité de pilotage du programme de recherche et d’enseignement des savoirs sur le genre (PRESAGE) de Sciences Po. Elle est aussi présidente de la commission Parité du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes (HCEFH). Elle analyse les nœuds entre politique d’égalité et politique de l’identité en engageant, notamment, une lecture critique des mécanismes institutionnels et des principes législatifs à l’échelle de la France et de l’Europe.
Son étude, à la croisée de la philosophie politique, de l’analyse cognitive des politiques publiques et de la sociologie du droit a donné naissance à de nombreux articles et ouvrages dont le dernier s’intitule Les non-frères au pays de l’égalité (2017).
Dans un très récent numéro de la revue de théorie et philosophie politiques Cités, vous affirmez que « questionner les liens entre féminismes et critique », c’est « interroger les frontières du politique » 1. C’est-à-dire proposer « une approche transcendantale du “qui“ et de “ce qui“ est politique en adressant la question du “comment“. » Pouvez-vous expliciter cela ?
Interroger ce qu’est être féministe, c’est se poser la question du lien entre critique et politique au sens où le/la politique dit et fait advenir les ordres légitimes dans leurs interactions et leurs tensions : ordre naturel, ordre social, ordre politique, ordre légal, ordre religieux, etc. Prenons la manière dont est né le terme « féministe » en France. Il est associé au néologisme, reprenant un terme désignant l’intersexuation et associée à une pathologique, utilisé en 1872 par Dumas fils pour discréditer l’écrivain et diplomate Henri d’Ideville dans sa défense des femmes comme les égales des hommes devant avoir la même éducation et les mêmes droits 2. Cette dénonciation des différences de traitement entre les sexes comme illégitimes, et donc comme des inégalités à combattre, est discréditée au nom du respect d’une prétendue complémentarité naturelle ayant donnée la force à l’homme. L’historienne Christine Bard le montre très bien 3 : ce renvoi des féministes à l’absurde, au ridicule, au non-sens, renvoie l’égalité femmes-hommes à une contre-vérité et rend l’échange, le débat impossible.
Qualifier Henri d’Ideville de « féministe », c’est le désigner comme traître à son corps, aux hommes. Dumas fils s’oppose ainsi à la mise à distance critique d’un ordre établi justifié au nom d’un récit essentialiste. Dans cette généalogie, être féministe, c’est dénoncer l’illégitimité du traitement systémique inégalitaire entre les sexes au nom d’un ordre prétendument naturel. L’inégalité de genre est la mise en récit d’un ordre éminemment social et politique.

Le féminisme est éminemment politique au sens où le politique est l’intervalle de discussion et d’action entre ce qui est et ce qui devrait être, ce que l’on juge légitime. Ce qu’il y a d’intéressant dans la question « qu’est-ce que le féminisme ? » c’est qu’elle pose celle de « qui et de ce qui est politique ? », car les inégalités de genre reposent sur la sortie des femmes du politique, au motif qu’elles sont renvoyées à une impuissance, une incapacité d’être dans la mise à distance par la raison. Il en va de même pour les personnes racisées [/note]Le concept de personne « racisée » a été notamment défini par la Table de concertation des organismes au service des personnes réfugiées et immigrantes (TCRI), en collaboration avec le Comité de réflexion sur la situation des femmes immigrées et racisées. Il désigne des femmes et des hommes issus de l’immigration, tous statuts confondus, nés en France ou non et appartenant à des « minorités visibles ». Ces personnes font l’expérience quotidienne d’une construction sociale apparentée à la définition de la race.[/note]. Ceux qui sont en position d’être classificateurs, c’est-à-dire les hommes blancs, ont le pouvoir de déterminer à la fois les règles et le cadre du jeu politique. Cela pose la question des frontières du politique, à la fois du « qui » et de « ce qui » est légitime.
D’autre part, cela adresse également la question du « pour quoi » et du « quoi », c’est-à-dire de la destination et de la finalité du politique. Cela a des implications en terme de « comment » : en 1790, Condorcet dans son essai Sur l’admission des femmes au droit de cité défend ainsi le droit de vote et d’éligibilité des femmes en affirmant que « celui qui vote contre le droit d’un autre, quels que soient sa religion, sa couleur ou son sexe, a dès lors abjuré les siens. » Cette affirmation est essentielle car elle pose la question du « qui est politique » au sens de « qui est à la hauteur de ce qu’est être humain ». Il se réapproprie le pouvoir fondamental de décider de « qui est politique ».
L’inégalité de genre est la mise en récit d’un ordre éminemment social et politique.
Réjane Sénac
Pourquoi parler de « non-frères » ? Cette expression permet d’expliciter que c’est sur le registre de la négation, du manque que certain•e•s groupes d’individu•e•s ont été défini•e•s comme incapables d’être autonomes, et donc d’être des acteurs politiques légitimes. Elle dit leur assignation à un rapport asymptotique à une norme, celle des frères, qui ne pourra jamais être atteinte.
Le « jeu » que fait émerger ce questionnement de la frontière du politique semble charrier avec lui toute une polysémie. Au-delà de la métaphore spatiale, peut-on le comprendre comme un « jeu » théâtral : c’est-à-dire un espace propice à la mise en scène dans notre imaginaire collectif ?
Notre héritage républicain repose sur un récit ambivalent dans lequel, dans le même mouvement, l’égalité est proclamée comme un principe politique sacré et des groupes d’individus – les femmes et les personnes racisées –sont exclus de son application car dépolitisés. Le mythe de l’égalité « à la française » est entre totem et tabou, du moment révolutionnaire à aujourd’hui, il continue à perdurer et à faire écran à une réflexion sur les conditions d’impossibilité de l’égalité.
La devise française est très symbolique de cela. Le troisième terme, la « fraternité » renvoie au « qui », à la communauté politique à qui s’applique les principes, entre libéralisme politique et républicanisme, de liberté et d’égalité. L’angle mort des « non-frères » est extrêmement révélateur. C’est ce que j’appelle le « mythe de l’égalité » à la manière de Roland Barthes 4.
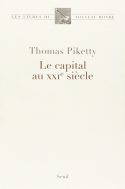
Prenons l’exemple de Thomas Piketty que je cite dans Les non-frères au pays de l’égalité comme incarnant la modernité de ce mythe. Dans Le Capital au XXIe siècle, cet économiste, conseiller des candidats PS Ségolène Royal en 2007 et Benoît Hamon en 2017, explique pourquoi la France est un pays exemplaire pour celles et ceux qui s’intéressent à l’évolution des inégalités, en faisant usage de trois arguments. Ses deux premiers arguments sont d’ordre technique. Tout d’abord, il souligne que l’importance des données disponibles en France pour mesurer la dynamique des répartitions de richesses est liée à la mise en place d’un « système d’enregistrement des patrimoines terriens, immobiliers, financiers depuis les années 1790-1800. » 5 Le deuxième argument est que du fait de sa transition démographique précoce, la France constitue « un bon observatoire de ce qui attend l’ensemble de la planète » 6. Le troisième argument pose la France en exemple politique. Je le cite : « Le cas de la France a ceci d’intéressant que la Révolution française introduit très tôt un idéal juridique face au marché dont il est intéressant d’étudier les conséquences pour la dynamique de la répartition des richesses. » 7
Il fait un premier coup de pied aux Anglais, un classique, en soulignant les limites d’une « révolution anglaise qui n’a pas remis en cause la dynastie royale [puis, un coup de pied aux américains] et d’une révolution américaine qui n’a pas permis d’enrayer l’esclavage ni, par la suite, la discrimination raciale légale ». Avant de qualifier la Révolution française de « plus ambitieuse » dans la mesure où « elle abolit tous les privilèges légaux et entend créer un ordre politique et social entièrement fondé sur l’égalité de droit et des chances. » 8 Mais là où ça devient vraiment intéressant, c’est lorsqu’il affirme que « le code civil garantit l’égalité absolue face au droit de propriété et à celui de contracter librement (tout au moins pour les hommes) ». Le mythe de l’égalité surgit dans la parenthèse qui est une « vaccine » au sens de Barthes. En effet, de dire l’exclusive immunise l’imaginaire collectif d’une remise en cause du principe d’égalité : « par une petite inoculation de mal reconnu ; on le défend ainsi contre le risque d’une subversion généralisée. » 9 C’est-à-dire que cette parenthèse autorise à continuer de qualifier l’égalité d’« absolue », alors même que l’exclusion historique de la moitié non masculine de la population de l’application de ce principe est connue et publicisée.
Et le fait de placer ces réflexions au sein d’une parenthèse ou dans une note de bas de page semble montrer, encore une fois, que le féminin est à la marge…
Oui, le Capital au XXIe siècle comporte d’autres passages où Thomas Piketty précise entre parenthèses, entre virgules ou en note de bas de page l’exclusion des femmes du principe égalitaire 10. Il précise que les lois sur les successions affirmant l’autorité du chef de famille au détriment de l’épouse perdant la maîtrise de ses biens en se mariant « suscitent un optimisme considérable, tout du moins parmi les hommes » (p. 576).
Déchiffrer l’égalité à la française comme mythologie exige un double niveau de lecture. Le premier niveau de lecture consiste à constater que Thomas Piketty contribue à démystifier l’égalité à la française dans la mesure où il précise que les femmes ont été historiquement exclues de l’application de ce principe. Cette précision est lacunaire et non rigoureuse, sur le sens et la portée du principe de l’égalité puisqu’il n’y a pas que les femmes qui étaient cantonnées à une citoyenneté passive limitant leurs droits civils et civiques : sont aussi concernés dans cette catégorie de « non-frères » l’indigène colonisé, par exemple, qui bénéficiait d’un régime de sous-citoyenneté voire de non-citoyenneté. Le deuxième niveau de lecture est qu’en postulant une double exemplarité française – à la fois en termes d’analyse de l’évolution des inégalités et de mise en œuvre d’un ordre politique et juridique égalitaire –, Thomas Piketty participe de la perpétuation contemporaine du mythe de l’égalité à la française. Ainsi, ce propos est un métalangage qui est là pour signifier autre chose : malgré les preuves, la France continue à se mettre en scène comme exemplaire au regard du principe d’égalité.
Cela s’inscrit dans un récit où la France demeure la patrie de magnifiques principes portés depuis les Lumières et qui ont pour seul tort d’être mal appliqués. C’est la fameuse dichotomie entre égalité de jure et inégalité de facto qui est ici rejouée. Et même si l’on ne peut plus faire semblant de ne pas savoir que ces mêmes Lumières ont laissé dans l’ombre plus que la moitié de la population, cela est une parenthèse qui ne froisse pas le mythe.
Malgré les preuves, la France continue à se mettre en scène comme exemplaire au regard du principe d’égalité.
Réjane Sénac

Le terme de fraternité incarne les dilemmes au cœur des principes républicains. Mon livre Les non-frères au pays de l’égalité est un polar politique sur le meurtre en série de l’égalité pour les « non-frères » dans la République française. Le meurtre inaugural, lors du moment révolutionnaire, naturalise l’exclusion des « non-frères » au nom de leur incapacité prétendument « naturelle » à être des sujets autonomes.
Rousseau théorise l’exclusion des femmes du politique, en affirmant dans L’Émile ou De l’éducation, publié de manière significative en 1762 la même année que Le Contrat social, qu’elle n’est pas l’ouvrage du préjugé mais de la raison 11. La femme étant « femelle toute sa vie, ou du moins toute sa jeunesse », 12 elle doit selon lui être élevée – ou plutôt rabaissée – comme un être dépendant de ses instincts, ses missions naturelles ainsi que de l’autorité tout aussi naturelle et légitime des hommes…
Sylvain Maréchal, considéré comme l’un des précurseurs du mouvement libertaire et de l’anarchisme, offre lui aussi de beaux morceaux pour l’analyse. Il publie Le Manifeste des égaux en 1796 – celui-là même qui demande l’« abolition des révoltantes distinctions » – et cinq ans après, en 1801, dépose un projet de loi pour interdire l’apprentissage de la lecture aux filles avec, pour justification, le fait que sa démarche est faite au nom de l’égalité même, de son application stricto sensu, et non en vertu d’une exception à ce principe. Si Piketty qualifie l’égalité d’« absolue », Sylvain Maréchal, lui, précise que « les deux sexes sont parfaitement égaux ; c’est-à-dire, aussi parfaits l’un que l’autre, dans ce qui les constitue ». Pour atteindre cette « parfaite égalité » et le « bonheur commun », il faut logiquement que les femmes soient exclues de l’apprentissage de la lecture. Rousseau ne dit rien de différent quand il affirme qu’éduquer les filles comme les garçons revient à leur faire perdre « la moitié de leur prix », puisque cela revient à ce qu’« elles restent au-dessous de leur portée sans se mettre à la nôtre » 13. Il présume que les lecteurs sont des « hommes », bien entendu.

On revient donc à cette idée du danger portée par l’« inter-sexe », ce « troisième genre » perverti et perturbant relevé chez Alexandre Dumas fils.
Oui, ces femmes seraient, pour Rousseau, une subversion de la nature et un danger pour l’ordre social et politique. Pour moi, on ne peut pas comprendre ce qui se passe aujourd’hui et pourquoi des intellectuels de gauche comme Thomas Piketty ne voient aucun problème à décrire une « égalité absolue » suivie d’une parenthèse disant l’exclusion, que comme une réimpression de ce qui constitue notre logiciel républicain. De même, il me semble absurde que personne ne relève le problème de la devise française en passant le terme « fraternité » sous la bannière présumée d’un universalisme républicain. Si on remplaçait « fraternité » par « sororité », tout le monde verrait le problème.
Le terme de fraternité incarne les dilemmes au cœur des principes républicains.
Réjane Sénac
Après cet épisode d’essentialisation intrinsèquement lié à la Révolution, ce mouvement est aujourd’hui de facture néo-essentialiste et néo-libéral. C’est-à-dire que l’on va justifier l’inclusion toujours selon le logiciel de la complémentarité en disant qu’il y a une différence ou une « altérité », selon les mots du Président Emmanuel Macron lui-même 14. Dans ce sens, on n’inclut pas les « non-frères » parce qu’on les reconnaît comme des « mêmes » au sein de l’Humanité – au sens où ils s’imaginent comme des semblables et non pas des clones. On reste dans l’idée que les « non-frères » restent des singuliers, mais que cette singularité, autrefois dévaluée et pensée comme incompatible avec le registre politique, est transformée en plus-value, sauvegardant la logique d’altérité et de complémentarité.
À partir de cet « héritage français antiféministe », doit-on en conclure que la France a plus de mal que ses voisins à voir des femmes arriver au pouvoir ?
La complexité supplémentaire est de dépasser l’écran d’un héritage prétendument exemplaire vis-à-vis de l’égalité. De fait, le questionnement sur le logiciel politique et ses dilemmes est très complexe. D’une complexité plus implicite que les régimes politiques plus jeunes et plus légitimement critiques vis-à-vis de leur héritage comme l’Espagne, par exemple. Une lecture critique de l’histoire est consubstantielle aux pays en transition démocratique en particulier, alors qu’en France elle est perçue comme mettant en danger l’unité et l’identité nationale.
En France, notre difficulté réside dans le fait de percevoir notre histoire et nos principes comme des totems. Notre « hétérosexisme racialisé constituant » 15 est notre « ça » républicain que nous n’assumons pas, mais qui nous agit. Le « surmoi » étant à la fois le politiquement correct de l’égalité et un récit idéalisé de notre héritage malgré les preuves, à la manière de l’égalité absolue avec parenthèse de Piketty. Autant de circonvolutions pour ne rien reconnaître. À mon sens, tant que nous n’aurons pas fait un travail qui consiste à dire que, oui, notre héritage est hétérosexiste, hétéronormatif et racialisé, nous ne pourrons pas lutter contre les inégalités et les discriminations que l’on diagnostique aujourd’hui en agissant sur leurs racines. Entre l’idéalisation du « surmoi » égalitaire et le déni d’un « ça » inégalitaire, le « moi » républicain est schizophrène. Il ne pourra ni se guérir ni être cohérent tant qu’il n’assumera pas son héritage ambivalent dans une perspective critique. Cela demande de faire une psychanalyse politique, par définition dérangeante et inconfortable.
En France, notre difficulté réside dans le fait de percevoir notre histoire et nos principes comme des totems.
Réjane Sénac
Notre incapacité critique et notre boursouflure à donner des leçons au monde entier, en particulier sur l’égalité femmes-hommes, est très significative en terme géopolitique. Et c’est tout à fait contradictoire, à mon sens, avec le dépassement de nos dilemmes puisqu’on s’empêche, justement, de se mettre en position de penser et de porter réellement l’égalité. Il est significatif que notre devise nationale soit censée dire le lien, la communauté politique par un terme exclusif tel que fraternité. Proposer de changer ce terme par celui d’adelphité, provenant d’un mot grec désignant les enfants nés de la même mère quelque soit leur sexe, ou solidarité, si l’on veut sortir de l’analogie familiale, est encore perçu comme iconoclaste. Je fais cette proposition à la fois dans mon livre Les non-frères au pays de l’égalité et dans l’avis pour une réforme constitutionnelle garante de l’égalité femmes-hommes du Haut Conseil à l’égalité entre les hommes et les femmes dont je suis rapporteure.
Cela donne le « la » du niveau de cécité dans lequel nous sommes encore sur la perpétuation d’un « qui » politique se caractérisant par des scories et dilemmes. La question du « qui » et « ce qui » est politique est, à mon sens, complètement occultée par la focalisation sur le « comment ». Les controverses autour de l’adoption de la loi ouvrant le mariage civil aux couples de personne de même sexe soulignent l’intrication entre le « comment », le « qui » et le « quoi » en incarnant des conceptions incompatibles de l’application du principe républicain d’égalité.
Au fond, ce problème de l’application du principe républicain d’égalité reviendrait à un problème de lecture et surtout de « cécité », comme vous le désignez. Existerait-il une forme de continuum depuis la droite identitaire jusqu’à la gauche « républicaine », les uns comme les autres refusant, selon des arguments différents, l’intérêt de ces objets et du débat qu’ils charrient ?
En effet, le tabou dont nous avons parlé construit ce continuum. Ces différentes teintes de l’échiquier politique ne le penseront pas de la même manière ; pourtant, l’héritage républicain français reste, dans un cas comme dans l’autre, complètement idéalisé, posé comme exemplaire à la fois pour l’identité nationale et pour l’image et le rayonnement français à l’international. L’exemplarité est conçue en interne (idem) et en externe (ibid) comme le propre de la patrie des droits de l’homme. Paradoxalement, dans ce récit national, l’égalité femmes-hommes est définie comme une valeur de la République faisant frontière entre ceux qui sont conformes et ceux qui ne pourront jamais l’être. C’est un paradoxe historique entre naïveté et cynisme absolu que de faire de l’égalité femmes-hommes un fondement de la République française.
La gauche républicaine française est ainsi une gauche identitaire, en terme de racisme comme de sexisme, qui s’ignore ?
Oui, mais elle ne s’ignore pas vraiment. Quand vous lisez L’insécurité culturelle de Laurent Bouvet et tout ce qui entoure le « Printemps Républicain », il y a une mise en scène d’un récit national posant l’homogénéité comme une condition de l’égalité. Après avoir dénoncé les lois dites sur la parité comme une remise en cause de la méritocratie républicaine, plus particulièrement des hommes blancs quarantenaires, ils font la lutte contre le racisme et de l’intégration une diversion par rapport aux seules inégalités qu’ils jugent dignes d’être nommées inégalité politique, c’est-à-dire les inégalités d’ordre économique. En parallèle, ces mêmes acteurs se prévaudront d’une défense d’un principe d’égalité femmes-hommes prétendument républicain pour dénoncer la dangerosité d’une immigration mettant en danger l’authenticité nationale, en particulier du fait de l’association de certaines immigrations à la religion musulmane. Ce nationalisme sexuel permet de moderniser une logique post-coloniale de donneur de leçons au nom d’une prétendue supériorité civilisationnelle 16. Nombreuses sont les dates et chiffres qui invalident cette narration. Rappelons que les Françaises ont eu le droit de vote en 1944, par la petite porte, sous l’ordonnance d’un général et suite à la pression en particulier du communiste Fernand Grenier. Elles ont dû attendre les années 1980 pour avoir l’égalité de gestion des biens familiaux.

Nous sommes dans une mise en scène de l’exemplarité à la française non critique. C’est un récit qui se réapproprie la rhétorique identitaire et dit les frontières binaires entre le « nous » et le « eux », les « conformes » et les « non-conformes », les « authentiques » et « ceux qui ne le sont pas ». Il charrie avec lui une conception des fameuses « valeurs » de la République.
Comme l’analyse Jean-Marc Ferry, c’est la différence entre valeur, norme et principe qui est ici passée à la trappe. 17 Aborder l’égalité femmes-hommes en terme de valeur c’est une manière de la dépolitiser en la mettant au même niveau que d’autres valeurs concurrentes. Ceci alors que l’égalité est un principe fondamental sans condition. De la droite identitaire à la gauche républicaine, une confusion est portée entre la communauté nationale et la communauté dite majoritaire. Les travaux de Cécile Laborde portent un républicanisme critique en éclairant cette tentation de ne pas voir que l’universalisme républicain dit neutre est pétri d’héritage « catho-laïque ». Il s’agit d’interroger la cohérence de nos idéaux, en particulier, comme nous y invite Michaël Foessel, en faisant le procès des Lumières. Si on n’en fait pas le procès, le mythe de l’égalité « à la française » se modernise et justifie des hiérarchisations, des exclusions, en mettant en scène des incompatibilités aux principes universels qu’il est censé porter.
Vous parlez de « catho-laïcité ». La communauté catholique, en effet, se droitise et sa confusion entre « valeur » et « principe » est sensible. Mais les partisans de la laïcité pure et dure sèment un trouble identique. Quand on regarde d’autres pays européens non laïcs, ces questions là se posent aussi, mais de manière assez différente. Le Royaume-Uni, par exemple, n’échappe pas aux problèmes structurels liés au sexisme ; pourtant, le fait d’avoir connu, dans son histoire, plusieurs reines et deux Premières ministres semble changer la donne, d’une façon ou d’une autre. La France refuse-t-elle de voir des femmes aux premiers postes du pouvoir ?
Parler de « catho-laïcité », c’est mettre à jour un angle mort de notre héritage où ce qui est censé être la neutralité républicaine, en particulier religieuse, ne l’a jamais été. L’organisation de la vie publique est adaptée à la pratique de la religion catholique comme le soulignent nos jours fériés, ou le poisson à l’école le vendredi. Par contre, lorsque les religions non associées à la communauté majoritaire au sens historique demandent des aménagements pour pouvoir exercer leur religion, cela est dénoncé comme incompatible avec les valeurs de la République, en particulier avec la laïcité. C’est faire preuve de cécité et d’incapacité à traiter à égalité tou•te•s les citoyen•ne•s en particulier dans le rapport à la religion.

Pour répondre à votre question sur les femmes et le pouvoir, il est notable que ces « non-frères » inaugurales que sont les femmes ont été exclues du pouvoir au nom de leur prétendue incompatibilité naturelle avec l’exercice de la raison. La tentation est aujourd’hui de les inclure pour les mêmes raisons qu’elles ont été exclues, leur assignation à la différence, mise en scène comme une plus-value et non plus comme une moins-value. Mon analyse des principes de justification des politiques d’inclusion souligne que femmes et personnes racisées demeurent des complémentaires et non des paires. Le registre est celui d’une égalité sous condition de performance de la différence pour les non-frères. « Performance » au sens à la fois de rentabilité – il faut que cela apporte, que ce soit rentable au sens économique mais aussi en terme de cohésion sociale, nationale, etc. – et de théâtralisation, de mise en scène identitaire – il faut être là « en tant que femme, personnes dites de la diversité », dans le rôle qui est attendu.
Il peut apparaître illogique que, dans un pays qui se revendique comme le pays de l’égalité, en particulier de l’égalité femmes-hommes (dont le respect est posé comme une condition de la naturalisation et de l’intégration), nous n’ayons jamais eu de présidente de la République, de présidente de chambre parlementaire, une seule première ministre au passage fulgurant et à la figure discréditée 18, ou encore une seule femme à la tête d’une des entreprises du CAC40 qui est placée en binôme avec un homme. Cette apparente contradiction devient logique si on déchiffre la recomposition d’un modèle fondé sur la complémentarité « papa-maman » dans la vie privée comme dans la vie publique.

La comparaison des injonctions genrées en France et dans les autres pays souligne que les injonctions faites aux femmes sont, en France, particulièrement lourdes et complexes. La norme est d’avoir des enfants – ce qui n’est pas le cas dans tous les pays – de les élever et d’avoir une activité professionnelle – puisqu’il est désormais mal vu de rester mère au foyer – tout restant dans le rôle de « deuxième sexe » dans la vie privée comme publique. Pourquoi ? Parce qu’elles sont encore associées à des qualités « maternantes » d’écoute, de participation, de pacification, d’empathie et de soin aux plus faibles (le care). Alors que les qualités d’un « numéro un » sont celles de l’autorité, le fait de trancher légitimement, la force, etc. Les femmes sont conformes à ce qui est attendu d’elles si elles sont dans des positions au mieux de « numéro deux » voire de « numéro trois », « numéro quatre », etc. Par contre, être femme et « numéro un », c’est être écartelée par des injonctions contradictoires. Le gouvernement actuel est paritaire d’un point de vue quantitatif – comme l’avait déjà été celui de 2012 – mais pas qualitativement puisque les portefeuilles ministériels des femmes et des hommes sont de l’ordre de la division horizontale et verticale entre les rôles stéréotypés des mamans et des papas. Comme dans la ségrégation du marché du travail, cette répartition sexuée est l’expression et le vecteur d’une hiérarchisation.
Être femme et « numéro un », c’est être écartelé par des injonctions contradictoires.
Réjane Sénac
Dire que parmi les deux délégations les plus prestigieuses au niveau municipal –finances, urbanisme et travaux – les hommes sont surreprésentés avec 80 % des adjoints aux finances qui sont des hommes, alors que les femmes sont en charge de l’enfance/petite enfance/famille, du social et des affaires scolaires à plus de 85 %, ce n’est pas dévaloriser le social, mais faire le diagnostic d’une hiérarchie sociale et politique encore présente.
On s’en souvient, Ségolène Royal avait été placée au ministère de l’Ecologie sous François Hollande et elle est désormais nommée ambassadrice pour l’Arctique et l’Antarctique. Or, ce domaine est encore communément pensé comme un sujet ou une occupation « de bonne femme ».
L’inclusion des « non-frères », les femmes en particulier, dans des positions dont elles ont été historiquement et théoriquement exclues peut en effet être légitimée comme une plus-value. Cela peut renvoyer à un registre différentialiste selon lequel les femmes feraient de la politique autrement, du management autrement, du journalisme autrement… Concernant l’écologie en particulier, le discours est alors qu’elles sont plus soucieuses du collectif et de l’avenir. C’est ainsi par exemple que dans son rapport annuel « Gender Equality and Development » de 2012 le FMI justifie l’attention particulière sur les femmes, en particulier par les micro-crédits en affirmant qu’un dollar investi sur une femme, c’est un dollar investi sur la communauté 19 – lorsqu’un dollar sur un homme l’est avant tout sur cet homme. Cette justification de l’inclusion des femmes au nom de la plus-value de la mixité se fait aussi dans le cadre du référentiel européen de l’investissement social, particulièrement porté par les pays socio-démocrates, les pays nordiques. Cette approche insiste sur la nécessité de situer l’intervention sociale le plus en amont possible afin de minimiser les risques sociaux. Par exemple, investir dans le social, et en particulier dans la garde des enfants, c’est augmenter la réussite scolaire et réduire ainsi les risques de chômage et de délinquance.
Ces principes de justification publique des politiques d’égalité posent la question suivante : est-ce que la fin justifie les moyens ou les moyens conditionnent la fin ? C’est un questionnement entre déontologie et conséquentialisme. Trop souvent, on justifie l’égalité au nom, non pas de l’application du principe d’égalité, de la lutte contre les discriminations, mais au nom de la performance de la mixité ou de la différence. Même culturalisée, cette justification par la performance de la différence fait perdurer le logiciel de la complémentarité. Si vous justifiez l’inclusion des femmes parce qu’elles apportent autre chose, impossible, dès lors, de les placer en position de « numéro un ». C’est du néo-essentialisme. Et cette justification par la plus-value ne marche que si on performe la complémentarité entre frères et non-frères. Si les femmes sont élevées comme les hommes et les personnes racisées sont dans les mêmes contextes avec les mêmes capitaux que les « blanc.he.s », personne ou plutôt tout le monde apportera « autre chose ». Cette justification est donc fondée sur la reproduction des stéréotypes et des discriminations.
C’est différent si on parle en terme de capital humain individuel, c’est-à-dire que le fait que chacune et chacun, si on s’épanouit réellement, sans entrave structurelle, apporte du singulier, oui, c’est vrai. Mais cela n’est pas lié au fait que l’on soit des hommes ou des femmes, de telle couleur ou de telle origine. C’est lié au fait que chaque individu est unique, différent.
On justifie l’égalité au nom, non pas de l’application du principe d’égalité, de la lutte contre les discriminations, mais au nom de la performance de la mixité ou de la différence (…) Si vous justifiez l’inclusion des femmes parce qu’elles apportent autre chose, impossible, dès lors, de les placer en position de « numéro un ».
Réjane Sénac

Ce registre néo-essentialiste est couplé avec un registre néolibéral dans la mesure où il est associé à la démonstration d’une performance. Deux scénarios existent en réalité. Soit il est démontré que l’inclusion des « non-frères » est rentable, mais c’est au prix de la reproduction du mythe de la complémentarité et de discriminations structurelles. Soit, et c’est un angle mort, voire un tabou, il peut être démontré que discriminer c’est rentable, et que l’égalité, au contraire, est coûteuse. Il y a donc un risque de dépolitisation du principe d’égalité, qui devient alors une option rationnelle … ou pas. On tue l’égalité en son nom en la marchandisant. En effet, l’égalité, censée être le principe premier dans l’ordre lexical républicain ne l’est plus puisqu’elle est conditionnée à la démonstration de sa performance. L’égalité étant elle aussi dans le marché, elle est gouvernée par les chiffres.
De fait, est-ce pertinent de dire que pour que les Françaises puissent devenir « numéro un », elles doivent partir ? Pensons, par exemple, à Christine Lagarde.
C’est un exemple particulièrement ambivalent. Christine Lagarde a en effet utilisé l’argument de la performance de la mixité pour justifier les politiques d’égalité. Elle a en particulier asséné la formule suivante : « Si Lehman Brothers avaient été Lehman Sisters, il n’y aurait pas eu de crise. » C’est un discours d’après-crise sur la complémentarité rentable. Il s’agit d’inverser le credo économique selon lequel c’est l’inégalité qui est rentable. On peut penser à la courbe de Kuznets, à la théorie du ruissellement ou à l’equity-efficiency tradeoff.
Dans un début de XXIe siècle diagnostiqué comme celui de la crise, la redéfinition de l’État providence en particulier à travers celle de la protection sociale, est désignée comme la condition de son « bel avenir » 20, voire de sa survie. Les politiques d’égalité sont ainsi présentées comme un investissement social rapportant plus qu’elles ne coûtent au regard de leur performance, pas seulement économique, mais aussi sociale. La centralité politique du référentiel de l’investissement social s’incarne aussi bien dans la « troisième voie » prônée par le parti travailliste britannique à l’époque de Tony Blair et de Gordon Brown que dans l’approche sociale-démocrate mise en place en Suède.

Dans la préface à la version française de The Spirit Level : Why Equality Is Better for Everyone (Pickett et Wilkinson, 2009), l’ancien ministre délégué au développement auprès du ministère des Affaires Étrangères Pascal Canfin, démontre que l’égalité est meilleure pour toutes et tous et que c’est une contradiction portée à la thèse centrale du libéralisme. Pour Nancy Fraser, il s’agit en fait précisément d’une ruse néo-libérale au sens où cela met l’égalité au service du marché. C’est une réappropriation néo-libérale de l’égalité.
Pour revenir à Christine Lagarde, elle offre un cas d’étude des plus intéressants. Quand elle est ministre de l’Économie, elle reprend une étude par Coates et Herbert (2008) sur le digit ratio, c’est-à-dire la différence de taille entre l’annulaire et l’index, réalisée sur (seulement !) 17 traders de la City à Londres. Celle-ci part du principe que les sujets avec le digit ratio le plus grand, c’est-à-dire les plus forts taux de testostérone, sont aussi ceux qui prennent plus de risque dans les placements. Il en est déduit qu’en période de prospérité les hommes font plus de profit que les femmes, mais qu’en période de crise, ils font plus de pertes. La conclusion tirée de cette étude est qu’il est rationnel qu’il y ait un équilibre entre les femmes et les hommes dans la gouvernance des entreprises puisque leur comportement vis-à-vis du risque est censé être complémentaire. Cette étude et les usages qui en ont été fait, pour justifier en particulier la mise en place de quotas dans les conseils d’administration, incarne le poids encore actuel du néo-essentialisme. Cette étude a beaucoup fait parler d’elle, et fut notamment vivement critiquée, par des économistes comme Julie Nelson ou encore des anthropologues à la fois concernant le manque de rigueur méthodologique (petite taille de l’échantillon, confusion entre corrélation et causalité…) et la cécité vis-à-vis de la dimension sociale du rapport à la prise de risque : l’éducation à la confiance en soi, caractérisant les classes favorisées, étant déterminante.
Il peut être démontré que discriminer c’est rentable, et que l’égalité, au contraire, est coûteuse. On tue l’égalité en son nom en la marchandisant.
Réjane Sénac
Il peut apparaître paradoxal que Christine Lagarde, première femme ministre de l’Économie d’un pays du G8 et première directrice générale du FMI, utilise cette justification néo-essentialiste de la présence des femmes dans les instances de gouvernance économique, politique, etc., au motif qu’elles apporteraient de la modération, des atouts permettant de contrecarrer la crise. Il est de plus révélateur qu’en dehors de sa participation au gouvernement de 2005 à 2011, elle a bâti sa carrière aux Etats-Unis que cela soit en tant qu’avocate d’affaires ou au FMI.
Quand vous parliez d’interroger les frontières du politique, c’est que vous critiquez une certaine cartographie du politique : ceux qui décident « qui » et « pour qui » est le politique et régissent le centre et ses marges en fonction. Dès lors, le concept même de féminisme se conçoit comme lutte cherchant à émanciper les femmes, notamment en légitimant leur place et leur parole dans l’espace public. Pour en venir à des sujets controversés, certaines luttes féministes politiques, pour organiser cette émancipation, font usage de réunions en non-mixité comme « outil militant ». Ce fut, pour prendre un sujet particulièrement médiatisé, le cas du Festival Nyansapo par le collectif Mwasi en 2017, vivement critiqué par des politiques de tous bords qui désignaient alors cette organisation intersectionnelle, dite « afroféministe », comme « une forme renouvelée de racisme » ou un « racisme à l’envers ». De quelle manière ces mouvements redéfinissent-ils la cartographie du politique ?

La question qui est posée ici, celle de la mixité politique, interroge le choix et la pertinence des outils d’émancipation. Comme l’analyse Nancy Fraser dans la trinarité de la théorie de la justice, pour advenir comme égal•e, trois dimensions se conjuguent : le versant économique de la redistribution, le versant culturel de la reconnaissance et le versant politique de ce qu’elle appelle la représentation. Ce dernier versant souligne que l’égalité n’est pas tant que certains individus, du fait de leur assignation à un groupe dominé, ne sont pas en position de déterminer les règles du jeu, de modifier le cadre. Les controverses sur le Festival Nyansapo exprime, selon moi, un paternalisme et un maternalisme mêlés, des responsables politiques, institutionnels ou associatifs en position de multi-dominant•e•s (de leur couleur de peau jusqu’à leurs capitaux divers et variés) faisant la leçon à des personnes discriminées sur la manière dont il est convenable de se libérer. Elles soulignent le fait que notre société n’est pas encore en capacité de considérer « l’Autre », au sens du dominé, comme réellement autonome et majeur. La condescendance postcoloniale prend ici la forme de critiques sur la légitimité du chemin emprunté par des femmes racisées pour s’émanciper. Mais de quel droit se permettre de telles critiques ? Selon moi, la non mixité politique est un outil de réappropriation, une sortie de tutelle.

Il est révélateur que même si elle a pu faire polémique, la non-mixité sexuée, pratiquée en particulier par les féministes dans les années 68, soit aujourd’hui considérée comme bien moins transgressive que celle pratiquée dans le cadre de luttes intersectionnelles. La non-mixité sexuée semble plus facilement comprise comme un outil pour que la présence d’individus ne subissant pas directement les discriminations ne biaise pas la libération de la parole des « premier•e•s concerné•e•s » (autocensure, micro-agressions, etc.). Nombreux travaux discutent de l’importance de prendre en compte le point de vue situé, Standpoint Theory, des personnes qui analysent et déconstruisent les inégalités que cela soit dans le monde académique ou associatif. La non-mixité sexuée n’est ainsi pas conçue comme l’expression d’une guerre des sexes ou de la misandrie, mais comme une phase de libération de la parole et d’auto-détermination des femmes comme minorités sociales. La critique particulièrement forte d’Anne Hidalgo, maire de Paris, est révélatrice du manque de consensus parmi les féministes sur la pertinence de la non-mixité comme outil d’émancipation.
Parmi les associations de lutte contre le racisme, la Ligue Internationale contre le Racisme et l’Antisémitisme (LICRA) dénonce ce festival comme un « combat raciste devenu l’alibi d’un repli identitaire » et SOS Racisme comme « une faute – sinon une abomination – car il se complaît dans la séparation ethnique là où l’antiracisme est un mouvement dont l’objectif est post-racial ». La dénonciation de l’incompatibilité entre la mise en place d’espaces non-mixtes de discussion et les principes républicains d’indivisibilité, de laïcité et d’égalité, ainsi que les valeurs dites communes comme la lutte contre le racisme dit, selon moi, une dépolitisation de qu’est le racisme comme système de domination. Parler de sexisme anti-homme ou de racisme anti-blanc, c’est faire comme si nous vivions dans une société sans discrimination structurelle.
Opposer liberté et égalité est une rhétorique permettant de discréditer sous le sceau de la morale comme censure ce qui est application du principe fondamentalement politique d’égalité. L’égalité est une condition de la liberté.
Réjane Sénac
Concernant la question non plus de comment il est légitime de s’émanciper, mais de qui peut participer à cette émancipation, si l’on ne veut pas s’enfermer dans des concurrences de lutte des premier•e•s concerné•e•s, il est nécessaire de penser et porter la participation à la déconstruction d’un système inégalitaire comme éminemment politique. Participer à la lutte féministe en tant qu’homme et à la lutte contre le racisme en tant que « blanc•he•s », c’est avoir conscience que ne pas expérimenter les inégalités, voire en être bénéficiaire, a pour contrepartie une humilité nécessaire pour ne pas confisquer la parole et reproduire ainsi une domination vis-à-vis des premier•e• concerné•e•s.
Le féminisme n’entretient pas seulement une lecture critique d’un système, de ses principes et de ses valeurs. Dès lors qu’on en analyse les formes de lutte concrètes, on s’aperçoit que comme tout autre mouvement politique, le féminisme entretient lui aussi des formes de contradictions. Il existe des systèmes d’alliances, ponctuels ou non, qui semblent démontrer que les courants féministes peuvent eux aussi faire preuve de cécité sur d’autres problèmes sociétaux. L’antisémitisme, en particulier, n’a rien de nouveau au sein de ces mouvements. Aux Etats-Unis, par exemple, l’activiste Linda Sarsour a fait l’apologie d’islamistes extrémistes et a appelé à la haine contre Israël. Dénonce-t-on une cécité pour en consolider une autre ?
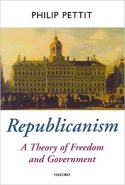
Ce qui est en jeu, selon moi, ce sont les conditions de possibilité ou d’impossibilité de l’égalité entre les actrices et les acteurs de l’émancipation. Nier la légitimité des premier•e•s concerné•e•s de choisir le cadre de leur émancipation, c’est performer le système de domination que l’on revendique déconstruire. L’explicitation des controverses, des divergences est au cœur du pluralisme caractérisant toute réflexion et engagement à portée politique. Dénoncer l’antisémitisme, mais aussi l’islamophobie ou l’homophobie, portés par des actrices ou des acteurs se revendiquant comme féministes et/ou anti-racisme, c’est dénoncer des incohérences.
On ne peut pas être libre tant qu’on est soumis à un plus fort ou légitime que soi.
Réjane Sénac
Considérer comme tolérables des positionnements homophobe, antisémite ou islamophobe au motif qu’ils seraient compréhensibles dans certains contextes culturels, c’est rester dans une logique paternaliste ou maternaliste de dominant•e•s ayant aussi le pouvoir de l’indulgence. Comme l’explicitent les travaux de Philip Pettit sur la « liberté de non domination », participer à l’avènement d’une société égalitaire, c’est dépasser l’assignation des individus à des « classes de vulnérabilité », même pour excuser l’inexcusable.
Vous parlez dans votre article de « féminismes », au pluriel, donc. Aujourd’hui, même si cela n’est pas toujours perçu par le grand public, il existe d’importants conflits entre au moins deux branches : un « féminisme libéral » dit « universel », avec des têtes d’affiches le plus souvent très médiatisées (comme Emma Watson) et un « féminisme radical », au premier rang duquel on retrouve plutôt des chercheuses et des militantes plus âgées (Nancy Fraser dont nous avons abondamment parlé déjà, Jessa Crispin, Andrea Dworkin, etc.). Ces tensions là et cette diversité des courants politiques qui irriguent les pensées féministes recoupent-elles des dynamiques géopolitiques connues ?
Interroger la cartographie et les frontières des féminismes est complexe. Comme nous l’avons vu précédemment, le féminisme a émergé historiquement comme mise à distance des justifications essentialistes des inégalités femmes-hommes. Comme le montrent en particulier les travaux d’Odile Filliod, de Thierry Hoquet et d’Elsa Dorlin, le rapport critique à l’autorité scientifique est essentiel pour ne pas s’enfermer dans une naturalisation de la binarité sexuée. Cela permet de comprendre que le fait que d’être une femme ou un homme n’est pas une identité, mais une identification. Dans ce contexte, questionner le propre du féminisme, c’est interroger les frontières du politique. L’enjeu n’est pas celui de savoir qui est en position de donner ou d’enlever les points d’un permis de féminisme, mais de poser la question de son sens. Qualifier de « radical » le féminisme fondé sur la dé-essentialisation et la politisation des inégalités, c’est ne pas faire de cette posture une condition même de la démarche féministe. Cette tendance est d’autant plus grande que le terme de féminisme, originairement source de discrédit, devient une ressource marketing réappropriée par des actrices/acteurs et des mouvements se présentant comme promoteur de l’intérêt des femmes, même via la modernisation de l’essentialisme. Il y a ici, pour moi, une contradiction vidant de son sens le terme « féminisme ».
La binarité sexuée est une fiction politique, de la même manière qu’être noir ou blanc est une fiction politique. Selon moi, la spécificité du féminisme, c’est dénoncer les répercussions sociales et politiques de l’identification femmes-hommes prétendument naturelle. Partir de la généalogie du féminisme comme anti-essentialisme rend contradictoire le fait de reconnaître comme féministe les démarches néo-essentialistes. C’est pour cette raison qu’en avril dernier, j’ai répondu à la « Tribune des 100 [femmes] » dans Le Nouveau Magasine Littéraire : « Ne nous libérez pas, l’égalité va s’en charger ». J’y affirme qu’opposer liberté et égalité est une rhétorique permettant de discréditer sous le sceau de la morale comme censure ce qui est application du principe fondamentalement politique d’égalité. L’égalité est une condition de la liberté, car on ne peut pas être libre tant qu’on est soumis à un plus fort ou légitime que soi, en particulier vis-à-vis de l’expression de ses désirs et de ses plaisirs.
Par ailleurs, que signifie qualifier cette « Tribune des 100 » de « féministe », ceci alors même que toutes les signataires ne se reconnaissaient pas comme telle ? Est-ce que féministe que de légitimer le dressage des corps à une biopolitique hiérarchisante ? Selon une définition anti-essentialiste du féminisme, non. Dans ce registre, il faut dépasser le discrédit porté, consciemment ou non, sur le féminisme qualifié de radical perçu comme extrême et non comme approche des inégalités par leurs racines.
La binarité sexuée est une fiction politique.
Réjane Sénac
La question posée est aussi celle des alliances envisageables ? Est-ce que stratégiquement, sur un cas ou un point, on peut – voire on doit – faire des alliances stratégiques ? C’est un vrai sujet à analyser en fonction du contexte national. Ainsi, en Espagne, à la différence de la France, il n’y a pas eu d’alliance transpartisane pour promouvoir le partage des responsabilités politiques car les féministes considèrent que porter l’égalité femmes-hommes consiste à remettre en cause le système inégalitaire dans son ensemble et ses imbrications.
Il est intéressant de comparer la tolérance face aux justifications néo-essentialistes de l’inclusion des femmes au nom de leur « plus-value » avec le malaise et les controverses que provoquent les références néo-essentialistes lorsqu’il s’agit de lutte contre le racisme.
Pensez-vous que les différences géopolitiques – de nature institutionnelle, culturelle, économique, linguistique, etc. – recoupent certaines frontières entre les féminismes ? Ou, au contraire, cette cartographie du politique interrogée par le féminisme vient-elle bousculer les dynamiques géopolitiques traditionnelles ? On sent bien que, malgré un élan international, extrêmement visible après l’affaire Weinstein et le phénomène #MeToo, la lutte a eu plus de mal à converger qu’on aurait pu le croire. En Europe, certaines contre-réponses françaises et italiennes faisant basculer le #MeToo au « Sans moi » furent aussi rapides que cinglantes, d’ailleurs présentées comme « anachroniques » par de nombreux commentateurs extérieurs. Dans le monde arabe, les débats féministes qui se déroulent en Europe ou transatlantique sont souvent perçus comme la marque d’un privilège indécent réservé à une petite élite.
Ce qui est intéressant, c’est que cela vient interroger le lien entre globalisation et path dependency. En fonction de leur pays d’habitation et de leur nationalité, les individus n’ont pas les mêmes droits lorsqu’ils sont identifiés comme femme ou homme. L’ONU a joué un rôle central, en particulier à travers les conférences mondiales, dans la globalisation de l’égalité de droit comme standard international que cela soit en termes de citoyenneté civile (droit de vote et d’éligibilité), ou civile (droit de contracter, de travailler et de choisir son métier, de gérer son salaire, ses biens et ceux de la famille…). L’isonomie comme égalité de droit et devant le droit est une condition que les femmes soient des citoyennes à part entière.
C’est une exigence posée comme une condition de reconnaissance internationale, dans un monde qui n’est pas encore égalitaire.
La France, qui se met aujourd’hui en scène comme exemplaire concernant l’égalité femmes-hommes, a longtemps été caractérisée par un droit inégalitaire dont elle porte encore les scories en termes juridiques, politiques et sociales. Contrairement aux pays de common law reposant sur la jurisprudence, la France est un pays de codes ayant ancré le sexisme comme norme juridique en faisant des femmes des mineures légitimement sous tutelle légale. Cet héritage a certes été amendé, mais il n’a pas été remis en cause profondément. Cela explique pourquoi il est encore, par exemple, difficile de faire valoir pour les femmes le droit de garder leur nom « de naissance » quand elles sont mariées – ce nom qualifié de « nom de jeune fille » ce qui dit le poids du modèle hétéronormé où les femmes ne sont achevées que quand elles ont trouvé leur mari. Ou pourquoi l’imposition est encore calculée par unité familiale et non individuellement.
Les pays nordiques se caractérisent par une individualisation des droits essentielle pour ne pas rester sur le registre de la complémentarité sexuée des droits et des devoirs. Les modèles d’État-Providence, tels que discutés par les autrices féministes en lien avec la typologie d’Esping-Andersen 21, induisent une plus ou moins grande autonomie vis-à-vis de la logique de l’ayant droit par rapport au male breadwinner du modèle bismarckien (assurantiel). Même si la France est présenté comme un mixte entre les modèles béverdgien (assistantiel) et bismarkien, le fait que le numéro de sécurité sociale des femmes commence par un « 2 » incarne l’héritage qui associe les femmes aux ayant droits en termes de protection sociale. Ainsi, l’analyse des héritages politiques et juridiques est essentielle pour comprendre ce qui résiste à l’égalité dans les différents pays.
Au-delà de ces différences d’héritage (path dependency), l’égalité de droit est une revendication commune. Le droit d’être un individu à part entière et autonome, sans distinction lié au sexe, est à l’origine des plaidoyers contre le statut personnel dans les pays du Maghreb et du Moyen-Orient. Les différences dans le droit à l’héritage sont en particulier dénoncées par exemple comme injustes.
L’isonomie comme égalité de droit et devant le droit est une exigence posée comme condition de reconnaissance internationale, dans un monde qui n’est pas encore égalitaire.
Réjane Sénac

C’est une question adressée de manière globale avec un appui, voire même une impulsion des institutions internationales au premier rang desquels l’ONU. L’égalité de droit est fondamentale au sens de prérequis et de conséquence d’une conception des femmes comme des sujets en capacité d’être libres et égales.
Appréhender les choix de politique publique en termes de mutualisation de bonnes pratiques (good practice) exportables car déconnectées de leur épaisseur juridique, politique et historique, c’est une nouvelle fois s’inscrire dans une logique de dépolitisation de l’égalité. On fait comme si on allait concocter une recette magique en prenant ça et là, un peu en Espagne, un peu des pays du nord de l’Europe (par exemple pour ce qui concerne le partage des congés parentaux, le droit à une place en collectif pour la garde des enfants…). Ce mélange peut être tentant, mais il nie la dimension structurelle des inégalités pour chaque pays.

L’une des lois qui est selon moi l’une des plus intéressantes, c’est la loi cadre espagnole de 2004 : c’est une loi systémique qui va de la socialisation non sexiste jusqu’au partage du pouvoir et qui montre bien que, porter l’égalité, c’est se donner les moyens d’agir de manière transversale aux secteurs de politique publique. Ce n’est pas un hasard qu’une telle loi ait été voté dans le premier pays méditerranéen ayant accordé le droit de vote aux femmes (1931) et où les féministes ont été partie prenante de la rédaction de la constitution en 1978 suite à la mort de Franco.
Quand on analyse les arguments en présence pour justifier l’ouverture du mariage civil aux couples de même sexe la différence entre la France et l’Espagne est flagrante 22. La France a justifié cette loi sur le registre de la continuité républicaine comme poursuite de la sécularisation du mariage. En Espagne, le clivage avec un héritage sexiste et hétéronormé, voire homophobe, a été clairement assumé. L’intensité de l’opposition à cette loi en France, plus grande paradoxalement qu’en Espagne, est ainsi à comprendre comme l’expression de divergences politiques sur ce que doit être le lien entre contrat social et contrat sexuel avant d’être religieuses. Tant que le « comment » est déconnecté du « pour quoi » et du « qui », nous ne comprenons pas ce qui est en jeu.
Comme vous l’avez dit, des structures internationales et transcontinentales essaient pourtant d’arrimer ensemble des politiques divergentes sur des objets communs, dont l’égalité femmes-hommes n’est qu’un exemple. En tant que chercheuse et experte, sensible à ce qui se passe à l’étranger – de mieux, de moins bien ou, tout simplement, de radicalement différent – comment conseillez vous le monde politique français ?
Les universitaires comme moi sont sollicité•e•s en particulier lors de ce moment cathartique qu’est l’élection présidentielle pour dire aux politiques quelle boîte à outils est le plus adaptée pour réparer les inégalités femmes-hommes. Pour la plupart des autres sujets, il serait impensable que les politiques délèguent à un expert des arbitrages qu’ils comprennent d’emblée comme idéologique et stratégique. Prenons un cas précis. La mise en place d’un mode de garde pour tous les enfants – un droit de garde lié à l’enfant, donc, non aux parents, voire à la mère – ouvert 24/24h et portant une socialisation à l’égalité constituerait, selon moi, un outil essentiel. [ndlr En Europe, la Suède, la Finlande, la Norvège, la Lettonie et la Slovénie ont fait le choix d’une organisation intégrée pour les enfants d’âge scolaire et préscolaire.] Il ne faut en effet pas occulter que les parents, et en particulier les mères dans les situations économiques les plus précaires, travaillent en horaires atypiques ou segmentés. Ce choix repose sur une conception de la solidarité, mais aussi sur une déconstruction d’un ordre sexué où cela serait aux « mères de garder les enfants la nuit » comme me l’avait répondu un candidat à la présidentielle de 2007. La même personne qui l’instant d’avant me demandait de lui donner un kit de mesures prêtes-à-l’emploi s’est alors rendu compte que le choix des outils de politique publique fait partie de l’arbitrage idéologique. Parler de bonne pratique ne doit pas faire oublier que l’essentiel est de définir ce que l’on juge bon et juste.
L’analyse des héritages politiques et juridiques est essentielle pour comprendre ce qui résiste à l’égalité dans les différents pays.
Réjane Sénac

Le fait que la « clause de l’Européenne la plus favorisée », portée par Gisèle Halimi, ai fait consensus à l’Assemblée nationale en 2010 dit la reconnaissance de l’égalité femmes-hommes comme sujet légitime, mais cela ne dit rien de ce qu’on considère comme « étant le plus favorable » à cette égalité. L’unanimité est une fausse bonne nouvelle dans la mesure où derrière le consensus apparent se cache des conceptions divergences du contrat de genre à promouvoir. S’il est encore marqué par l’attachement à la complémentarité des sexes à la droite de l’échiquier politique, la gauche, en particulier les communistes et France Insoumise, remettent en cause la structure patriarcale et les inégalités structurelles. Le danger de ce type de consensus c’est qu’il peut faire écran à ces divergences et donc à une réelle réflexion, discussion et dispute sur ce qu’il est légitime de porter.
En somme, débattre politiquement des enjeux liés au genre et au féminisme, c’est accepter la contradiction, à l’échelle nationale comme internationale ?
L’idéal, voire l’illusion 23, du consensus sur l’égalité femmes-hommes ne doit pas faire écran aux divergences concernant ce que recouvre ce principe. La reconnaissance de la pluralité des positionnements face à ce que signifie et exige l’égalité femmes-hommes demande de penser le féminisme sur un mode agonistique où le pluralisme est assumé pas seulement comme moyen, mais aussi comme fin si les positions sont incompatibles et donc les compromis des reniements. Penser le féminisme comme une ressource du politiquement correct, c’est accepter que cela soit une « novlangue » dépouillée de potentialité critique, un « feminist washing ».
Mêlant l’explicatif et le normatif, l’École de Francfort porte le dépassement du mythe de l’objectivité scientifique à travers la remise en cause des dichotomies jugement de valeur/rapport aux valeurs, scholarship/commitment (science/engagement) 24.Mes travaux s’inscrivent dans cette remise en cause d’un rapport à la vérité comme dévoilement, alètheia. Comme l’ont souligné les oppositions à l’ouverture du mariage civil aux couples de personne de même sexe, sur certains sujets, assumer le pluralisme c’est faire le diagnostic de divergences irréconciliables. Les conditions de possibilités de l’échange ne sont pas simples, au vu de la complexité de l’usage des termes, des articulations entre « quoi », « qui » et « pourquoi ». Partir du principe que nous entendons tous la même chose quand nous parlons d’égalité femmes-hommes (ou gender equality) ou de « féminisme », etc., c’est croire qu’il ne reste de désaccord que sur la question du « comment ». Or les choix de politique publique (policy) n’ont de sens que comme idée en action (polity) en lien avec des structures et des acteurs (politics). Le féminisme peut être qualifié de politique au sens où il est pluriel, complexe et imbriqué dans des conceptions divergences du juste et des moyens à mettre en œuvre pour les faire advenir.
Sources
- Réjane Sénac, « Féminismes et théorie critique. Réflexions sur le cas français » in Cités, 2018/1 (N° 73), p. 91-102. DOI : 10.3917/cite.073.0091. URL : https://www-cairn-info.proxy.rubens.ens.fr/revue-cites-2018-1-page-91.htm.
- Alexandre Dumas fils, L’Homme-femme. Réponse à M. Henri d’Ideville, Paris : Michel Lévy frères, 1872.
- Christine Bard, Le féminisme au-delà des idées reçues, Le Cavalier Bleu, 2012.
- Roland Barthes, Mythologies (1957), Paris : Seuil, 2014. c’est-à-dire au sens d’une parole dépolitisée.
- Thomas Piketty, Le Capital au xxie siècle, Paris : Seuil, 2013, p. 59.
- Ibid.
- Ibid., p. 61.
- Ibid.
- Roland Barthes, Mythologies, op. cité, p. 225.
- Les inégalités entre les sexes sont pointées par Thomas Piketty entre deux virgules page 440, entre parenthèses page 441.
- À ce propos, voir Réjane Sénac, « Le contrat social à l’épreuve de l’offensive contre ladite “théorie du genre“ » in Laurie Laufer et Florence Rochefort, Qu’est-ce que le genre ?, Paris : Payot, 2014, p. 231-243.
- Jean-Jacques Rousseau, Émile ou De l’éducation, op. cit., p. 470.
- Ibid., p. 474.
- À l’occasion de l’annonce de son plan pour l’égalité femmes-hommes, le 25 novembre 2017, Emmanuel Macron avait fortement déplu à de très nombreuses associations et personnes militantes en développant ce principe essentialiste d’altérité : « Il ne s’agit pas de nier la différence entre les sexes, cette altérité profonde à laquelle je crois. » Lors de la journée internationale des droits de la femme (8 mai 2018), Emmanuel Macron avait de nouveau déclaré : « Je crois dans l’altérité. La vraie altérité pour un homme, c’est la femme. (…) Je suis profondément féministe car j’aime ce qu’il y a d’irréductible dans l’autre qu’est la femme. »
- Réjane Sénac, L’égalité sous conditions : genre, parité, diversité, Paris : Presses de Sciences Po, 2015, p. 111.
- Elsa Dorlin, La matrice de la race. Généalogie sexuelle et coloniale de la Nation française, Editions la Decouverte, Paris, 2006.
- Jean-Marc Ferry, Valeurs et normes : La question de l’éthique, Bruxelles : Édition de l’Université de Bruxelles, 2002.
- À ce propos, voir Delphine Dulong, Rôle de genre et drôle de genre. Édith Cresson Premier Ministre ou le mauvais genre en politique. Les identités de genre en politique, Juin 2011, Dijon : https://halshs.archives-ouvertes.fr/halshs-01537685/document
- Voir à ce propos la réponse des économistes féministes à la note du FMI intitulée « Les femmes, le travail et l’économie : les grains macroéconomiques (à attendre) d’une égalité des sexes » de 2013 : https://www.awid.org/fr/nouvelles-et-analyse/des-economistes-feministes-reagissent-une-note-recemment-publiee-par-le-fmi
- Éloi Laurent, Le Bel Avenir de l’État providence, Paris : Les liens qui libèrent, 2014.
- Sandrine Dauphin, « Action publique et rapports de genre » in Revue de l’OFCE, vol. 114, no. 3, 2010, p. 265-289.
- David Paternotte, Revendiquer le « mariage gay ». Belgique, France, Espagne, Bruxelles : Editions de l’Université de Bruxelles, 2011 ; Bronwyn WINTER, Maxime FOREST, Réjane SÉNAC (dir.), Global Perspectives on Same-Sex Marriage, A neo-Institutional Approach, Basingstoke, Palgrave MacMillan Global Queer Politics, 2018, p. 105-126.
- Chantal Mouffe, L’Illusion du consensus, Paris : Albin Michel, 2016.
- Pierre Bourdieu, « Pour un savoir engagé » in Interventions (1961-2001), Sciences sociales et actions politiques, Marseille : Agone, 2002.


