Un monde sans transition ? une conversation avec Jean-Baptiste Fressoz
Dans son nouvel ouvrage, Sans transition : une nouvelle histoire de l’énergie, l’historien Jean-Baptiste Fressoz revient sur les discours contemporains de la « transition énergétique ». Pour lui, ils sont nourris de récits historiques frauduleux sur de supposées transitions passées. En mettant au jour l’empilement des sources d’énergie dans l’histoire, leurs interdépendances ou leurs symbioses et la fabrique des récits de la transition, il nous invite à nous débarrasser d’un concept qu'il juge inopérant. Nous l'avons rencontré.
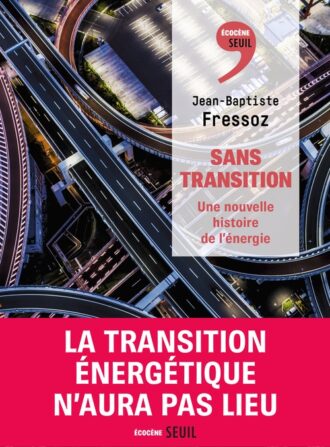
L’une des thèses centrales de votre ouvrage est la mise en cause d’une vision phasiste de l’histoire de l’énergie et des matières en tant que succession d’époques matérielles distinctes (vision phasiste dont vous proposez une généalogie intellectuelle dans le chapitre 2). Or cette vision phasiste ne relève pas simplement du sens commun, mais se retrouve également dans des ouvrages d’auteurs majeurs de l’histoire environnementale. Pouvez-vous revenir sur le genre de récit que propose ce type d’ouvrage, l’usage du terme de transition qu’il mobilise, et sur les phénomènes qu’il empêche de voir ?
Il faut être futurologue ou historien pour arriver à lire l’histoire de l’énergie de manière phasiste. Si l’on prend un graphique représentant le mix énergétique mondial sur un ou deux siècles, on voit tout de suite que rien ne décroît. L’astuce pour voir des transitions, à partir des années 1970, c’est de mettre les énergies primaires en relatif et d’inclure le bois : alors deux transitions apparaissent, l’une du bois au charbon, l’autre du charbon au pétrole. Les historiens ont ensuite collé à cette vision en relatif la notion de « système technique » — qui est problématique —, l’idée qu’il y aurait un « système bois », un « système charbon », un « système pétrole », ou encore « un système technique » de la révolution industrielle centré sur le charbon et la vapeur. Toutes ces catégories sont des abstractions qui simplifient drastiquement la complexité matérielle de la production à chaque époque. Ensuite la chose principale à raconter et expliquer, ce sont les passages d’un système à un autre.
La deuxième caractéristique de l’historiographie est une forme de spécialisation. Vous avez des historiens du charbon, d’autres du bois et d’autres encore du pétrole. Résultat, les intrications entre ces matières et ces énergies qui sont le cœur de mon livre étaient relativement négligées. Enfin, troisièmement, et c’est un travers qui est assez général et qui dépasse largement la question de l’énergie, les historiens ont eu tendance à s’intéresser au nouveau à chaque époque. Ce point avait été parfaitement souligné par David Edgerton dans The Shock of the Old1. Ce biais ne fait que refléter un travers beaucoup plus large : la fascination pour l’innovation. Si vous ouvrez les pages « technologie » d’un journal, vous trouverez des informations sur les innovations voire les derniers gadgets à la mode et pas ou très peu de choses sur les vieilles techniques qui sont avec nous depuis longtemps et qui sont autrement plus importantes. Lit-on en ce moment beaucoup d’articles sur l’évolution technologique des tracteurs ou bien des machines-outils ? Et pourtant il est probable qu’il se passe des choses passionnantes dans ces domaines, peut-être plus importantes que Chat GPT. Cette façon de penser l’histoire et l’innovation est très dangereuse pour la compréhension du défi climatique.
Pourquoi ?
Prenez le dernier rapport du groupe III du GIEC d’avril 2022. Il y a plusieurs pages sur une discussion très étrange : est-ce que la transition à venir va arriver plus vite que les transitions énergétiques du passé ? Or ces transitions du passé sont des constructions intellectuelles assez fantomatiques. Prenez encore le rapport Pisani-Ferry, remis en mai 2023 à Élisabeth Borne : il conclut qu’il faut taxer les riches pour financer la transition, mais il commence nettement moins bien, avec un graphique en relatif du mix énergétique mondial pour expliquer qu’il faut une nouvelle révolution industrielle. L’idée est reprise par Agnès Pannier-Runacher, l’ex-ministre de la transition énergétique. Tout cela reflète une compréhension problématique des dynamiques énergétiques et matérielles du passé : pendant la première révolution industrielle, une notion en elle-même abandonnée depuis longtemps par les historiens, tout a crû. Il n’y a aucune transition d’une énergie à une autre. Le bois de feu croît au XIXe siècle, le bois énergie croît au XXe siècle … Ce biais se retrouve dans le discours des entreprises. Areva par exemple avait fait il y a quelques années une superbe publicité où l’on avait une vision hyper phasiste de l’énergie — éolien, hydraulique, charbon puis pétrole et maintenant place au nucléaire ! C’est pour cette raison que l’histoire de l’énergie a une importance réelle dans le débat public sur le climat. Elle est instrumentalisée à tout bout de champ.
Mon livre opère quelques déplacements par rapport à l’historiographie standard de l’énergie. Premièrement, il part d’un constat trivial et connu… depuis les années 1920 : l’histoire de l’énergie, c’est avant tout une histoire d’empilements. Ni les matières premières, ni les énergies ne sont jamais obsolètes. Et deuxièmement, un point moins trivial et moins connu : c’est une histoire de symbioses. Quand on dit « pétrole », « charbon », on manie en réalité des abstractions statistiques. Ces énergies reposent sur des bases matérielles bien plus larges que ce que désigne leur nom. Le charbon par exemple, c’est énormément de bois (il fallait à peu près une tonne d’étais pour sortir 20 tonnes de charbon au début du XXe siècle). Résultat, l’Angleterre utilise plus de bois en 1900 pour étayer ses mines de charbon qu’elle n’en brûlait un siècle plus tôt… Quant au pétrole, c’est plein de charbon (car il faut de l’acier pour l’extraire et plus encore pour le brûler) et donc de bois… Toutes ces matières et ces énergies sont complètement intriquées. Mon livre s’adresse d’abord à mes collègues historiens en disant : « Regardez, il y a des choses intéressantes qu’on n’a pas racontées », comme l’histoire des étais ou des tubes pétroliers. La question « Est-ce que la transition va avoir lieu ? » ne m’intéresse pas plus que cela parce que tout le monde sait qu’on ne va pas décarboner l’économie mondiale en trente ans. Il suffit de lire les rapports de l’Agence internationale de l’énergie (AIE) ou ceux de l’Energy Information Administration américaine.
Les transitions du passé sont des constructions intellectuelles assez fantomatiques.
Jean-Baptiste Fressoz
Dans L’Événement Anthropocène (écrit avec Christophe Bonneuil)2, vous plaidiez pour une histoire des services énergétiques (pp. 125-126). Vous revenez sur ce point dans le chapitre 1 de ce livre (« À la lueur d’une bougie »), en rappelant que ces services énergétiques ne se confondent pas avec la consommation d’énergie primaire sur un territoire national. Pouvez-vous illustrer ce distinguo avec un exemple ? Plus largement, quelles sont les implications plus larges de cette distinction pour l’histoire de l’énergie et de l’industrialisation ?
C’est un point qui est surtout important pour comprendre l’histoire de l’industrialisation au XIXe siècle, et qui devient moins important pour faire des comparaisons entre pays riches en 1960 qui ont des systèmes énergétiques relativement similaires. En revanche, au début de l’industrialisation, ne prendre en compte que l’énergie primaire biaise complètement la compréhension des dynamiques en cours, car dès que vous faites rentrer une tonne de charbon dans votre économie, d’un seul coup l’énergie explose, parce qu’il y a énormément d’énergie dans le charbon. Le problème, c’est qu’elle est utilisée dans des machines à vapeur ou des usines de gaz d’éclairage qui ont des rendements catastrophiques, et qui perdent l’essentiel de l’énergie primaire – le rendement des machines à vapeur passe de 3 à 15 % au cours du XIXe siècle. On peut aussi ajouter que l’EROI (le taux de retour énergétique) du charbon n’était pas formidable : dans les années 1920, 8 % du charbon anglais est utilisé dans les mines de charbon, rien que pour extraire du charbon ! L’histoire de l’énergie s’est construite sur les données d’énergie primaire, or ce qui compte pour l’activité économique, ce sont bien sûr les services énergétiques. C’est pourquoi l’histoire a renforcé la compréhension d’une industrialisation complètement déterminée par le charbon. C’est un point important qui est surtout historiographique. À un moment, je me suis posé la question : « Est-ce que j’ouvre le chantier d’une histoire non pas de l’énergie, mais des services énergétiques ? ». En réalité, on retomberait plus ou moins sur l’historiographie économétrique des années 1970, qui montrait que la croissance avait été bien plus progressive que l’idée d’une révolution industrielle ne le laisse paraître. Les historiens-économétriciens se basaient non pas sur les séries énergétiques, mais sur des séries économiques à travers la reconstruction du PNB. Bref, le risque était de retomber, après beaucoup d’efforts, sur des résultats assez connus. Mais il reste néanmoins bien des choses à re-raconter une fois prise en compte cette distinction. Par exemple, si vous rapportez le nombre de machines à vapeur au nombre d’entreprises en France en 1900, vous voyez que 98,6 % des entreprises industrielles et agricoles n’ont pas de moteur. L’économie française en 1900, c’est surtout beaucoup d’énergie musculaire !
Vous critiquez, à la suite de l’historien David Edgerton, le biais — aussi bien en histoire des sciences et des techniques qu’en l’histoire de l’énergie — consistant à se focaliser sur le nouveau. Vous proposez a contrario « une histoire sans direction » mettant en cause l’idée que certaines énergies seraient plus « traditionnelles » que d’autres. Cette désorientation passe dans votre ouvrage par la démonstration de la modernité de techniques ou d’énergies vues comme anciennes (la bougie ou le charbon par exemple), ou à l’inverse, par la relativisation de la modernité matérielle d’un bâtiment emblématique du capitalisme industriel, le « Palais de cristal » de l’Exposition universelle de Londres de 18513 (cf. le chapitre intitulé « Timber Palace »). Pouvez-vous revenir sur cette critique et sur la manière dont vous l’illustrez ?
Le discours sur les techniques fait des hypothèses assez arbitraires sur ce qui serait moderne et sur ce qui serait ancien. Sur le palais de cristal, on a effectivement beaucoup de discours philosophiques sur la modernité extraordinaire de ce bâtiment, symbole de la globalisation et du capitalisme moderne. Dans les manuels scolaires c’est aussi la vignette classique du chapitre sur la révolution industrielle… Certes à l’intérieur du palais de cristal, il y avait plein de machines et même un gros morceau de charbon ! Mais pour ce qui concerne le bâtiment en tant que tel, il comporte trois fois plus de bois que de fer et de verre ! Il a été conçu par l’architecte d’un immense propriétaire terrien, spécialiste des serres. Bref, c’est un bâtiment qui est ancré dans le monde aristocratique et agricole. Notez qu’en 1936, le bâtiment flambe d’un seul coup car le bois soumis à plus d’un demi-siècle d’effet de serre était parfaitement sec. Le palais de cristal est finalement une bonne métaphore du capitalisme moderne, mais certainement pas pour les raisons un peu clichées qu’en donne Sloterdijk par exemple.
Le palais de cristal illustre un décalage important entre notre compréhension de ce qui est moderne et la matérialité de la modernité. Vous citiez l’exemple de la bougie. Cet emblème de l’archaïsme est en fait un objet très moderne au XIXe siècle, issu des laboratoires de la chimie organique, produit industriellement dans de grandes usines qui importent des matières grasses du monde entier et en particulier de l’huile de palme d’Afrique de l’Ouest. On recycle aussi les graisses des abattoirs, donc c’est une forme d’économie circulaire avant l’heure ! Les bougies stéariques fabriquées à Londres, Paris ou Marseille sont exportées dans le monde entier à la fin du XIXe siècle. Cet exemple est intéressant car les historiens critiques de la modernité — par exemple Wolfgang Schivelbusch qui a écrit un bon livre sur l’histoire de la lumière4 — prennent bien trop au sérieux les prétentions des modernisateurs, dans le cas d’espèce le gaz d’éclairage, à représenter la modernité. D’ailleurs, si on poursuit l’histoire de la lumière au début du XXe siècle, la grande technologie d’éclairage, ce n’est pas l’électricité, mais… la lampe à pétrole. C’est une énergie fossile mais cela reste low-tech. Donc oui, dès qu’on creuse un domaine on se rend compte qu’on a des histoires stéréotypées de ce qui est moderne et de ce qui ne l’est pas, de ce qui est industriel et de ce qui ne l’est pas : la bougie par exemple est plus industrielle que le gaz ou du moins sa production est plus concentrée. Il y a de très grosses usines de bougies, alors que pour le gaz, il faut mettre une ou plusieurs usines dans chaque ville. Pourquoi les historiens sont fascinés par le gaz d’éclairage ? Parce que c’est une technique qui fonctionne en réseau, et la modernité, c’est forcément le réseau.
Le discours sur les techniques fait des hypothèses assez arbitraires sur ce qui serait moderne et sur ce qui serait ancien.
Jean-Baptiste Fressoz
Votre livre, comme celui d’Antonin Pottier que vous mentionnez à plusieurs reprises dans l’ouvrage5, peut être vu comme une sorte de critique environnementale de l’économie politique : pouvez-vous revenir sur le rôle de certains économistes dans la fabrique de l’apathie climatique, et notamment celui de William Nordhaus, lauréat du « prix Nobel » d’économie en 2018 (vous rappelez la déclaration assez stupéfiante de son co-récipiendaire Paul Romer qui affirme que grâce à la recherche et développement dans les innovations vertes, « décarboner l’économie sera si facile qu’en regardant en arrière on aura l’impression de l’avoir fait sans effort ») ?
Le cas de Nordhaus est intéressant par rapport à ce que je raconte car c’est le premier économiste du climat, il a reçu un prix Nobel pour ses travaux, or il a une vision aberrante de l’histoire des techniques qui n’est pas sans conséquence sur ses conceptions économiques. Dans un papier célèbre, Nordhaus montre que le prix de la lumière s’est effondré au cours de l’histoire grâce au progrès technologique. Mais il confond les dates d’innovations et les dates d’usage. Les théories économiques de Nordhaus ont déjà été bien étudiées par Antonin Pottier. Son prix Nobel a suscité un grand émoi — il montrait par exemple que le réchauffement optimal était de 3,5°C. Mais il y a un aspect de contexte historique qui n’avait pas été remarqué : l’utopie nucléaire. Quand Nordhaus commence à réfléchir sur le climat en 1974-75, il travaille au IIASA (International Institute of Advanced System Analysis), dans un petit groupe d’experts obsédés par le surgénérateur nucléaire. Selon eux, le surgénérateur devait être disponible et même généralisable d’ici à l’an 2000. On ne saurait surestimer l’importance du surgénérateur dans l’imaginaire des premiers experts du climat, aux États-Unis et au IIASA. Le surgénérateur a été un grand projet technologique, il a représenté de 30 à 40 % de la recherche et développement publique sur l’énergie en Angleterre, en France, aux Etats-Unis dans les années 1970. C’est un immense espoir. Grâce au surgénérateur, les horizons temporels de l’énergie deviennent infinis ou se comptent en dizaines de milliers d’années. Tout cela a eu une très grande influence. En 1974 donc Nordhaus travaille au IIASA dans le programme énergie dirigé par Wolf Häfele, qui est l’ancien directeur des surgénérateurs en Allemagne. Il s’initie à la question climatique auprès d’un personnage fascinant qui s’appelle Cesare Marchetti, moins connu que Nordhaus, mais qui a joué un rôle intellectuel capital dans la théorie de la transition énergétique. Marchetti est aussi un fervent défenseur du nucléaire et de l’hydrogène. En 1973, dans un article important, Nordhaus explique qu’il ne faut pas dans un contexte de montée des prix du pétrole faire des efforts de conservation car d’ici l’an 2000, le surgénérateur nucléaire sera disponible et dévalorisera les réserves de pétrole restant sous le sol. Donc autant exploiter le pétrole quand il vaut encore cher ! Le surgénérateur est qualifié de « backstop technology », un filet de sécurité technologique. Et deux ans après, il utilise le même raisonnement sur le changement climatique : cela ne sert à rien de faire des efforts maintenant, parce que ça nous coûtera cher et qu’on n’a pas les technologies, alors que d’ici l’an 2000, on aura le surgénérateur pour faire la transition, qu’il qualifie encore de « backstop technology ». Cela soulève un point historique clef : la question climatique émerge dans la décennie de la « crise énergétique » et les premiers économistes à se saisir de la question ont travaillé sur la crise énergétique. Il y a une continuité forte entre les raisonnements sur la crise énergétique et les raisonnements sur la crise climatique. Nordhaus a eu une grande influence dans les premiers rapports du GIEC. Dans le deuxième rapport de 1995, il est explicitement écrit qu’il vaut mieux ne pas faire d’efforts tout de suite, parce que ce sera plus facile plus tard, et qu’en plus, le cycle naturel du carbone nous aide à réduire la quantité de CO2 dans l’atmosphère. Enfin, je montre que le président du groupe III du GIEC au début des années 1990, Robert Reinstein, qui — c’est intéressant — est ouvertement climatosceptique, explique consulter Nordhaus et s’inspirer de ses travaux ! Donc oui, les théories de Nordhaus ont directement servi la procrastination climatique.
À partir des années 2000, il est vrai que son influence s’érode car l’objectif des deux degrés devient central dans les négociations climatiques, alors que Nordhaus le disait explicitement : « Deux degrés, c’est comme les panneaux sur l’autoroute indiquant 50 miles par heure aux États-Unis, c’est assez arbitraire et injustifié ». Ici on a affaire au deuxième Nordhaus, bien analysé par mon collègue Antonin Pottier, le Nordhaus du modèle DICE, un modèle coûts/bénéfices où il arrive à la conclusion qu’une augmentation de 3,5 degrés correspond à la température économiquement optimale !
Dans la troisième partie, comme vous l’avez indiqué, vous revenez sur l’histoire du groupe III du GIEC (le groupe évaluant les « solutions ») de manière assez iconoclaste, en montrant que ce dernier préconise en fait une ligne assez attentiste dans les années 1990. Comment expliquer l’évolution profonde que vous repérez dans les années 2000 ? Et comment celle-ci a-t-elle rejailli sur les solutions envisagées depuis lors (vous rappelez qu’en 2005, on trouve encore dans un rapport spécial du GIEC des projets de « lacs » artificiels de dioxyde de carbone au fond des océans…) ?
Je ne suis pas expert de ces questions et il y a des gens qui ont travaillé plus sérieusement que moi sur ce point, comme Hélène Guillemot et Béatrice Cointe. Dans les années 2000, l’objectif des deux degrés s’impose, et même 1,5 degré à Paris en 2015. Et donc à partir de là, on a des scénarios très différents de ce qui était fait dans les deux premiers rapports. Des objectifs NZE (Net Zero Emissions) qui incluent des quantités gigantesques « d’émissions négatives ». En pratique, cela revient à utiliser des BECCS (pour Bioenergy Carbon Capture and Storage) : brûler du bois dans des centrales thermiques pour récupérer ensuite le CO2 et l’enfouir sous le sol. Personne n’y croit vraiment, c’est une cheville pour faire entrer l’économie mondiale sous la barre des 2°C. Ce point soulève une question intéressante, me semble-t-il, sur l’effet politique, volontaire ou involontaire, qu’ont ces scénarios net zéro. Leur but est bien sûr d’éclairer la décision. Ce sont des expériences de pensée assistée par ordinateur. On fixe une limite de réchauffement à 2100 et le IAM (modèle d’évaluation intégré) calcule des trajectoires incluant plus ou moins d’efficacité énergétique, de diffusion de renouvelables, de CCS ou de de BECCS. Ces scénarios sont purement normatifs. Ils ne sont pas prédictifs, prospectifs. Une fois encore, les prospectives de l’Agence internationale de l’énergie (le scénario STEPS) n’envisage pas de décarbonation, seulement une légère diminution du charbon d’ici à 2050. La faisabilité, la plausibilité des scénarios NZE n’est pas évaluée ou peu évaluée. Leur réalisme économique et technologique est probablement très faible.
Pourquoi les historiens sont fascinés par le gaz d’éclairage ? Parce que c’est une technique qui fonctionne en réseau, et la modernité, c’est forcément le réseau.
Jean-Baptiste Fressoz
Mais quel est l’effet politique de ces scénarios qui semblent montrer que tout est possible ? Je n’ai pas de réponse tranchée, mais il faut qu’on ait une discussion là-dessus. Il faut aussi qu’on ait une discussion sur les visions du monde et de la technique qui transparaissent dans les rapports du groupe III du GIEC où l’on parle essentiellement de technologies et surtout de technologies complexes qui concernent les pays riches. Le quatrième rapport annonçait par exemple que la fusion nucléaire serait disponible commercialement d’ici à 2050. À l’inverse, dans leurs rapports du groupe III, peu de choses sont dites, mettons sur le train ou la diffusion possible des bicyclettes ou des visioconférences… Bien sûr que ces visions du futur, que ce soient la fusion ou les BECCS, sont discutables et hautement politiques. Le problème est que le débat est très polarisé : dès qu’on commence à discuter la moindre phrase du groupe III, y compris quand il y a une bêtise évidente (quand ils parlent d’histoire), on passe presque pour un dangereux luddite anti-science sur les réseaux sociaux…
Pouvez-vous revenir sur le rôle de certains économistes dans cette évolution du groupe III (notamment Jean-Charles Hourcade) ?
J’ai beaucoup discuté avec Jean-Charles Hourcade sur cette période-là, qu’il a vécue, et il me disait qu’il y avait une vraie bataille avec Nordhaus et le parti de l’attentisme. Ce que Hourcade et ses collègues montraient, modèles à l’appui, c’est qu’il était capital de faire dès maintenant des efforts tout de suite parce que la technique ne tombe pas du ciel. Mais encore une fois, je ne suis pas expert de ces questions. Concernant les rapports, ce qui se passe, c’est que dans le groupe III du GIEC, il y a les rapports centraux, les Assessment reports, tous les 6 ans. Mais parfois, il y a des rapports vraiment étranges quand les gouvernements en demandent sur des sujets précis. Par exemple, en 2005 paraît un rapport sur le CCS (Carbon Capture and Storage), quand l’industrie pétrolière fait miroiter cette solution. Et paf, on a un rapport estampillé GIEC qui propose tout plein de solutions venues de l’industrie pétrolière, y compris d’étranges lacs artificiels de dioxyde de carbone reposant au fond des océans — ce qui n’est probablement pas extraordinaire pour les écosystèmes marins… Le GIEC est un groupe intergouvernemental, donc les gouvernements y ont évidemment un certain rôle, ce qui peut poser problème scientifiquement.
Vous pointez, très rapidement (pp. 272-273), les limites du champ des Sciences and Technology Studies (auxquelles vous avez été formé) lorsqu’il s’agit de comprendre la nature du défi climatique, ainsi que certains aspects de la pensée de Bruno Latour. Pouvez-vous préciser ces réserves et revenir sur votre parcours ?
Plutôt que des limites, c’est plutôt une focalisation sur l’innovation qui a conduit à ce que ce champ soit en décalage par rapport à la question climatique. Quand je découvre les STS (Science and Technology studies) au début des années 2000, le grand sujet, ce sont les innovations, les controverses socio-techniques et l’incertitude. Or pour ce qui concerne le climat, dès 1979 la question n’est plus celle de l’incertitude : il va se réchauffer à cause des émissions de GES (gaz à effet de serre). Le second problème des STS était la manière de traiter le phénomène technologique en le réduisant à l’innovation. En France, à Paris-IV, c’est un Centre d’histoire de l’innovation qui s’occupe des techniques. Bruno Latour officie aussi au Centre de sociologie de l’innovation de l’École des Mines. Sa théorie de l’acteur-réseau, une construction intellectuelle anti-déterministe, est née de sa sociologie de l’innovation et de la capacité supposée de l’innovateur et des dispositifs techniques à reconfigurer le social. Quand on prend un peu de recul on discerne facilement l’influence du revival de Schumpeter en économie — la destruction créatrice, l’innovation disruptive — dans ces analyses. En histoire et en sociologie des techniques on insiste aussi beaucoup trop sur la « construction sociale des techniques ». Les travaux se focalisent sur le moment de l’innovation, quand elle aurait pu prendre des formes variées, ils se focalisent aussi sur les consommateurs ou les « parties prenantes », leur capacité à façonner la technique. Les questions économiques et les contraintes matérielles passent au second plan. Pensez à l’ouvrage de Latour sur Aramis, un métro automatique avec des wagons autonomes qui aurait échoué, conclut Latour, « faute d’avoir été suffisamment aimé ». Toutes ces approches ne sont pas sans intérêt, loin de là, et permettent de produire des enquêtes empiriques très riches. Mais il est vrai que le changement climatique soulevait des enjeux complètement différents de ceux étudiés par les STS des années 2000 : il n’y a pas ou peu d’incertitude et il est causé par des vieilles techniques qui sont très difficiles à infléchir pour des raisons matérielles et économiques.
La technique ne tombe pas du ciel.
Jean-Baptiste Fressoz
Pour revenir sur mon parcours, j’ai eu la chance d’être formé par deux personnalités scientifiques qui se sont tenues à distance des STS dans ce qu’elles avaient de plus problématique. J’ai fait ma thèse au Centre Alexandre Koyré avec l’historien des sciences Dominique Pestre, qui était très critique vis-à-vis de la sociologie des controverses socio-techniques et l’idée sympathique mais utopique de démocratie technique. Le centre Koyré était aussi novateur dans le paysage des sciences sociales françaises pour ses travaux sur les questions environnementales. C’est là que je rencontre Christophe Bonneuil qui est alors un jeune chercheur et qui aura beaucoup d’influence sur mon itinéraire ultérieur, ainsi qu’Amy Dahan, une spécialiste des négociations climatiques. Ensuite je suis recruté comme lecturer à l’Imperial College de Londres où travaillait l’historien des techniques David Edgerton. Son livre The Shock of the Old fut pour moi un choc intellectuel, fournissant la meilleure critique des discours schumpétériens sur la technique. C’est un livre capital qui redéfinit le champ de l’histoire des techniques, en élargit le domaine et l’intérêt, un livre dont les enseignements pour la question climatique restaient encore à tirer.
La deuxième partie de l’ouvrage propose une histoire intellectuelle de la notion de transition et revient sur l’influence de celle-ci dans les politiques climatiques (à l’échelle globale et nationale). Dans cette dernière partie, vous relativisez l’importance historique du climatoscepticisme ; ce qui a été déterminant à vous lire, c’est la croyance partagée, y compris par des experts du climat aussi éminents que Roger Revelle, en la possibilité d’une transition rapide, à l’échelle du demi-siècle (échéance brandie sans aucune justification). L’autre élément marquant que vous mettez en avant, à la suite de Romain Felli6, c’est la croyance — résignée ou confiante — des gouvernements dans la capacité à s’adapter, qu’on évoque dès la fin des années 1970, en tout cas aux États-Unis, et dans les années 1980 en Grande-Bretagne ; il nous semble que c’est là l’une des nouveautés qu’apporte votre ouvrage7. Par ailleurs, à vous lire, ces choix sont opérés en dehors de tout débat public. Ce choix de l’adaptation n’est-il pas contradictoire avec la croyance en une transition rapide que vous évoquez ?
Il y a depuis les années 2010 un très fort intérêt public pour la question du climatoscepticisme et de la construction du doute en général. Les collègues ont beaucoup travaillé ce sujet, pour des raisons principalement judiciaires — nourrir les procès contre les entreprises pétrolières. Bien sûr le climatoscepticisme a existé, il existe encore, il est parfaitement documenté. Il y a des entreprises pétrolières, Exxon tout particulièrement, qui ont créé du doute pour des raisons stratégiques et qui, espérons-le, seront sévèrement ponctionnées pour cela. Après, la question qui se pose à l’historien des années 1980-2000 est la suivante : est-ce que le climatoscepticisme est si déterminant que cela pour comprendre l’inaction climatique ? Depuis que le groupe Total (TotalEnergies) se déclare très concerné et « en transition », arrête-t-il pour autant de pomper du pétrole ? Ce hiatus entre un discours de la transition et des pratiques du réchauffement et de l’adaptation, c’est ce que je vois déjà en action au sein de l’élite politique et industrielle américaine des années 1980. Il y a du climatoscepticisme chez certains bien sûr, en particulier autour du président George Bush Père avec John Sununu, son influent chef de cabinet, mais il y a surtout bien d’autres manières plus subtiles de repousser le problème.
Concernant votre question sur transition et adaptation, les personnes et les dates ici sont importantes. Vous mentionniez le cas de Roger Revelle qui, effectivement, en 1979 au Sénat, raconte absolument n’importe quoi sur les transitions du passé qui montreraient qu’on peut faire une transition rapide hors des fossiles en moins de 50 ans. Mais quelques années plus tard, cette position n’est plus vraiment crédible car des modèles énergétiques globaux indiquent au contraire que les émissions vont beaucoup croitre d’ici à 2050.
The Shock of the Old fut pour moi un choc intellectuel, fournissant la meilleure critique des discours schumpétériens sur la technique. C’est un livre capital qui redéfinit le champ de l’histoire des techniques, en élargit le domaine et l’intérêt, un livre dont les enseignements pour la question climatique restaient encore à tirer.
Jean-Baptiste Fressoz
Il y a d’autres trajectoires plus complexes et plus intéressantes. Prenez par exemple Caroll L. Wilson. C’est un personnage méconnu mais qui joue un rôle fondamental dans l’alerte climatique. Au début des années 1950, il est directeur exécutif de l’AEC (Atomic Energy Commission) et commence déjà à s’intéresser au réchauffement climatique qui a toujours été un excellent argument en faveur du nucléaire. En 1970, il contribue à lancer la question du climat à l’échelle internationale. Et puis à la fin de la même décennie, il pilote le rapport WOCOL sur le charbon : il faut relancer le charbon à l’échelle mondiale car le nucléaire ne tiendra pas ses promesses, les commandes de centrales sont en chute libre à ce moment-là. Il voit aussi que l’essentiel va se jouer en Asie. Dans le rapport WOCOL, l’expert chinois explique que son pays sortira probablement 2 gigatonnes de charbon d’ici l’an 2000. À ce moment-là, la production mondiale de charbon, c’est 3 gigatonnes. Donc je pense que ça calme les ardeurs des Américains lorsqu’il s’agit de se demander : « Est-ce qu’on fait un effort sur le changement climatique ? ». Cela n’empêche pas Wilson de penser le changement climatique. Ce n’est pas un climatosceptique : c’est juste qu’il y a un besoin croissant d’électricité dans le monde, « donc » il faut extraire du charbon. À la fin de sa vie, quand il reçoit le prix Tyler sur l’environnement, son discours est sur l’adaptation et le rôle des OGM pour adapter l’agriculture à un monde qui se réchauffe.
Après il y a aussi dans les années 1980 un double discours de l’élite américaine. Un discours très public sur la transition, surtout à destination des autres pays puis au sein des premières COP. Et un discours plus discret mais crucial pour comprendre la position américaine sur l’adaptation. Une fois encore, ce qui est nouveau, à la fin des années 1970, c’est qu’on a des modèles énergétiques globaux, et aucun ne prévoit de diminution du charbon ou du pétrole. La question devient naturellement : « Ça va se réchauffer, est-ce que c’est grave ? ». Et là, assez vite, il y a un consensus dans les think tanks importants autour de la Maison Blanche, qui disent : « Trois degrés, les États-Unis, ça va, on saura s’adapter ! ».
Je crois que cette histoire est importante car on est encore dans ce régime. Le discours sur les méchantes compagnies pétrolières climatosceptiques est trop rassurant. Il crée une dichotomie entre le capitalisme fossile et le capitalisme vert, une dichotomie ensuite entre un avant où la bataille scientifique était indécise, et un présent où maintenant l’on sait. Insister ainsi sur le rôle du non-savoir, c’est donner beaucoup trop de poids au savoir. J’avais déjà critiqué dans L’Apocalypse joyeuse cette idée d’une « prise de conscience ». Cette vision d’un « éveil » est politiquement contre-productive, en plus d’être historiquement fausse.
L’ouvrage insiste particulièrement sur les temporalités projetées, notamment en ce qui concerne le temps que devrait prendre une éventuelle transition. Or vous rappelez qu’en 1979, au moment du rapport Charney, si la réalité du réchauffement ne fait plus vraiment débat parmi les experts américains du climat, son échéance est encore indécise (pp. 276-277). Cette incertitude n’a-t-elle pas été un facteur de procrastination ? A partir de quand une chronologie plus fine du réchauffement climatique émerge-t-elle ?
Très tôt, il y a des débats sur la dislocation de l’Antarctique Ouest, qui fait craindre une grande élévation du niveau de la mer. Mais on ne sait pas précisément quand ça va arriver, et c’est d’ailleurs toujours le cas aujourd’hui, même si les nouvelles semblent plutôt mauvaises sur ce terrain. Le tempo de la catastrophe qu’on trouve dans les années 1970 — et qui est malheureusement assez raccord avec ce qui se passe — c’est que le changement climatique sera sensible en l’an 2000, qu’il aura des conséquences économiques en 2020, et il sera catastrophique en 2080… On n’a plus qu’à espérer que les climatologues se soient trompés sur la dernière date… En 1978-80 quand vous entendez 2080, cela paraît de la science-fiction. C’est pour ça que les climatologues disent : « On va faire une transition ! ». Et que Exxon peut dire la même chose. Et c’est là où l’on voit que l’histoire joue un certain rôle, parce qu’ils n’arrêtent pas de dire : « Il y a eu des transitions par le passé et elles ont pris 50 ans »… Revelle dit précisément cela quand il témoigne devant le Sénat américain, il convoque l’histoire pour démontrer qu’il faut 50 ans pour faire une transition, alors qu’en réalité on n’en sait rien.
Insister ainsi sur le rôle du non-savoir, c’est donner beaucoup trop de poids au savoir. J’avais déjà critiqué dans L’Apocalypse joyeuse cette idée d’une « prise de conscience ». Cette vision d’un « éveil » est politiquement contre-productive, en plus d’être historiquement fausse.
Jean-Baptiste Fressoz
C’est d’autant plus étrange que Revelle n’est pas qu’un océanographe, il s’occupe à cette époque de démographie et de population. Mais cela montre qu’il n’avait pas encore vraiment réfléchi à ce que c’était que sortir des fossiles. Le débat était limité aux systèmes électriques : c’est vrai qu’en 50 ans, on peut faire basculer un système électrique du charbon au nucléaire : la France l’a fait en moitié moins de temps… Mais peut-être n’avait-il pas pris la mesure de tout ce qu’il y a en dehors du système électrique : les transports, le bâtiment, l’aviation, le plastique, l’acier, les engrais, etc. On n’avait pas encore commencé à réfléchir à ça. Par contre, chez Exxon, c’est clairement le cynisme qui est derrière le bla-bla de la transition. Sur ce point encore, Exxon ment. Edward David, qui parle aux climatologues en 1982, dit que, puisque le système énergétique est en transition, la question intéressante, c’est : qu’est-ce qui va arriver avant, le changement climatique ou la transition énergétique ? Et bien sûr, ajoute-t-il, la transition arrivera avant. Et là il ment : quelque mois après, il se trouve à Pékin et il dit exactement l’inverse, les fossiles domineront l’énergie encore loin dans le XXIe siècle.
Quel rapport (historique et idéologique) existe-t-il entre la notion de transition et celle de « développement durable », autre concept consensuel et extrêmement présent dans le débat public ? Alors que ces notions semblent aux antipodes de la stratégie du doute du climatosepticisme, doit-on y voir au contraire les éléments d’un même arsenal discursif au service du business as usual et de « l’idéologie du capital » ?
Il y a eu pas mal de travaux sur l’émergence du concept de développement durable, qui est proposé par le rapport Brundtland de 1987, puis qui explose dans le discours entrepreneurial dans les années 1990, Dominique Pestre l’a bien montré par exemple8. Je pense que ce sont des dispositifs analogues politiquement qui reviennent à créer l’illusion du contrôle et de la maîtrise. Cela sert à justifier la croissance, à l’imaginer déconnectée des flux des matières… Quand on regarde chronologiquement, la transition énergétique explose dans les années 2000, en réponse à l’objectif des deux degrés. Et peu à peu le terme remplace le développement durable qui était devenu bien trop galvaudé. Dans les années 2000, la transition énergétique a repris l’importance qu’elle avait eue dans les années 1970. Sauf que dans les années 1970, la transition énergétique visait à sortir d’une crise des ressources, ce qui pouvait faire sens : s’il y a moins de pétrole, vous diminuez l’intensité pétrole de votre économie donc vous êtes plus résilient face au renchérissement du prix du pétrole. Et on a repris ce concept-là pour quelque chose de très différent. J’insiste beaucoup là-dessus : on plaque une futurologie néomalthusienne sur les ressources à une situation entièrement différente où on a énormément de ressources qu’il ne faut pas utiliser. Quant à mettre les concepts de transition énergétique, de développement durable et de climatoscepticisme dans le même sac, cela peut être compliqué à dire, car il y a plein de gens bien intentionnés qui s’impliquent dans la transition énergétique. Et cela les énerve inutilement. Les critiques de mon livre sont généralement des entrepreneurs qui s’impliquent dans la transition énergétique et qui se sentent attaqués. Alors que ce n’est pas du tout le cas. Le problème, c’est que la transition énergétique est une notion suffisamment malléable pour servir tout autant à Airbus, Total, Vinci qu’à des planteurs d’éoliennes : c’est ça qui m’intéresse. Je le dis pourtant dans l’introduction et le répète dans la conclusion, les énergies renouvelables sont essentielles ! Le débat est si polarisé que si l’on dit que les éoliennes et les panneaux solaires c’est très bien, mais que cela ne va pas tout décarboner et certainement pas dans les temps impartis (2050), on passe soit pour un pronucléaire, soit carrément pour un climatosceptique, c’est usant…
Si le concept de transition est inopérant, quels concepts seraient selon vous plus appropriés pour faire face à la catastrophe en cours ?
Il y en a deux, je pense. D’abord, la diminution de l’intensité carbone de l’économie. Concrètement, c’est ce qu’on fait avec les renouvelables. Parce qu’il y a besoin de back-up, parce que ça n’est pas non plus complètement décarboné, parce qu’elles alimentent en courant une économie qui dans sa matérialité même (acier, ciment, plastique) va dépendre du carbone pendant encore longtemps : une voiture électrique par exemple, ce n’est évidemment pas décarboné, même si cela diminue l’intensité carbone du transport. C’est évident. Pourquoi faut-il le préciser ? Parce que ça oblige à laisser sur la table la question de la taille de l’économie.
On plaque une futurologie néomalthusienne sur les ressources à une situation entièrement différente où on a énormément de ressources qu’il ne faut pas utiliser.
Jean-Baptiste Fressoz
Et donc la deuxième notion, logiquement, c’est la décroissance, le démantèlement de certains espoirs, projets, dispositifs techniques. Il y a des choses qu’il va falloir réduire voire abandonner, et organiser cela. Et une fois qu’on a dit ça, c’est la question de la répartition qui réapparaît. Si on n’imagine pas un monde où tout va croître sans problème d’environnement, la question des inégalités revient de manière un peu plus brûlante. Tout ceci est fort banal, mais cela donne un autre sens politique à la question climatique. Le débat devient un peu moins centré sur les technologies, même si celles-ci sont évidemment importantes, et un peu plus centré sur les questions sociales, par exemple. Et puis aussi sur la question nord-sud qui est le cœur absolu du problème climatique.
Vous insistez à plusieurs reprises sur le caractère rassurant de la notion de transition énergétique. À l’inverse, vous écriviez dans un texte de 2018 (« Quand la catastrophe suit son cours »9) que « l’histoire nous donne de bonnes raisons d’avoir peur ». Quels effets — ou quels affects — espérez-vous susciter avec la publication de ce livre ? Défendez-vous l’idée, comme Hans Jonas, d’une « heuristique de la peur » ?
Deux postures sont effectivement possibles, mais il y en a une qui est plus fondée empiriquement que l’autre. La première option, c’est de dire : la transition est en marche, il suffit de l’accélérer, faites-nous confiance ! La deuxième : il y a encore d’énormes obstacles technologiques pour imaginer une société décarbonée, et donc tout un chacun doit s’intéresser à cela, comprendre un peu l’expertise, mettre son nez dans les scénarios NZE, regarder leurs hypothèses, s’intéresser au CCS et aux BECCS. La peur, ce n’est pas un sentiment honteux, ce n’est pas « antiscience », anti-progrès ou quoi que ce soit. Après, ce n’est pas mon métier que de dire politiquement ce qu’il faut faire ou penser. Je n’ai rien de très original à dire là-dessus.
Quelles sont vos envies de recherche dans les années à venir ?
Je voudrais étendre cet argument des services énergétiques au muscle humain. Je voulais faire un chapitre sur le muscle humain parce que l’histoire de l’énergie est beaucoup trop centrée sur les machines et les fossiles. Je vais travailler sur le muscle humain au XXe siècle pour comprendre la dynamique historique qui aboutit au constat des sociologues comme David Gaborieau ou Juan Sebastian Carbonell. Chez les historiens, il y a encore une ligne à tracer pour comprendre pourquoi le muscle humain reste absolument central dans d’innombrables univers productifs. Et aussi travailler davantage sur les techniques dans les pays pauvres. Voilà, c’est un peu ça mon envie de recherche actuellement : la modernisation de l’usage du muscle humain dans la production. Le muscle humain n’est pas du tout ringard, c’est quelque chose qui se modernise, tout comme la bougie d’une certaine manière. Et puis ce qui me fascine c’est l’histoire de techniques sous-étudiées comme les pelles, les brouettes, les tonneaux. La brouette, c’est surtout dans les années 1950 que ça se diffuse dans les pays riches, donc ce n’est pas du tout une technique ancienne10.
Sources
- David Edgerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, Seuil, coll. « L’Univers historique », 2013, 320 p.
- Christophe Bonneuil et Jean-Baptiste Fressoz, L’événement anthropocène. La terre, l’histoire et nous, Paris, Le Seuil, coll. « Anthropocène », 2013, 304 pages.
- C’est ce caractère emblématique que l’on retrouve dans l’ouvrage du philosophe allemand Peter Sloterdijk, Le Palais de Cristal. À l’intérieur du capitalisme planétaire, Maren Sell, 2006.
- Wolfgang Schivelbusch, La nuit désenchantée, Le Promeneur, 1993.
- Antonin Pottier, Comment les économistes réchauffent la planète, Seuil, 2016, 336 p. Jean-Baptiste Fressoz et Christophe Bonneuil reviennent également sur ce point dans le chapitre 9 de L’Evénement Anthropocène.
- Romain Felli, La grande adaptation. Climat, capitalisme et catastrophe, Paris, Éditions du Seuil, 2016, 240 p.
- Profitons-en pour rappeler que près de la moitié de toutes les émissions produites depuis la révolution industrielle l’ont été depuis 1990 : Lucas Chancel, « Qui pollue vraiment ? 10 points sur les inégalités et la politique climatique », Le Grand Continent, 8 juin 2022.
- Dominique Pestre, « Développement durable : anatomie d’une notion », Natures Sciences Sociétés, 2011/1 (vol. 19), p. 31-39.
- Jean-Baptiste Fressoz, « Quand la catastrophe suit son cours », in Jean Birnbaum (dir.), De quoi avons-nous peur ?, Folio Essais, Gallimard, 2018, pages 63 à 75.
- Cinq recommandations d’histoire environnementale pour aller plus loin :
– On Barak, Powering Empire. How Coal Made the Middle East and Sparked Global Carbonization, Oakland, University of California Press, 2020.
– William Cronon, Chicago, métropole de la nature, Bruxelles, Zones sensibles, 2020 (trad. franç. de Nature’s Metropolis. Chicago, and the Great West, New York/Londres, W. W. Norton & Co, 1991).
– David Edgerton, Quoi de neuf ? Du rôle des techniques dans l’histoire globale, Paris, Seuil, 2013 (trad. franç. de The Shock of the Old. Technology and Global History since 1900, Londres, Profile Books, 2006).
– Romain Felli, La grande adaptation, Paris, Le Seuil, 2016.

