« Il a existé une Méditerranée plus paritaire », une conversation avec Guillaume Calafat et Mathieu Grenet
Comment penser la mobilité en Méditerranée sans tomber dans le biais du déséquilibre qui a marqué l'époque coloniale ? Dans une vaste enquête qui prend pour cadre « les » Méditerranées à l'époque moderne, Guillaume Calafat et Mathieu Grenet parviennent à restaurer la dimension collective d'un espace pluriel et composite. Entretien.
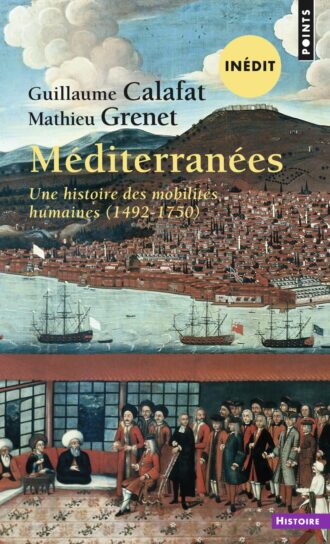
Le titre de votre ouvrage fait référence non pas à une mais à des Méditerranées. Et son premier chapitre s’intitule « une Méditerranée plurielle ». Est-ce à dire qu’il n’y aurait pas à l’époque moderne d’unité, de singularité méditerranéenne ?
Mathieu Grenet
L’ombre tutélaire de Fernand Braudel, qui a posé l’idée d’une unité morphologique et environnementale de la « mer Intérieure », plane encore aujourd’hui sur l’histoire de la Méditerranée. Toutefois, l’historiographie actuelle de cet espace est de plus en plus spécialisée et notre travail est précisément une tentative de conjoindre en une large synthèse des historiographies qui ont travaillé les différents espaces méditerranéens isolément les uns des autres. Méditerranée orientale et occidentale bien sûr, mais aussi divers espaces régionaux plus circonscrits ayant donné lieu à des champs historiographiques propres comme l’Adriatique ou la mer Tyrrhénienne. Notre idée était précisément de décloisonner et de faire dialoguer ces historiographies « subméditerranéennes ». Cette fragmentation historiographique n’est toutefois pas sans fondement. Une des grandes questions qui traverse notre livre est de déterminer jusqu’à quel point, à l’époque moderne, les riverains de la Méditerranée la pensaient comme un tout. Pour un marin, un marchand, un ambassadeur ou un juif expulsé, la Méditerranée ne se limitait-elle pas plutôt à l’espace où leurs horizons respectifs étaient bornés ? Nous avons essayé de penser la Méditerranée comme articulation de sous-espaces habités, investis ou traversés par des acteurs qui n’en fréquentent que certaines parties.
Guillaume Calafat
Nous avons également tenté de prendre au sérieux les critiques qui ont été adressées au concept de Méditerranée, notamment, dans sa forme singulière héritée de la période coloniale. En pluralisant la Méditerranée, nous voulons souligner que notre synthèse a une dimension kaléidoscopique : elle rend donc compte d’un espace méditerranéen polymorphe en fonction des lieux à partir duquel on fait le choix de l’observer. On ne parle pas de la même Méditerranée selon qu’on l’observe depuis Alger, Carthagène, Marseille ou Le Caire. Cela suppose au demeurant de reconnaître l’existence de points aveugles, de difficultés à aborder l’ensemble de l’espace méditerranéen pour certains sujets car on s’appuie sur une historiographie et des observatoires précis et situés. Le pluriel de notre titre est donc en quelque sorte un pluriel de modestie : une manière de reconnaître qu’il est difficile de saisir en un même mouvement l’histoire d’un ensemble qu’on appellerait la Méditerranée.
Le pluriel de notre titre est en quelque sorte un pluriel de modestie : une manière de reconnaître qu’il est difficile de saisir en un même mouvement l’histoire d’un ensemble qu’on appellerait la Méditerranée.
Guillaume Calafat
À l’époque moderne, les populations qui vivent sur les rives de la Méditerranée se considèrent-elles comme méditerranéennes ? S’il existe, ce sentiment d’appartenance est-il de nature à en surpasser ou à en atténuer d’autres, à commencer par le clivage entre mondes chrétien et islamique ?
On ne rencontre pas dans les sources de l’époque moderne de traces d’un sentiment d’appartenance méditerranéen. Il y a certes différentes formes d’emboîtement des appartenances : à la ville, à l’entité politique dont on relève ou à la religion. Mais il n’y a pas le sentiment d’une appartenance commune à quelque chose qu’on pourrait rapporter à une civilisation méditerranéenne ou à l’existence d’un type méditerranéen, toutes choses qui apparaissent plutôt (et de façon ambiguë) à l’époque contemporaine. La quête de ce qui fait l’unité géographique, anthropologique, ou historique dans cet espace est une question qui va plutôt obséder les militaires et les administrateurs de l’époque coloniale, qui vont faire abstraction de l’hétérogénéité spatiale et culturelle. Ce « méditerranéisme », entendu comme une unité plus souvent hypostasiée qu’observée empiriquement, est toujours vivant aujourd’hui. Les chercheurs qui travaillent sur la Méditerranée sont souvent rappelés à l’idée qu’il y aurait un socle commun à l’ensemble des peuples de cet espace. Il faut savoir en déjouer les pièges en rappelant qu’il s’agit d’une construction récente et chargée idéologiquement.
Mathieu Grenet
Il nous faut effectivement nous garder de la tentation de méditerranéiser nos objets. Quand on observe une diaspora par exemple, on a tendance à privilégier des analyses au prisme d’un espace que nous avons naturalisé, la Méditerranée. Ainsi, l’exil des juifs espagnols en 1492 ou les soi-disant « diasporas marchandes » sont loin de se répartir de manière homogène dans l’espace méditerranéen. On va par exemple avoir tendance à séparer les migrations grecque ou arménienne en Méditerranée des mobilités grecque ou arménienne dans d’autres régions du monde, alors qu’il faudrait plutôt tout à la fois les penser de manière globale et tenir compte de leur possible hétérogénéité à l’intérieur même de l’espace méditerranéen. Nous avons donc veillé à chaque fois que c’était nécessaire à dénaturaliser la catégorie.
Le « méditerranéisme », entendu comme une unité plus souvent hypostasiée qu’observée empiriquement, est toujours vivant aujourd’hui. Il faut savoir en déjouer les pièges en rappelant qu’il s’agit d’une construction récente et chargée idéologiquement.
Guillaume Calafat
Vous faites commencer votre enquête en 1492, une date qu’on associe plutôt à l’histoire de l’Atlantique qu’à celle de la Méditerranée. C’est aussi bien sûr celle de la chute de l’émirat de Grenade et de l’expulsion des juifs d’Espagne, mais comme vous venez de le signaler, il s’agit là d’événements dont les répercussions ne se limitent pas aux frontières méditerranéennes. En quoi 1492 constitue-t-elle malgré tout un moment pertinent pour penser l’histoire méditerranéenne ?
La vieille croyance d’un déport du centre du monde de la Méditerranée vers l’Atlantique suite au voyage de Christophe Colomb a depuis longtemps été battue en brèche. Contrairement à une vulgate erronée, Fernand Braudel lui-même montre bien que 1492 n’a pas été synonyme d’un déplacement du centre de gravité économique européen vers l’Atlantique. Loin de les marginaliser, l’argent américain vient ainsi irriguer nombre de marchés méditerranéens : le marché ottoman est ainsi inondé de piastres dites « sévillanes ». À l’échelle méditerranéenne, qui est celle adoptée pour notre ouvrage, 1492 fait surtout écho à la chute de l’émirat de Grenade et à l’expulsion des juifs d’Espagne qui se traduit par un double mouvement d’homogénéisation à marche forcée de la péninsule Ibérique et de dispersion des séfarades qui vont « ibériser » leurs terres d’accueil au Maghreb, au Portugal, dans l’Empire ottoman ou les États italiens.
Pourquoi avoir choisi de terminer votre étude au mitan du XVIIIe siècle ?
Ce choix permettait d’abord de s’affranchir de marqueurs tels que l’expédition d’Égypte ou le moment révolutionnaire des années 1820, qui ont tous une pertinence mais qui obéissent à des dynamiques différentes de celles qui prévalent à l’époque moderne. Le monde méditerranéen des mobilités, des expulsions et du commerce que nous avons voulu mettre en lumière, qui s’organise à la fin du XVe siècle, bascule dans une dynamique différente à partir du milieu du XVIIIe siècle. L’historiographie actuelle insiste par exemple sur l’importance de la guerre de Sept ans, qui n’a pas concerné uniquement le monde colonial mais a eu des répercussions en Méditerranée. De manière générale, on observe, à compter du XVIIIe siècle, une reconfiguration des rapports de force géopolitiques, avec une asymétrie de plus en plus marquée en faveur des puissances de la rive nord. Sur le plan religieux, le processus de confessionnalisation, au travers du rééquilibrage qu’il opère entre l’Église catholique et les Églises de rite oriental, bouleverse également la donne qui prévalait jusqu’alors.
On observe, à compter du XVIIIe siècle, une reconfiguration des rapports de force géopolitiques, avec une asymétrie de plus en plus marquée en faveur des puissances de la rive nord.
Mathieu Grenet
Guillaume Calafat
Les capitulations accordées à la France par l’Empire ottoman en 1740 transforment une grande partie de l’économie marchande méditerranéenne. À partir du milieu du XVIIIe siècle, on observe par ailleurs l’entrée sur la scène méditerranéenne de nouveaux acteurs comme les Scandinaves, les Autrichiens ou les Russes. Des évolutions concomitantes entraînent également un déplacement du centre de gravité de la vie juive vers l’Europe du nord. Autant d’éléments qui nous semblent justifier d’interrompre notre étude vers 1750, à la veille de « l’ère des révolutions » qui, si nous avions voulu l’intégrer à notre propos, nous aurait sans doute obligé à aller au moins jusqu’aux années 1830.
Quel est le statut politique d’un espace maritime comme la Méditerranée à l’époque moderne ? La mer appartient-elle à personne ? À tout le monde ? Y a-t-il des luttes interétatiques pour son appropriation ou au contraire des formes de coopérations internationales en la matière ?
Sur le plan juridique, la Méditerranée est l’un des terrains privilégiés d’un grand débat sur la souveraineté des mers qui se joue à l’époque moderne. Que l’on pense à l’histoire de Venise en Adriatique, de Gênes dans la mer Ligure ou encore aux revendications ottomanes sur la possession des îles de la Méditerranée orientale, on voit que la Méditerranée a été l’enjeu d’importants débats quant à la question de la souveraineté maritime. Bien avant l’époque moderne, il faut prendre en considération le droit romain, le droit byzantin, ainsi que leurs relectures par les jurisconsultes du Moyen Âge.
En pratique, la revendication la plus courante est une revendication de juridiction sur l’espace maritime : le droit d’y dire le droit. On peut dire le droit par la force, par les flottes : les tournées de l’amiral ottoman, le kapudan pacha, ou du capitaine du golfe vénitien, le montrent bien. On peut aussi revendiquer la souveraineté maritime par les juridictions commerciales et la Méditerranée est l’un des terrains d’élaboration privilégiés des manières de tracer des lignes douanières à large rayon, qui permettent de capturer les trafics, de fragmenter l’espace en régions commercialement différenciées. La Méditerranée institue également des ports francs, notamment en Italie : Livourne, Gênes, Messine, Civitavecchia, mais aussi au-delà, par exemple avec Marseille. Enfin, se pose la question de qui dit le droit sur les côtes, sur les rivages et sur les formes de la navigation. Les traités entre États d’Europe occidentale et les provinces ottomanes d’Afrique du nord possèdent des clauses qui définissent les endroits où les captures en mer sont considérées comme légales ou non. On commence ainsi à imaginer des dispositifs pour réguler l’activité corsaire, endémique en Méditerranée, l’adjudication des prises maritimes. On prévoit par exemple que, dans un port neutre, il y ait un intervalle de 24 heures entre le départ de deux navires rivaux. La Méditerranée façonne la neutralité. En interdisant les captures jusqu’à une certaine distance (et cela peut osciller de 5 à 30 milles des côtes), on élabore des dispositifs qui visent à neutraliser un espace maritime, à en faire un espace neutre. Du fait de son caractère morcelé, de sa fragmentation, la Méditerranée est un terrain d’expérimentation de dispositifs variés et complexes visant à dire le droit, la souveraineté mais aussi la neutralité sur les mers.
Les ports sont quant à eux les lieux d’intenses débats sur ce qu’est un navire et la force d’un pavillon : un souverain a-t-il le droit de demander la visite et la fouille d’un navire battant pavillon étranger stationné dans un port relevant de sa souveraineté ? Avec leur pavillon, les navires sont comme des petites villes, des extensions de leur port d’attache. Il y a donc aussi une question de concurrence et de hiérarchies entre des juridictions, des souverainetés plurielles.
Avec leur pavillon, les navires sont comme des petites villes, des extensions de leur port d’attache.
Guillaume Calafat
Vous exprimez dans votre ouvrage une volonté de tenir à distance aussi bien « le refrain binaire et belliqueux de l’incommensurabilité et de la guerre sainte » que « son symétrique lénifiant du creuset des cultures et du cosmopolitisme ». Concrètement, comment l’historien parvient-il à naviguer entre le Charybde du « choc des civilisations » et le Scylla de la « convivencia » ?
Mathieu Grenet
Ces deux visions idéal-typiques de la Méditerranée, qui correspondent à des moments historiographiques assez forts, ne sont pas complètement dénuées de pertinence au regard du discours des sources, qui ont par exemple souvent tendance à relayer une vision antagonique des relations entre Chrétienté et Islam. Il est toutefois indispensable de s’en affranchir au moins pour partie. Aussi bien dans mon travail sur les îles grecques sous domination ottomane, que dans celui de Guillaume sur le commerce en Méditerranée occidentale, on se rend vite compte du caractère aporétique de ces paradigmes. Les travaux de Francesca Trivellato sur le « cosmopolitisme communautaire » permettent précisément de dépasser cette alternative pour théoriser la coexistence en un même espace et un même temps, de deux dynamiques en apparence contradictoires. Car l’institutionnalisation d’une communauté se fait dans une forme de familiarité voire de complicité, mais aussi d’inimitié avec d’autres groupes.
Guillaume Calafat
Le paradigme de l’incommensurabilité et celui de la coexistence ne sont jamais que les deux faces d’une même pièce. Que ce soit pour penser leur affrontement ou leur porosité, tous deux postulent l’existence de blocs civilisationnels cohérents. Ce que nous avons essayé de démontrer, c’est que si l’on part des sources, on a affaire à des ensembles beaucoup plus disparates et morcelés que ces deux grands blocs. On en revient à l’idée d’une Méditerranée kaléidoscopique, faite d’une mosaïque de communautés et de sujétions qui interdit de penser de façon binaire. Lorsqu’on l’observe attentivement, on se rend ainsi compte qu’une conversion, à l’époque moderne, a une double dimension, religieuse et politique, qu’il faut penser et qualifier précisément.
Vous essayez d’appréhender la Méditerranée moderne au prisme des nombreuses mobilités humaines qui l’animent. Celles-ci, par-delà leur diversité, ont souvent en commun d’être collectives, communautaires, plutôt qu’individuelles et singulières.
Le groupe est une forme de protection. Or, le déplacement en Méditerranée est sujet à de nombreux risques. Les administrations et les États sont pour leur part soumis au défi d’identifier les individus par-delà leur groupe d’appartenance, que ce soit pour pouvoir racheter des captifs ou pour retracer l’itinéraire suivi par un pèlerin. L’articulation de la communauté et de l’individu est l’un des enjeux cruciaux des appareils administratifs modernes. Nous envisageons donc à la fois des mobilités massives, qui concernent des dizaines de milliers de personnes (réfugiés juifs, mais aussi morisques, grecs ou dalmates, tsiganes, albanais, etc.), et des expériences plus individuelles (captivité, pèlerinage, mobilité marchande). Il y a par ailleurs dans les sources un biais sociologique : nous disposons d’un grain individuel plutôt pour les couches aisées et lettrées, susceptibles d’avoir laissé des documents, ce qui nous condamne souvent à envisager les couches les plus pauvres au seul prisme du collectif.
Mathieu Grenet
Votre question soulève également la question des ressources narratives dont dispose l’historien. Natalie Zemon Davis, avec son Léon l’Africain, a montré comment la focalisation sur un itinéraire exceptionnel peut permettre de saisir des dynamiques historiques d’ensemble. Cette approche par l’individu a été beaucoup utilisée pour écrire l’histoire de la Méditerranée au prisme de trajectoires particulières. Sans rejeter cette manière de procéder, nous insistons toutefois sur l’importance de penser, au-delà de la simple addition de ces cas particuliers, le collectif, en ce qu’il donne accès à des droits, des garanties, des protections. Si bien que même les cas individuels s’inscrivent dans des dynamiques collectives. Même quand on les voit individuellement, les migrants inscrivent généralement leurs pas dans des chemins qui ont été tracés et parcourus par d’autres avant eux. Les mobilités collectives ne sont donc pas seulement synchroniques, mais peuvent aussi être diachroniques. Un morisque expulsé d’Espagne aura par exemple tendance à utiliser des savoirs migratoires qui font partie d’une sorte de patrimoine communautaire. On lui indique qui contacter pour franchir les Pyrénées, qui aller voir pour trouver une place sur un bateau, etc. On ne peut donc pas opposer front à front le communautaire et l’individuel, précisément car la compréhension de l’individuel suppose de l’inscrire dans un prisme collectif.
Nous insistons sur l’importance de penser, au-delà de la simple addition des cas particuliers, le collectif, en ce qu’il donne accès à des droits, des garanties, des protections.
Mathieu Grenet
Guillaume Calafat
Et il en va de même pour la conversion, qu’on imagine aujourd’hui comme une opération individuelle et intime, mais qui à l’époque moderne était en fait une opération collective qui nécessitait des médiateurs nombreux.
La forte conflictualité qui caractérise la Méditerranée moderne n’a-t-elle pas été un frein aux circulations et aux échanges ?
Le caractère endémique de la guerre en Méditerranée n’est nullement un frein aux échanges. Il en est même plutôt un levier, assez lucratif pour un certain nombre d’intermédiaires spécialisés dans le passage de rives, les échanges d’information ou la protection. Loin de s’exclure, les pratiques conflictuelles et commerciales s’imbriquent. Wolfgang Kaiser a montré comment les conflits, loin de freiner le commerce, pouvaient lui servir de lubrifiant. Ces conflits sont profitables ; ils sont des occasions de commerce. Certains groupes diasporiques (corse, séfarade, arménien) peuvent en tirer profit en naviguant dans les interstices créés par ces frictions. La captivité, dans un parcours biographique de marin ou de marchand, constitue un horizon possible voire fréquent. Mais elle est aussi un moyen de connaître le monde chrétien pour un musulman et vice versa. C’est donc une occasion, certes forcée et brutale, d’accumuler des savoirs et de faciliter les interconnaissances et les échanges transméditerranéens.
Mathieu Grenet
On voit effectivement apparaître dans les récits d’anciens captifs l’argument de la captivité comme argument de compétences : « J’y suis allé, donc je connais ». On peut faire valoir cette expérience de captivité à l’appui d’une candidature à une fonction ou un emploi qui nécessite ce type de connaissances. L’idée que le conflit serait l’ennemi de l’échange, que le doux commerce permettrait la paix perpétuelle, est un héritage des Lumières qu’il convient d’interroger, voire de déconstruire. Dans la Méditerranée moderne, non seulement cela ne se vérifie pas, mais c’est l’inverse qu’on observe, dans la mesure où la guerre alimente le commerce. C’est notamment vrai pour les neutres qui parviennent, dans tous les sens du terme, à naviguer entre des pôles antagoniques pour faire du conflit une ressource.
Quels sont les principaux obstacles, risques et entraves auxquels sont confrontés ceux qui circulent en Méditerranée à l’époque moderne ?
Guillaume Calafat
La tempête, le naufrage et les aléas climatiques, comme les fameux « coups de vents » ou « coups de mer » méditerranéens, demeurent présents, même si un grand nombre de naufrages ont lieu dans les ports et sont donc moins spectaculaires qu’on se l’imagine. Sinon, la capture au cours d’une attaque corsaire et la captivité qui s’ensuit demeurent les principales menaces. Celles-ci ne sont pas des abordages violents et indiscriminés, notamment parce que les captifs font l’objet de rançons et ont donc une valeur qu’il faut préserver. Encore au XVIIIe siècle, les activités corsaires demeurent très présentes, aussi bien du côté des ordres militaro-religieux catholiques (l’ordre de Malte, l’ordre toscan des chevaliers de saint Étienne) qu’en Afrique du nord (dans les provinces ottomanes d’Alger ou de Tripoli) : le corso, cette activité aux confins de la piraterie et du brigandage sous couvert de guerre sainte, demeure une activité lucrative. Il faut également compter avec les tracasseries administratives dans les ports : les visites, la réclamation de droits et de taxes considérés comme abusifs, les réquisitions sont autant d’aléas que redoutent les marins. Il y a bien sûr aussi, comme dans tout voyage à l’époque moderne, le risque d’être dépouillé qu’on retrouve fréquemment dans les récits de pèlerinage.
Mathieu Grenet
L’une des grandes inquiétudes des voyageurs est en effet d’être détroussés et qu’à cette occasion, on leur vole leurs papiers. La crainte n’est pas tant de perdre ses biens, que les documents qui permettent d’attester son identité et donc de voyager. Le risque est de se retrouver dans une espèce de limbe, sans capacité d’avancer ou de reculer puisqu’on n’a plus les moyens d’attester de son identité. C’est d’ailleurs pourquoi on voyage souvent en groupe, car le collectif peut aider à faire valoir ses droits en cas de problème.
La crainte n’est pas tant de perdre ses biens, que les documents qui permettent d’attester son identité et donc de voyager.
Mathieu Grenet
Face à ces périls, y a-t-il des formes de coopération internationale destinées à sécuriser les échanges et les circulations en Méditerranée ? Et qu’en est-il des initiatives privées : peut-on voir dans les ordres religieux spécialisés dans le rachat des captifs chrétiens la préfiguration des ONG qui de nos jours viennent au secours des migrants au large des côtes ?
Guillaume Calafat
De part et d’autre de la Méditerranée, tant dans le monde chrétien (catholique comme protestant) que musulman mais aussi parmi les communautés juives, on voit apparaître, outre des assurances privées, des caisses de solidarité communautaires en vue de pourvoir au rachat des captifs. Cela passe par des quêtes, des aumônes, mais aussi des taxes sur les navires où les marchandises embarquées qui permettent une forme de mutualisation du risque. Il y a par ailleurs effectivement des ordres rédempteurs comme les trinitaires (plutôt pour les Espagnols) ou les mercédaires (pour les Français), mais ils ne sont pas les seuls acteurs des rachats : les États, par l’intermédiaire de leurs consuls, organisent de véritables politiques de rachat et commencent à passer par des intermédiaires spécialisés, surtout des marchands. Dans tous les cas, les personnes rachetées doivent passer par une période de « sas » car si, comme le soulignait Mathieu, la captivité leur confère une compétence, elle est également source de suspicion : on craint que le captif ait été retourné, se soit converti.
Votre travail sur la Méditerranée moderne apporte-t-il, si ce n’est des réponses, du moins des éclairages qui pourraient être utiles pour penser les défis actuels que connaît cette région du monde, que ce soit en termes d’inégalités de développement, de tensions géopolitiques ou de crise environnementale ?
Il est difficile à l’historien de répondre à une telle question. Nous travaillons bien sûr avec ces enjeux, mais nous essayons de les maintenir en partie à distance. Il n’y a aucune fatalité des espaces sur lesquels nous travaillons, mais au contraire, à l’époque moderne, des transformations et des circulations très intenses. C’est d’ailleurs l’une des différences fondamentales avec l’époque actuelle où le glacis frontalier est beaucoup plus visible et imperméable. Là où le monde contemporain irrigue notre recherche, c’est surtout sur les questions que nous posons au passé, à commencer par celle de la mobilité. Nous cherchons une Méditerranée précoloniale pour rendre moins téléologique l’histoire d’un espace dont la rive sud n’était pas prédestinée à passer sous la coupe de la rive nord. Notre livre cherche à rappeler qu’il a existé une Méditerranée plus équilibrée, plus paritaire.
Là où le monde contemporain irrigue notre recherche, c’est surtout sur les questions que nous posons au passé, à commencer par celle de la mobilité.
Guillaume Calafat
Mathieu Grenet
Nous avons délibérément fait le choix de ne pas nous arrimer à un « contemporain d’accroche ». Mais il est évident que le passage par l’époque moderne permet d’interroger des évidences contemporaines, par exemple l’idée selon laquelle les mobilités en Méditerranée se déploieraient fatalement dans une seule et même direction. C’est donc une manière non tant de mettre à distance le contemporain que de le réinterroger à partir d’une connaissance plus fine de l’époque moderne, afin d’éviter par exemple les effets de « naturalisation » des flux migratoires.
Pour terminer, pourriez-vous nous présenter quelques lieux méditerranéens constituant selon vous de bons observatoires des dynamiques à l’œuvre dans la Méditerranée moderne ?
Guillaume Calafat
Le port toscan de Livourne est intéressant du fait de son ambivalence fondamentale qui résume bien celle de l’époque. C’est un port de guerre, de galères, dans lequel on peut voir des musulmans enchaînés, mais c’est aussi un port dans lequel les juifs ne sont pas assignés à un ghetto ou contraints à porter un signe distinctif, un port dans lequel commercent des musulmans libres. Au travers d’un commerce lié à la violence, à la course, à la prédation maritime, Livourne se forge une expérience moderne : une ville nouvelle, un port franc, porteur d’une neutralité originale. On pourrait observer des logiques similaires à propos de Malte qui est à la fois la ville des ordres militaro-religieux et, à une autre échelle, c’est aussi un lieu de cohabitation entre chrétiens et musulmans. Je pense enfin au Capo Passero, au sud-est de la Sicile, un territoire qui est un lieu de naufrages fréquents (de navires chrétiens et musulmans). Ce fut un lieu investi par les Turcs au milieu du XVIe siècle, un espace frontalier, entre le canal de Sicile et la mer Ionienne, qui témoigne de l’expansion considérable de l’Empire ottoman. Au XVIIIe siècle, il devient également le lieu d’un affrontement entre Britanniques et Espagnols pour le contrôle de la Sicile. Ces espaces partagés — on pense également à Lampedusa — sont d’excellents révélateurs des transformations du monde méditerranéen.
Mathieu Grenet
Je pense pour ma part au Mont-Liban, passé sous contrôle de l’Empire ottoman au début du XVIe siècle, et qui présente à l’époque moderne un paysage politique morcelé, dominé par des grandes familles musulmanes, chrétiennes et druzes. Dans cet espace rural et montagneux, la propriété foncière et l’affermage des impôts constituent d’importants vecteurs du pouvoir. Si le sultan conserve la propriété éminente sur ces terres, on observe localement un complexe empilement administratif et confessionnel, les gouverneurs provinciaux ottomans (les pachas) affermant les revenus fiscaux à des émirs druzes puis sunnites, qui eux-mêmes les sous-afferment à certaines des principales familles maronites de la région, dont les représentants les plus éminents portent le titre de « cheikhs ». Installée dans le district du Kesrouan au début du XVIIe siècle, la dynastie maronite des Khazin monopolise rapidement plusieurs charges-clés, qu’elles soient fiscales, civiles ou religieuses, notamment grâce à de nombreuses fondations monastiques. Parallèlement, elle multiplie les rachats de terres et de villages, au service d’une vaste politique de colonisation par des familles maronites venues du nord, au détriment de l’élément chiite. Régulièrement dépeint à l’époque moderne comme un refuge quasi-inexpugnable, le Kesrouan est aussi de plus en plus souvent décrit, au cours du XVIIe siècle, comme le fief particulier des Khazin. Évoluant sous la protection de la puissante dynastie druze des Maan, ils jouent la carte confessionnelle et commerciale pour se concilier les bonnes grâces de Rome et de la France. Protecteurs locaux des premières missions catholiques (capucines puis jésuites) envoyées au Proche-Orient dans le sillage immédiat de la création de la congrégation de Propaganda fide en 1622, les Khazin promeuvent également le développement agricole d’un territoire qui approvisionne en cultures d’exports (soie, coton, céréales, huiles, etc.) les principaux ports de la côte libanais (Saïda, Acre, Beyrouth), au sein d’un marché très lucratif et désormais mondialisé. Signe de l’affermissement de leur position : en 1655, Abu Nawfal al-Khazin est nommé vice-consul de France à Beyrouth, sous l’autorité du consul en poste à Alep, alors le grand carrefour des routes commerciales et caravanières du Proche-Orient ; ses héritiers se transmettent ensuite le titre sur quatre générations, jusqu’au milieu du XVIIIe siècle. Au cours des XVIIe et XVIIIe siècles, c’est notamment à partir du Mont-Liban que se déploie, dans l’Europe entière et même jusqu’aux Amériques, un important ballet de quêteurs « orientaux », qu’ils soient prélats maronites, moines melkites ou « princes libanais ». Parfois accusés de vivre aux crochets de la solidarité catholique, ces personnages sillonnent l’Europe, de Paris à Vienne en passant par Naples, Bruxelles, Madrid et bien sûr Rome, sollicitant des secours pour les Églises chrétiennes d’Orient et la lutte contre les « Turcs ». Leurs mobilités comme leurs activités cristallisent l’attention croissante des autorités européennes dans la première moitié du XVIIIe siècle, dans un double contexte de multiplication de ces campagnes de quête et de durcissement des mesures contre les quêteurs et autres vagabonds.

