Sabrina Janesch, Sibir, Rowohlt, 2023
Sibir est un roman européen de grand chemin et de grande envergure. À travers la voix de sa narratrice, Leila, qui tente d’arracher à l’oubli les souvenirs d’enfance de son vieux père atteint de démence sénile, ce récit fouille l’histoire d’une famille ballottée par les vicissitudes de la Seconde Guerre mondiale entre la Galicie, le Wartheland, le Kazakhstan et la Lande de Lunebourg, au nord de l’Allemagne.

Cette exploration romanesque d’un volet largement ignoré des relations germano-russes exhume un passé qui flotte entre les langues, les appartenances et les territoires. Ce faisant, elle interroge ce qui constitue une identité familiale meurtrie par les haines raciales et xénophobes, déchirée par le traumatisme des violences issues de la Seconde Guerre mondiale, des déportations et déracinements multiples.
Mina Hava, Für Seka (Pour Seka), Suhrkamp, 2023

Dans son premier roman, Pour Séka, la jeune auteure d’origine bosniaque Mina Hava écrit un grand récit sur la guerre de Bosnie, la vie de travailleurs immigrés yougoslaves en Suisse et le désir d’inscrire son propre destin dans la grande Histoire afin d’y trouver un sens et sa place.
Depuis quelques années, les romans sur les guerres récentes, sur l’exil et les difficultés de reconstruire sa vie loin de son foyer sont nombreux dans la littérature germanophone et beaucoup sont écrits – à partir d’expériences autobiographiques – par des jeunes femmes : Nino Haratischwilli, Ronya Othmann, Olga Grjasnowa, pour ne citer qu’elles.
Mina Hava, 25 ans, née en Suisse et issue d’une famille bosniaque aborde toutefois ces thèmes de façon neuve et déroutante. Son roman traduit le désir de recoller les morceaux d’une vie brisée grâce à l’écriture et d’y redonner un sens en l’inscrivant dans un contexte qui dépasse le destin individuel. Une douloureuse quête à laquelle le lecteur participe de manière active, dans un récit à la forme éclatée qui l’oblige à rassembler les différents fragments pour y trouver une cohérence, une histoire à laquelle il peut s’attacher, à la manière d’un exilé qui doit retrouver ses marques.
Carolina Schutti, Meeresbrise (Brise marine), Droschl, 2023

« Comment se libère-t-on d’un mensonge ? » Meeresbrise, dernier roman de l’écrivaine autrichienne Carolina Schutti, est l’histoire enchanteresse d’un désenchantement. Une jeune narratrice s’éveille peu à peu de la fiction à la fois merveilleuse et malheureuse dans laquelle elle a grandi et fait l’épreuve de son « entrée dans le monde ».
Une mère élève seule ses deux filles dans un village à la fin des années 1980. Depuis que le père de l’une est parti, et que celui de l’autre s’est jeté d’un pont, la mère vit d’aides sociales, de téléphone rose et de la revente d’articles de seconde main. Les filles sont bercées des contes de fées que la mère leur lit ou invente, créant un monde dans lequel elle est reine et ses filles deux princesses, où l’argent lui vient d’un roi. Les riches vêtements dont elle les affuble ne sont que des affaires d’occasion dépareillées, jamais à leur taille, l’allure digne qu’elle leur demande d’arborer doit déjouer tout sentiment de honte. Elles enrichissent ce monde fictif en rivalisant d’imagination, d’idées de jeux et d’histoires qui métamorphosent le monde vide et pauvre dans lequel elles grandissent avec bonheur, sans avoir la moindre conscience du désespoir qu’il représente. Et quand celui-ci transparaît au gré d’un récit de la mère sur l’un des deux pères, il est vite chassé : « pour la prochaine fois, on voudrait un conte de fées ».
Avec Meeresbrise, Carolina Schutti signe un roman à la fois beau, subtil et d’une grande rigueur formelle. Le pouvoir enchanteur des mots trompe et détrompe, il crée un monde protecteur et en révèle la vulnérabilité, mais l’essentiel réside en ceci qu’il appelle à inventer toujours.
Ulrike Draesner, Die Verwandelten, Penguin Verlag, février 2023

« Je suis celle qui raconte cette histoire. Elle ressemble à un gant retourné. Quelqu’un a dû l’enlever dans la précipitation, peut-être en fuite. Il gît sur la neige, à l’envers. » Troisième volet d’un cycle de romans sur la guerre, la fuite et les déplacements forcés, Die Verwandelten (Les Métamorphosées) de l’écrivaine allemande Ulrike Draesner fait entendre des voix de femmes captivantes à travers trois générations, toutes liées les unes aux autres par les violences du 20e siècle.
Suivant le principe selon lequel « quand quelqu’un parle, la lumière se fait », le récit est pris en charge par plusieurs voix de femmes à différentes époques de leurs vies. Chaque chapitre relate un pan de cette histoire familiale, dévoile une nouvelle perspective, chacun venant compléter le récit à sa façon, tant que faire se peut. Car, si chaque prise de parole apporte un peu de lumière, chacune d’entre elle est aussi une source d’interrogations nouvelles. Entraîné d’une époque à une autre et dans d’incessants va-et-vient entre l’Allemagne et la Pologne, le lecteur se doit de reconstituer ces histoires de mères et de filles, autant de destins contrariés par les aléas de l’Histoire.
Sous la plume de Ulrike Draesner, la langue peut se faire douleur, étouffement, deuil. La langue est malmenée, elle est symptôme d’un mal profond, mais elle peut se révéler aussi garante de souvenirs enfouis. C’est ce que traduisent les poèmes qui introduisent la plupart des chapitres, des poèmes intitulés « chant des femmes abusées » ou « chant des enfants abusées ». Ils rappellent les chœurs des tragédies grecs et, d’un point de vue formel, suggèrent avec leurs phrases entrecoupées, leurs mots parfois rayés, superposés, effacés ou disparus ainsi que leurs lignes blanches, autant de palimpsestes. Présence absente des souvenirs dans la langue, ils figurent les limites du dicible.
Lisa Roy, Keine gute Geschichte, Rowohlt, avril 2023

Après douze ans passés dans une agence d’influenceurs à Düsseldorf suivies d’un séjour en hôpital psychiatrique, Arielle Freytag retourne à contre-cœur dans son quartier de Essen dans la Ruhr, chez la grand-mère qui l’a élevée. Elle renoue alors avec sa vie d’avant, celle de classes sociales basses, un environnement sans pitié dans lequel elle n’a oublié aucun code, ni perdu aucun réflexe. Mais, plus que la plongée dans une classe sociale déterminée, il s’agit dans le roman principalement d’aborder le sujet de la disparition : la disparition de deux petites filles renvoie le personnage à celle de sa propre mère lorsqu’elle avait six ans. Affrontant tant de questions sans réponse, la narratrice s’adresse à un « tu », dont on comprend peu à peu qu’il s’agit de sa propre mère. C’est ainsi l’intimité d’une relation mère-fille fantasmée qui se donne à voir, tout comme la quête d’un nouvel équilibre.
Dans ce premier roman, l’écrivaine allemande Lisa Roy trouve un ton juste et se joue des clichés, quitte à malmener ses personnages. Personne n’est ni bon, ni mauvais, chacun s’en sortant comme il peut, parfois au risque de sombrer dans le pire.
Theresa Pleitner, Über den Fluss (De l’autre côté du fleuve), Fischer, 2023
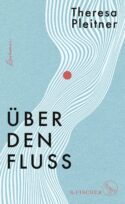
De l’autre côté du fleuve se trouve un centre d’hébergement provisoire pour réfugiés. C’est la périphérie, seuls y vivent ceux que l’on appelle cyniquement « les hôtes ». Une jeune psychologue récemment recrutée découvre cet univers à part et son (dys)fonctionnement. Interloquée par le système mis en place, où raison et folie se confondent et où la violence devient une fatalité, elle en vient très vite à s’interroger sur le bien-fondé de sa présence auprès des réfugiés. Que faire face à des situations désespérées et, surtout, comment savoir encore ce qui est juste et injuste dans un environnement qui vous dicte la réponse ?
Theresa Pleitner écrit ce premier roman sans pathos, observant des personnages dépassés par leur destin ou par le rôle qui leur incombe. Traverser le fleuve, avec la dimension symbolique et mythique que cela implique, s’avère pour la narratrice une véritable mise à l’épreuve. Il lui faudra apprendre, au terme d’un événement tragique, que la meilleure façon d’aider n’est pas nécessairement celle que l’on croit.
Ivna Žic, Wahrscheinliche Herkünfte (Vraisemblables origines), Matthes & Seitz, 2023

Savoir d’où l’on vient, c’est le questionnement qui sous-tend l’ouvrage Wahrscheinliche Herkünfte de l’écrivaine suisse et croate Ivna Žic. Dans ce recueil de textes tantôt narratifs, tantôt essayistiques, qui sont autant de réflexions autofictionnelles, Ivna Žic interroge son passé familial. Et ce au premier sens du terme, car elle n’a de cesse de formuler des questions qui en engendrent d’autres à leur tour : sur son identité plurielle, les différentes langues qu’elle porte en elle, sur les destins si différents de ses grands-parents marqués par les guerres et les conflits nationaux. Ivna Žic cherche les mots justes pour penser enfin les lacunes de son histoire familiale, ce silence laissé par les générations précédentes. Ce faisant, elle propose une réflexion fine sur la responsabilité de la langue et de la littérature.
Birgit Birnbacher Wovon wir leben (Ce qui nous fait vivre), Münich, Hanser, 2023

Qu’est-ce qui est essentiel dans une vie ? Comment faire face à la maladie, au chômage et à l’individualisme ambiant ? Et comment les femmes peuvent-elles s’émanciper davantage ? Telles sont les questions existentielles qu’aborde la jeune Autrichienne Birgit Birnbacher dans son troisième roman, salué unanimement par la presse germanophone.
« Les demi-vérités et les pensées à moitié cuites seront bientôt dissoutes par l’été. Là où il y avait encore des ébauches de solutions, […] là où je nageais encore derrière Oskar en apercevant un bout de sa tête arrière, il plonge maintenant devant moi et met longtemps à remonter. La chaleur s’insinue dans les maisons par les prairies marécageuses du lac, les libellules se tiennent au-dessus des roseaux, l’horloge s’arrête. […] La chaleur étouffe toutes les questions. »
Ignacio Martínez de Pisón, Castillos de fuego, Seix Barral, février 2023

Un grand roman, ample et profond, sur le premier après-guerre de l’Espagne, de 1939 à 1945. Castillos de fuego n’est pas seulement une magnifique fresque sur une époque terrible et violente ; le récit confronte ses personnages à des dilemmes qui se transmettent ensuite aux lecteurs, et dont la portée dépasse largement l’époque de l’intrigue. Ce livre important est porté par un souffle digne de Zola ou de Galdós.
Madrid, 1939-1945. Nombreux sont ceux qui luttent pour s’en sortir dans une ville marquée par la faim, la misère et l’estraperlo. Comme Eloy, un jeune infirme qui tente de sauver son frère emprisonné de la peine de mort ; Alicia, une guichetière de cinéma qui perd son emploi pour avoir suivi son cœur ; Basilio, un professeur d’université confronté à un processus d’épuration ; le falangiste Matías, qui fait du trafic d’objets confisqués, ou Valentín, capable de toutes les bassesses pour purger son ancien militantisme. Couturières, étudiants, policiers : la vie de gens ordinaires dans des temps extraordinaires.
Castillos de fuego est un roman qui contient plus de vérité que bien des livres d’histoire et transmet le pouls d’une époque où la peur a presque balayé l’espoir qui s’est naturellement frayé un chemin à travers la dévastation. Une époque de reconstruction où la guerre n’a pris fin que pour certains, mais où personne n’est à l’abri, ni ceux qui se sont levés aux pieds du dictateur, ni ceux qui ont lutté pour le renverser.
Ignacio Martínez de Pisón revient avec un roman choral ambitieux dans lequel il mêle un cadre historique superbe et bien documenté à l’évolution fascinante d’une poignée de personnages inoubliables, point culminant d’une grande carrière littéraire jalonnée par des livres aussi célébrés par la critique et le public que La buena reputación, El día de mañana et Dientes de leche.
Julio José Ordovás, Castigado sin dibujos, Xordica, février 2023

« Être écrivain, c’est être détective. Et ce livre que je voudrais vous mettre entre les mains pour que vous le lisiez quand tout le monde dort, bien au chaud dans votre lit, sous les couvertures, avec votre petite lampe torche, est un roman d’aventures dont vous êtes le personnage principal. Un petit héros, certes, mais un héros quand même. Je pense que c’est le plus beau cadeau que je puisse vous faire, ne croyez-vous pas ? »
Julio José Ordovás (né à Saragosse en 1976) a déclaré vouloir écrire un livre sur l’Espagne et sa génération, dans laquelle les bandes dessinées ont joué le même rôle que les chansons pour Manuel Vázquez Montalbán. Castigado sin dibujos en est le résultat : des souvenirs de jeunesse dans un village de l’Espagne intérieure où l’adulte se souvient de l’enfant qu’il était, raconte le village où il a grandi et les personnages qui ont peuplé ses journées. Dans le village où tout se passe, près de Belchite, les échos de la guerre civile résonnent encore. Le narrateur, né peu après la mort de Franco, est le fils aîné de la famille, qui tient la boulangerie du village – leur travail devant le public les oblige à garder pour eux beaucoup de leurs opinions afin d’être en bons termes avec tout le monde et de ne pas être montrés du doigt. Le monde rural n’est pas étranger à l’ouverture du pays, au désir de changement et à l’arrivée de la démocratie. Le portrait du changement social, l’histoire rurale de la Transition, constitue l’un des piliers du livre. Et il y a aussi les dessins animés, l’arrivée d’un plus grand téléviseur, que le protagoniste ignore parce qu’il a la tête plongée dans les livres, lisant « avec des yeux fiévreux », à la grande horreur de sa mère. (Aloma Rodriguez, Letras libres)
« Ce beau livre qui n’a pas suffisamment attiré l’attention est un roman d’apprentissage qui se déroule dans un village aragonais marqué la mémoire de la guerre dans les années 1980. Un livre sincère, délicat, émouvant. » (Daniel Gascón)
Marta Carnicero, Matrioskas (Poupées russes), Acantilado, février 2023

Hana vit un double exil : un exil strictement géographique, loin de la terre où elle est née et qu’elle a dû quitter, et un exil intime, qui la tient à l’écart du monde qui l’entoure par peur d’être blessée. À deux mille kilomètres de là, dans un environnement privilégié, Sara, qui vient d’avoir dix-huit ans, a hâte d’être libre.
Confrontées à une réalité inconfortable, fruit de décisions passées qui se répercutent encore dans le présent, toutes deux feront des découvertes aussi amères que surprenantes en franchissant la distance qui les sépare.
« J’aime Marta Carnicero parce qu’elle va plus loin, et là où elle va, elle est brutale. Elle relie la sombre douleur de l’intime – tant de femmes déchirées par la violence qui leur est infligée – à ce qui est plus sombre encore et qui est dissimulé dans l’espace public. Matrioskas, le grand roman européen de cette année, dénonce, avec une dureté et une précision narrative extraordinaires, la façon dont on considère encore comme allant de soi que les femmes soient violées et exécutées pendant les conflits, comme s’il s’agissait d’un fait inhérent à la guerre. » (Enrique Vila-Matas)
Karina Sainz Borgo, La isla del doctor Schubert, Lumen, mars 2023
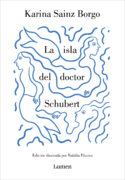
« Schubert : une créature peinte à l’huile sur cuivre, un homme qui éveille la soif chez ceux qui le regardent, un personnage de la poitrine duquel part le kilomètre zéro d’une île que l’interprète a entrepris de raconter, même s’il ne reste de cette tentative que cette poignée de sel. Bienvenue sur l’île du Docteur Schubert. »
Dans cette histoire nourrie par une imagination débordante et d’une grande beauté, Karina Sainz Borgo mêle la réalité au fantastique et au mythe pour créer, avec une prose très soignée et poétique, un nouveau monde centré sur une île imaginaire habitée par le docteur Schubert, mi-médecin, mi-aventurier. Cette histoire, accompagnée des illustrations de Natàlia Pàmies, renvoie aux grands livres d’aventure et de fantaisie de tous les temps, de l’Odyssée d’Homère à L’Île du docteur Moreau de H. G. Wells (auquel le titre rend hommage), en passant par L’Île au trésor de Stevenson ou les récits les plus célèbres de Jack London et d’Emilio Salgari.
« Une inventivité sans limite dans le jeu de la transgression surréaliste. […] À la base de son récit, Karina Sainz Borgo a une idée précieuse, la construction d’une fable mythique visionnaire avec une dose d’aventures et de récits légendaires magiques qui montrent comment le chaos et la violence menacent un monde idéal. » Santos Sanz Villanueva
Mattia Filice, Mécano, P.O.L., 2023

« J’ai, d’une certaine manière, tenté de dresser le portrait d’un héros d’une mythologie qu’il nous reste encore à écrire », explique l’auteur de ce premier roman, rédigé à la fois en prose et en vers. Le narrateur pénètre, presque par hasard, dans un monde qu’il méconnaît, le monde ferroviaire.
Nous le suivons dans un véritable parcours initiatique : une formation pour devenir « mécano », conducteur de train. Il fait la découverte du train progressivement, de l’intérieur, dans les entrailles de la machine jusqu’à la tête, la cabine de pilotage. C’est un monde technique et poétique, avec ses lois et ses codes, sa langue, ses épreuves et ses prouesses souvent anonymes, ses compagnons et ses traîtres, ses dangers. On roule à deux cents kilomètres à l’heure, avec la peur de commettre une erreur, mais aussi avec un sentiment d’évasion, de légèreté, sous l’emprise de centaines de tonnes.
Le roman de Mattia Filice épouse le rythme et le paysage ferroviaires, transmute l’univers industriel du train, des machines et des gares en prouesse romanesque, dans une écriture détournée, qui emprunte autant à la langue technique qu’à la poésie épique. Mais c’est aussi un apprentissage social, la découverte du monde du travail, et parfois la rencontre de vies brisées. Un étonnant roman de formation, intime et collectif, où les plans de chemin de fer, les faisceaux des voies, décident de nos mouvements comme de nos destins, où se distinguent et se croisent vers et prose.
François-Henri Désérable, L’Usure d’un monde, Gallimard, mai 2023

Avec L’Usure d’un monde, François-Henri Désérable nous propose une plongée dans l’Iran d’aujourd’hui. Se mettant dans les pas de Nicolas Bouvier (l’auteur du splendide L’Usage du monde en 1963), l’auteur a passé quarante jours au contact des Iraniennes et des Iraniens. L’Usure d’un monde nous donne à voir et à entendre toute la colère et la détermination du peuple iranien, mais aussi à admirer l’éblouissante lumière qui l’habite. Un voyage littéraire, politique et poétique.
« J’ai appris à me méfier de l’effet de loupe. Les images qui nous arrivaient d’Iran pouvaient laisser croire que le pays était à feu et à sang. La vérité, c’est que les manifestations étaient si brèves, si vite réprimées qu’on pouvait tout à fait mener sa vie sans rien en voir. Les Iraniens faisaient du shopping, se promenaient dans les parcs, jouaient au ping-pong et aux échecs. Ils vaquaient à leurs occupations. À Kerman, pendant que, à la sortie du bazar, des manifestants recevaient des coups de matraque, deux rues plus loin, dans un restaurant, on célébrait des fiançailles. Un patio, un palmier, un bassin, des tables autour du bassin, deux familles attablées, une quarantaine de personnes dont la sœur du fiancé. Sa grand-mère portait un tchador, sa mère un hidjab, elle : rien. Ses cheveux bouclés tombaient en mèches châtain clair sur un cache-cœur en laine orange. Les plats défilaient : mastication, manducation, atmosphère empesée des repas sans alcool. Arrive un groupe de musiciens. L’un se met à pincer les cordes de ton târ, un autre à frotter celles d’un tombak, un chanteur à donner de la voix, et la sœur du fiancé à battre la mesure en faisant claquer son pouce et son majeur. Et puis elle frappe dans ses mains. Et puis elle fait claquer son pouce et son majeur. Et puis elle frappe dans ses mains. Les uns et les autres se regardent puis se regardent entre eux, personne encore ne la suit, rien à faire, elle continue à frapper dans ses mains. En République islamique, il est interdit de danser. Elle se lève, et tourne un derviche, lentement d’abord puis de plus en plus vite, un bras déployé vers le ciel elle continue de tourner, plus vite, toujours plus vite, une toupie orange, cheveux au vent parmi le noir des tchadors.
« Il semble qu’il existe dans le cerveau une zone tout à fait spécifique qu’on pourrait appeler la mémoire poétique, et qui enregistre ce qui nous a charmés, ce qui nous a émus, ce qui donne à notre vie sa beauté », a écrit Kundera. Si je ne devais emporter qu’une seule image de l’Iran, la voici.
Florian Préclaire, Le Cavalier de Saumur, Actes Sud

« Des visions me traversent. Vos vies disparues demeurent sous la forme de fragments profondément incrustés sous mon crâne. Depuis l’enfance, la nuit, j’emprunte malgré moi dans mes rêves d’interminables boyaux de mines et de tranchées. Je vais dans des bois sombres, je vois des châteaux écroulés. »
La vie de René-Frantz Préclaire, grand-père maternel du narrateur, est une vie d’éclats. Une suite d’éclats militaires, dont cet officier fut gratifié durant les deux guerres mondiales, qui le virent monter en grade au rythme des débâcles ; l’éclat d’un obus, ensuite, venu se ficher dans son genou en 1917 pour le faire souffrir toute sa vie, rendue boiteuse ; les éclats reconstitués d’une vie de colère, enfin, tels qu’a pu les recueillir le narrateur. S’adressant à ce grand-père qu’il n’a pas connu, il s’appuie sur de rares traces écrites et sur les souvenirs vaporeux de sa propre mère, évoquant une enfance dorée, un quotidien naufragé : « Alors tout aura disparu. Sur un canapé clic-clac dans un trois-pièces en banlieue, elle me dépeindra la Villa Paradis » où le colonel Préclaire et son épouse ont terminé leurs jours.
On ne saura rien des raisons de la chute sociale de cette famille, d’une génération à l’autre, ultime débâcle par-delà laquelle le narrateur, traversé de visions, veut renouer le fil avec son grand-père cavalier. Dans une langue si maîtrisée qu’elle semble parfois un peu corsetée, en adéquation avec le siècle militaire qu’il traverse au galop, Florian Préclaire façonne un étrange et beau premier roman qui flirte avec la mythologie. Il répond, au fond, à ce grand-père qui s’était improvisé sculpteur, pour tenter un autoportrait en centaure, où : « Ses traits mêlés à des traits inconnus composent sans qu’il le sache le visage de son petit-fils. Mon visage. » (Bertrand Leclair, Le Monde)
Silvia Baron Supervielle, La Langue de là-bas, Seuil, avril 2023

Depuis Lautréamont, Laforgue et Supervielle, Montevideo est un berceau important de l’écriture de langue française. Forte de sa grande expérience de traductrice de l’espagnol et de son attachement aux deux rives de l’Atlantique, Silvia Baron Supervielle donne un souffle moderne et européen à une longue tradition littéraire.
« En vérité, dès ma naissance j’ai attrapé l’exil. En premier du pays de ma mère Raquel, l’Uruguay, mais aussi de l’Espagne et de la France, héritées de mes grands-parents. En me remémorant les promenades sur le quai argentin, je ressens la rive de ma mère, et des siens. Les exils là-bas se multipliaient, je ne saurais pas donner un nom à ces sensations qui me retrouvent, non sans mélancolie, et que je reconnais parfaitement.
Aujourd’hui, je contemple la Seine. Je n’aperçois aucun bateau, seulement les sillages des courants qui, après la traversée de l’Atlantique, pénètrent dans l’autre fleuve et entourent les ports de Montevideo et de Buenos Aires. Je ne vois pas d’île dans mon souvenir, rien que le ciel et l’eau.
Hélène Zimmer, Dans la réserve, P.O.L., janvier 2023

Le chantier du mur érigé par la Wild French Réserve (WFR), entre les espèces protégées et le reste du territoire, est achevé. En se confrontant à ce mur, les trois protagonistes du roman, en proie chacun à des bouleversements personnels, racontent trois expériences sensibles de la crise écologique et de la sauvagerie capitaliste. Arnaud, marginal, s’est donné les moyens de vivre la vie qu’il désirait, une vie d’autosuffisance et de solitude. Un avis d’expulsion met brutalement fin à ses rêves. Arnaud ne revient pas en arrière. Il se fond dans le territoire et l’état sauvage. Nassim, journaliste, relate le combat de la résistance écologique, mais quand sa compagne, Solveig, lui annonce qu’elle veut faire un enfant seule alors que grandit son désir de paternité, la nouvelle est une déflagration. À la fin de son service civique, Eva-Lou décide de quitter sa coloc’ pour faire une pause chez sa mère. La tendresse du foyer la maintient dans une posture de post-adolescente avec laquelle elle rompt brutalement en s’engageant comme éco-sentinelle à la WFR. Ce contrat passé avec la société militaire privée la pousse à une émancipation vertigineuse. Elle se voit catapultée dans une mission spéciale. Une bête autrement plus sauvage que les bisons et les loups a franchi le mur.
Dans la réserve est un roman sur le capitalisme vert, la militarisation des espaces naturels et la résistance écologique. Projection fictive des conditions d’émergence de la privatisation de la nature, s’inspirant de différents modèles de gestion des réserves naturelles existants, le livre nous confronte aux questions sociales actuelles : la paternité, la propriété, le partage des ressources, la précarité salariale.
« Dans cette économie hyper charnelle, qui logiquement s’épanouit dans des dénouements amoureux assez jouissifs, la fable politique sur les hommes et le vivant trouve finalement, par détours, une vigueur particulière » (Lucile Commeaux, France Culture)
Philippe Mouche, Bons baisers d’Europe, Actes Sud, 2023

« On n’a jamais vu l’adjoint manifester un amour passionné pour son pays. On sait seulement qu’il y est né et qu’il y a grandi, qu’il s’est retrouvé physiquement lié à un endroit du monde doté d’une langue aux sonorité métalliques, d’une histoire alternant le sanglant et le grotesque, d’un drapeau à la laideur audacieuse et de frontières dont le tracé fait penser à un oiseau en train de se défendre contre l’attaque d’un prédateur.
Pour autant, se figurer l’adjoint comme un imbécile serait une erreur. Ses goûts témoignent d’un indéniable éclectisme et d’un certain raffinement, surtout quand il est question de pêche à la mouche, de cinéma coréen, de basket-ball professionnel ou de sous-vêtements féminins. Mais pour lui, l’idée d’être considéré un jour comme un traître à la patrie n’est pas supportable, de sorte qu’elle ne peut pas être formulée. S’il n’envisage pas une seconde de rejeter une mission qu’il sait dangereuse pour lui-même, ce n’est pas par défaut d’intelligence, c’est par manque de vocabulaire.
Le revoici dans la sinistre pièce sans fenêtre, tragiquement privé de libre arbitre, se tortillant dans son fauteuil à la recherche d’une raison de se réjouir. Pas sûr que la promotion évoquée par le Délégué soit autre chose qu’un de ces arrangements de façade dont le service est coutumier. D’un autre côté, c’est lui qu’on aura choisi pour diriger l’opération qui débarrassera ce continent d’un des pires ennemis du peuple. Il pourrait au moins en éprouver une sorte de fierté personnelle. Intime.
Mais la politique ne l’a jamais intéressé, et l’Europe non plus. »
Philippe Mouche signe un roman d’espionnage extravagant, d’une acuité mordante, et qui, à sa façon, esquisse le nouveau récit tant attendu sur l’Europe. Une Europe au verbe haut, qui assume joyeusement sa part d’utopie.
Daniele Rielli, Il Fuoco invisibile (Le Feu invisible), Rizzoli, mars 2023

Peut-on raconter un drame écologique et social comme s’il s’agissait d’un roman rapide et à plusieurs voix ? C’est ce que fait Daniele Rielli dans ce livre où, en essayant de comprendre ce qui tue les oliviers de sa famille, il reconstitue les événements liés à l’arrivée dans les Pouilles de la Xylella, une bactérie à l’origine de la pire épidémie végétale au monde.Tout commence à Gallipoli, lorsque les oliviers commencent à se dessécher et à mourir comme jamais auparavant. Un maelström d’événements se met en branle et s’accélère jusqu’à devenir irrésistible.
L’olivier, arbre symbolique de la civilisation méditerranéenne, est considéré comme immortel, les places se remplissent de manifestants qui protestent contre les mesures d’endiguement, la justice met en accusation les scientifiques qui ont découvert la maladie : c’est la tempête parfaite. Aujourd’hui, au moins 21 millions d’oliviers – dont de nombreux arbres centenaires et millénaires, un patrimoine irremplaçable – sont morts ; c’est comme si toute la province de Lecce avait été brûlée par un gigantesque incendie invisible. Daniele Rielli suit cette affaire depuis le début, pendant des années il parle avec les scientifiques qui étudient la bactérie, rencontre les négationnistes qui ne croient pas à la maladie, écoute les agriculteurs et les mouliniers qui tentent de sauver leurs exploitations, étudie des documents, interroge des personnes et parcourt des milliers de kilomètres à l’intérieur d’une région qui, de paradis terrestre, devient un gigantesque cimetière végétal, perdant ainsi son identité la plus profonde.
Au cours de ce long voyage, Rielli enquête sur l’ancien lien avec les oliviers de sa famille, découvre les secrets de l’industrie pétrolière, réfléchit aux aspects les plus paradoxaux de notre relation avec la nature et à l’énorme pouvoir des histoires. Invisible Fire est à la fois un roman familial et le récit d’un procès des sorcières de Salem à l’ère des médias sociaux.
« Un des plus beaux romans de l’année. » (Antonio Pascale, Il Foglio)
« Il Fuoco invisibile n’est pas un essai mais un roman du réel. » (Chiara Severgnini, Corriere della sera)
Marco Missiroli, Avere tutto (Tout avoir), Einaudi, 2022

Les mouettes de Rimini ne crient jamais. Pas à n’importe quelle saison de l’année, pas même lorsque Sandro rentre chez lui après avoir vécu à Milan et qu’il trouve son père de plus en plus dur. Pas même lorsque les mois passent et qu’il se rend compte qu’il est resté avec lui pour affronter leur plus grand jeu, un vieux jeu : où aimerais-tu être avec un million d’euros de plus et quelques années de moins ? Jeune homme, Nando Pagliarani avait un torse de nageur et un destin brisé. Il a travaillé dans des bus de tourisme, a été cheminot, a été propriétaire du bar America, mais la seule mention qui devrait figurer sur sa carte d’identité est : danseur. Car lui et sa femme ont dansé comme des diables, dans toutes les compétitions de la Riviera romagnole. Ils dansaient pour gagner. Sandro aussi aime gagner, c’est de famille. Mais sa danse est dangereuse. Les premières fois à la table de jeu, il était le gars à plumer, puis il est devenu le barbu à surveiller. Ce qui est sûr, c’est qu’avant, il avait un travail stable et un projet d’avenir avec Giulia. Et maintenant ? Que reste-t-il à Sandro, qui voulait tout avoir ? Que reste-t-il à chacun d’entre nous, chaque fois que nous tentons notre chance ? Marco Missiroli signe son roman le plus puissant et le plus mûr, racontant la fièvre d’un jeune homme plein d’élans et de défauts, d’une ville de province qui ne vit en grand qu’une saison par an, d’une famille brûlée par l’amour et l’empressement.
Marco Missiroli signe un roman sur la perte et le manque, deux situations dans lesquelles les traits vivants des choses se montrent, deux conditions que nous sommes obligés de traverser, de creuser, dans la dispersion dans laquelle nous vivons. C’est donc un récit sur la recherche de ce qui est important à une époque où tout semble l’être, où la multiplication des sollicitations semble avoir annulé notre capacité à choisir, avilissant la valeur des choses et brouillant la frontière du superflu et du nécessaire. Après la mort de leur mère, cœur battant de leur famille, un père et un fils font face à leurs excès respectifs : ils se rencontrent, ils s’affrontent, ils se protègent. C’est un roman sur les hommes, aussi, sur une masculinité qui tente de se définir en vivant avec la perte et dans le vide fécond ouvert par le renoncement à la séduction, à la vengeance, au jeu, au rêve de « tout avoir ».
Avere tutto est enfin un livre remarquable et émouvant à propos d’un lieu précis, Rimini, et sur le retour à ce lieu précis. C’est un roman radical, parce que le radical est ce qui s’accommode des racines
Maddalena Vaglio Tanet, Tornare dal bosco, Marsilio, 2022

Dans une petite ville de montagne au milieu du tourment politique des années de plomb, une institutrice décide un matin de quitter sa maison sans se rendre à l’école. En cause, le suicide d’un de ses élèves. Le pays craint la contagion d’une violence trop humaine, jamais éteinte, une violence qui, après deux guerres mondiales, s’est transformée en guerre civile et politique. Tornare dal bosco, candidat au Prix Strega 2023, se distingue par son intrigue captivante et sa capacité à mêler différents genres narratifs.
La forêt est la forêt, la montagne est la montagne, le village est le village, et l’institutrice Silvia est l’institutrice Silvia, mais elle a disparu. Dans une petite communauté agitée par le vent de l’Histoire qui balaie l’Italie au début des années 1970, Silvia, l’institutrice, quitte la maison un matin et, au lieu d’aller à l’école, s’enfonce dans les bois. Le motif, ou peut-être le motif, est la mort d’un de ses élèves. Pas la mort : le suicide. La communauté la cherche, mais craint qu’il ne soit trop tard pour la retrouver ou la sauver, et ces deux morts sont en quelque sorte une malédiction. Le village est montagneux, et les peurs et les sentiments, s’ils ne peuvent être niés, ne peuvent même pas être nommés.
Le village craint la contagion d’une violence trop humaine et jamais endormie, une violence qui, après deux guerres mondiales, s’est transformée en guerre civile et politique. L’instituteur est introuvable et le pays, pour continuer à vivre dans le chagrin et l’incertitude, se laisse distraire. Dans cette distraction, Martino, l’enfant qui n’est pas né au village et qui n’a pas été accueilli, en coupant à travers les bois, croise une cabane abandonnée, et dans la cabane, de la couleur de la moisissure et dorée comme un chapeau de champignon, se trouve l’institutrice. L’enfant ne dit pas qu’il l’a trouvée et l’institutrice ne parle pas.
Mais l’enfant revient et la maîtresse, après tout, l’attend. À partir de faits réels et de récits familiaux, d’articles de journaux, de ouï-dire et de mythologie, Maddalena Vaglio Tanet raconte une histoire de possibilités et de fantômes, d’êtres vivants qui tombent sur des événements plus grands qu’eux, et d’enfants dont – comme l’écrivait Simona Vinci dans son premier livre – on ne sait rien, si ce n’est qu’ils sont les seuls à savoir combien de réalité il y a dans les contes de fées, combien d’amour se cache dans la peur, et combien de surprises restent tapies dans les bois.
Małgorzata Boryczka, Nigdzie (Nulle part), Nisza, Varsovie, 2023

Le premier roman de Małgorzata Boryczka, comme son premier livre – un recueil de nouvelles intitulé Sur les perspectives de développement des petites villes (2022) – relève du réalisme magique. La protagoniste mène une enquête privée : lorsqu’elle était enfant, son grand-père, qui l’a élevée seul, fabriquait des pinceaux avec ses cheveux et les vendait à des artistes locaux. Devenue adulte, elle retourne dans sa ville natale pour retrouver les tableaux peints avec ses cheveux. Nulle part est un roman qui explore la relation entre l’identité et la mémoire, racontant l’histoire d’une femme qui tente désespérément de se retrouver et de comprendre son passé.
Maciej Hen, Segretario (Secrétaire), Wydawnictwo Literackie, Cracovie ; 2023

Le roman épistolaire de Maciej Hen se déroule dans la Cracovie du XVe siècle. Gredechin Specht, née à Heidelberg, à l’âge de 14 ans, décide de réaliser ses rêves et d’approfondir ses connaissances en partant à la découverte du monde sous le déguisement de Georg Starkfaust. Elle trouve sa place à Cracovie, où elle est accueillie par Filip Kallimach, poète italien, éminent conseiller du roi de Pologne Casimir Jagellon, et devient étudiant.e en médecine à l’Académie de Cracovie. Gredechin confie régulièrement à son amie d’enfance, Enneleyn, ses secrets et lui raconte les problèmes de la vie quotidienne en habits d’homme. Une histoire passionnante sur le dépassement des frontières de la langue, des classes et des sexes, qui joue avec la version officielle de l’histoire.
Zyta Rudzka, Ten się śmieje, kto ma zęby (Rira bien qui aura encore des dents), WAB

Zyta Rudzka (1964) n’est pas une débutante : Rira bien qui aura encore des dents est son dixième roman. Elle a aussi à son compte plusieurs pièces de théâtre et c’est sans doute cette veine de dramaturge qui donne à sa prose une voix unique et inimitable.
L’héroïne du roman, Wera, ancienne patronne du « Salon de coiffure masculin Wera », nous raconte son « odyssée de misère » lorsqu’à la mort de son mari, elle cherche à vendre les derniers menus objets qui lui restent de sa vie d’avant pour pouvoir chasser son défunt mari et lui offrir des obsèques convenables. Elle qui a tout perdu, victime de violences, sans ressources, vieille et abandonnée de tous, refuse cependant de jouer le rôle de la victime. « La vie d’une femme ne se résume pas à être veuve. » Dans un monologue drôle, cru et pourtant rempli de tendresse, elle raconte sa vie, les hommes et les femmes qu’elle a aimés, avec une force inépuisable.
La critique polonaise considère ce livre comme une lecture obligatoire » pour les amateurs de littérature forte et vraie. « Mon héroïne a perdu son amour, son mari, son travail. Elle a vendu ses biens les plus humbles au bazar. Mais Vera est imperturbable. Elle ne célèbre pas la perte. Elle ne veut pas être une veuve ou une victime. Elle aime qui elle veut et vit comme elle l’entend, d’où sa force. Je rencontre sans cesse des femmes comme celles-là – je voulais leur donner une voix. » (Zyta Rudzka)
Katarzyna Michalczak, Synu, jesteś kotem (Mon fils, tu es un chat), Éditions Cyranka, Varsovie, 2023

Comment vivre avec un enfant autiste ? Comment adapter l’amour maternel à ce qui sort de l’ordinaire ? Comment comprendre ce qui échappe à la logique qui est la nôtre ? Telle est la thématique du roman autobiographique de Katarzyna Michalczak.
À la voix de la mère qui décrit la longue et difficile route qui mène la relation mère-fils à travers les obstacles inconnus de ceux qui n’ont jamais eu à faire avec le spectre de l’autisme, se joint de temps à autre, comme en sourdine, celle du fils, lecteur attentif et commentateur du récit maternel. Au-delà d’une histoire familiale intimiste, l’ombre de la fresque humoristique de Soseki Natsume, Je suis un chat (1906), auquel le titre polonais fait l’écho, le roman de Michalczak propose aussi de regarder la société polonaise par le prisme de la différence, une société en transformation, certes, tout comme dans le roman japonais, mais loin d’être prête à accueillir en son sein tous les spectres de l’altérité.


