Sur une idée de Danielle Arbid, cette conversation est la transcription d’un dialogue entre Jonathan Littell et Antoine d’Agata au Centre Pompidou à l’occasion du festival Hors Pistes le 20 janvier 2023, dont le Grand Continent était partenaire.
Poutine va-t-il gagner la guerre ?
Jonathan Littell

Poutine ne gagnera pas la guerre mais, pour reprendre un mot vietnamien : encore faut-il définir ce qu’est une victoire. Dans tous les cas, la victoire que Poutine espérait au début de la guerre n’arrivera jamais. Dès lors, on peut se demander : qu’est ce-que pourrait être une victoire ukrainienne ? Qu’est-ce que pourrait être une défaite russe ? Voilà deux bonnes questions.
Diriez-vous tout de même que la situation s’éclaircit ?
Non, pas pour le moment. Tout dépend du soutien matériel occidental, donc des armes, de la logistique et des tanks qu’ils avaient refusé de promettre jusqu’à récemment. Sans ces armes-là, l’on risque de se retrouver comme durant la Première Guerre mondiale, avec une guerre de tranchées qui va durer des années.
On attend donc qu’il y ait un certain renforcement des capacités ukrainiennes pour leur permettre de reprendre une partie des territoires qu’ils ont perdus en février dernier et pour arriver à une négociation où le rapport de force sera plus équilibré en faveur de l’Ukraine.
Au fil de vos voyages, estimez-vous qu’un changement s’est produit ?
Nous n’avons pas vraiment compté le nombre de nos voyages. J’y suis allé trois fois, Antoine deux, mais nous n’étions pas toujours ensemble. En Occident, tout le monde parle de la guerre comme si elle avait commencé en février.
Du point de vue des Ukrainiens, elle a commencé en 2014 avec l’invasion de la Crimée et du Donbass ; en fait, les Ukrainiens parlent de full scale invasion, ou tentative d’invasion totale de l’Ukraine. En dépit du terme, ils sont déjà en guerre depuis huit ans ; ce n’est donc qu’une amplification de tout ce qui s’est passé auparavant.
Il y avait déjà beaucoup de choses en place pour cette amplification de la guerre. Par exemple, tous les réseaux de volontaires, dont on parle beaucoup dans la presse, qui aident l’armée, font du fundraising et achètent des armes, existent depuis 2014 ; toutes ces structures étaient déjà là.
La société n’a donc pas été prise complètement au dépourvu. En février dernier, les fondements étaient déjà là, à la fois au niveau gouvernemental, au niveau de l’armée — qui aujourd’hui n’a rien à voir avec l’armée qui existait en 2014 — et au niveau de la société civile.
Certes, les gens espéraient le plus fortement possible que cela n’arriverait pas. Le jour où nous sommes arrivés, en janvier 2022, ils plaisantaient sur la tournure de la guerre ; et pourtant, le mois suivant, la moitié sont partis à l’étranger, la moitié se sont engagés dans l’armée ou dans le gouvernement pour se battre. Ce n’était pas une surprise mais quelque chose qui avait été anticipé. Cette anticipation a permis à la société dans son ensemble de réagir collectivement d’une manière forte.
Le jour où nous sommes arrivés, en janvier 2022, ils plaisantaient sur la tournure de la guerre ; et pourtant, le mois suivant, la moitié sont partis à l’étranger, la moitié se sont engagés dans l’armée ou dans le gouvernement pour se battre.
Jonathan Littell
Je dirais qu’il y a une différence entre la société et l’armée ukrainiennes d’une part, et la société et l’armée russes d’autre part : c’est que l’on trouve en Ukraine un effort collectif du pays entier, alors que, du côté russe, le pouvoir fait tout ce qu’il peut pour que le moins de gens soient touchés ; ces derniers essaient du reste de s’en désintéresser le plus possible, et ne s’en soucient que le jour où on prend leur mari ou leur fils pour l’envoyer se faire tuer. Il y a un vrai déséquilibre entre les deux sociétés qui sont en conflit.
Cela renvoie-t-il à ce que vous appelez la verticalité de la société russe et l’horizontalité de la société ukrainienne ?
Cela va beaucoup plus loin que l’état de guerre qui est inscrit dans les fonctionnements plus généraux. Les Ukrainiens, avec la longue tradition d’une société décentralisée, sans pouvoir central fort, sont capables de s’organiser de manière horizontale pour faire face à des défis différents avec des alliances différentes.
C’est un fonctionnement historique de l’Ukraine qui reste très ancré dans les mentalités. En Russie, l’on trouvait alors le tsar et les boyards, soit des nobles qui le sont uniquement par volonté du prince, à l’opposé de la noblesse européenne, qui est une noblesse de terre et de sang.
En Russie, le tsar peut se débarrasser des boyards, prendre leurs terres et les donner à quelqu’un d’autre. Il agissait en cela exactement comme les oligarques d’aujourd’hui, puissants et riches, mais à la discrétion du prince ; tout ce qui est en dessous de ces mêmes oligarques est encore davantage à la discrétion du prince.
Ces traditions historiques — qui remontent très loin, jusqu’à la façon dont les deux sociétés ont émergé de la domination mongole — ont donc contribué à des fonctionnements sociaux et psychologiques différents, qui conditionnent le rapport à la guerre.
Si Poutine mourait demain, est-ce que la guerre s’arrêterait ?
Non. Les choses sont quand même beaucoup plus compliquées que cela. Poutine est un tsar par accident, mais il reste un tsar. Le réflexe, si quelque chose lui arrive, va donc être de le remplacer par un autre. On aura ainsi un conflit très violent entre tous les prétendants pour le remplacer et on ne sait donc pas ce qui va se passer. L’ennui est en effet qu’il n’y a pas de principe de succession en Russie — ce qui la rendra mécaniquement chaotique. Cela peut-il affecter le cours de la guerre ? Il est difficile de le savoir. En revanche, il faut demeurer conscient que la radicalité d’une certaine partie de l’élite et de l’extrême-droite russes est réelle : elle va beaucoup plus loin que Poutine.
On voit en ce moment que Poutine est dépassé en permanence par sa droite ; c’est-à-dire qu’il essaie constamment de freiner les radicaux. J’entends par là tous les individus — et ils sont nombreux — qui se montent la tête avec la propagande et la télévision : les blogueurs de Telegram et tous ceux qui n’arrêtent pas de critiquer, de pousser, de dire l’armée n’en fait pas assez, n’est pas assez violente et ne tue pas assez de gens.
Poutine tient ces gens-là en respect. Mais s’il meurt, ils peuvent se déchaîner : on ne sait alors pas du tout quelle direction la guerre peut prendre.
Poutine est un tsar par accident, mais il reste un tsar. Le réflexe, si quelque chose lui arrive, va donc être de le remplacer par un autre.
Jonathan Littell
Comment travaillez-vous lorsque vous vous rendez en Ukraine ? Que décidez-vous le matin : d’aller dans un endroit précis ou de vous disperser ?
Antoine d’Agata

Ma position est relativement confortable, car Jonathan parle le russe, qui est couramment utilisé en Ukraine, et il connaît bien l’histoire et la réalité de la société ukrainienne.
Je me repose beaucoup sur cette connaissance. Elle me donne un espace de liberté, mais aussi un sentiment d’impuissance absolue : celui de de débarquer dans un endroit où les enjeux sont si élevés et violents qu’ils tranchent de manière nette sur ma situation habituelle — je suis de fait tout le temps en train d’essayer d’attraper des petites choses qui peuvent, d’une manière ou d’une autre, rendre compte d’une certaine réalité. C’est toujours avec beaucoup de frustration et beaucoup d’humilité que je le fais.
Est-ce que le voyage jusqu’en Ukraine fait aussi partie de cette couverture de la guerre ? Il faut désormais trois jours pour arriver en Ukraine ; il ne fallait que trois heures avant la guerre. Que se passe-t-il durant ces trois jours ?
Jonathan Littell
Notre voyage a pris trois jours car nous ne nous sommes pas très bien débrouillés, mais il peut tout de même être plus court. Nous avons fait un voyage ensemble en mai dernier mais Antoine était venu tout seul avant moi, en mars. Je suis revenu en septembre et en octobre sans lui – cela dépend.
Avant la guerre, on se retrouvait à Kiev selon les agendas des uns et des autres ; mais il est vrai que c’était plus fluide. Pour répondre à votre question, le voyage de retour en train a pris trois jours avec de longues nuits passées bloqués dans les gares : nous avions le sentiment de traverser à la fois géographiquement et temporellement des bouts d’histoire. Nous traversions l’Ukraine, la Pologne et l’Allemagne, et pas mal d’images qui défilaient ; ce sont des itinéraires chargés d’histoire et de mémoire.
Antoine d’Agata
J’ai un souvenir très vif d’un train de nuit que nous avons pris en mai. J’ai travaillé dans beaucoup de guerres dans ma vie, mais c’est la première fois que je me rendais sur une zone de guerre en train.
Sur les voies ferrées, dans le train de nuit, on entendait un bruit très particulier, celui de l’entrechoquement avec les rails. Cela nous renvoyait quatre-vingts ans en arrière, à l’époque où l’on amenait les soldats au front en train et où toute la logistique était basée sur les trains. Le train est devenu quelque chose de très archaïque par rapport à la guerre, mais il est vrai que cette guerre d’Ukraine est redevenue une guerre de trains. Toute la logistique russe est ferroviaire : les blindés sont acheminés en train, de même que les munitions. Ce n’est pas le cas chez les Américains, qui font tout en avion. Arrivant en train, nous nous retrouvions dans quelque chose d’ancien par rapport à notre histoire contemporaine. C’était très fort et très beau.
Le train est devenu quelque chose de très archaïque par rapport à la guerre, mais il est vrai que cette guerre d’Ukraine est redevenue une guerre de trains.
Antoine D’Agata
Jonathan Littell
Des plastiques recouvraient les vitres du train. Nous avions le sentiment d’être protégés par ce plastique…
Antoine d’Agata
Ils obligent à fermer les stores des wagons, parce qu’ils ne veulent pas que les lumières soient visibles de l’extérieur et les vitres sont recouvertes de scotch en cas d’explosion. C’était comme voyager dans une petite bulle.
Et puis nous arrivions le matin à Kiev. Comme toujours, quand on arrive à Kiev en train, à la gare il y a des taxis : tous les chauffeurs essaient de vous embarquer et de négocier le prix du trajet.
Jonathan Littell
Cette fois-ci, en fond sonore, on entendait les bombardements…
Antoine d’Agata
Lorsque tu y étais en mars, oui. Mais quand je suis arrivé en mai, il n’y en avait pas, c’était tranquille.
Payiez-vous des fixeurs ou des intermédiaires pour arriver jusqu’au front ?
Jonathan Littell
Nous avions un fixeur, mais il n’a pas servi à grand-chose. C’est parce que Le Monde le souhaitait que nous en avons pris un. Ils servent surtout de chauffeurs, mais nous aurions pu conduire nous-mêmes ; d’ailleurs, nous l’avons fait à l’occasion.
Antoine d’Agata
Jonathan est un très bon fixeur !
Jonathan Littell
Un fixeur est souvent quelqu’un qui connaît l’endroit, qui parle la langue et qui conduit ; il est vrai que je peux m’acquitter de ces trois tâches tout seul.

Le fixeur est aussi quelqu’un qui connaît les gens ?
Jonathan Littell
Oui ! Mais j’avais déjà beaucoup de contacts. Quand nous sommes arrivés à Kiev, j’ai mobilisé mes connaissances de la ville, qui m’ont donné d’autres contacts à Kharkiv. J’avais beaucoup plus de contacts que le fixeur — mais il est vrai que nous n’en avions pas choisi un bon… Tous les bons fixeurs travaillent pour le Washington Post, le New York Times et d’autres médias. Il faut dire que les tarifs sont assez délirants. Nous payions notre fixeur entre 200 et 300 euros par jour, même s’il ne savait pas grand-chose ; le New York Times et le Washington Post payaient entre 500 et 700 euros par jour. C’est pour cela qu’ils ont de meilleurs fixeurs.
Vous vous retrouviez tous au même endroit ?
Jonathan Littell
Non, car Kiev est une grande ville ; il n’y a donc pas d’hôtels spécifiques comme cela pouvait être le cas à Sarajevo. Mais, l’on voit les autres correspondants pour échanger des infos ou dîner ensemble. Ceci dit, ce n’est pas la priorité, car de toute façon, nous sommes là pour voir des gens en Ukraine.
Selon le conflit, le nombre de journalistes varie beaucoup. Quand j’étais en Tchétchénie, il y avait au plus 5-6 journalistes sur le terrain, qui venaient de temps en temps. En Bosnie, il y en avait 2000 ; donc cela dépend.
Pour ce qui est de l’Ukraine, nous ne sommes plus dans un conflit à 2000 journalistes. Par exemple, quand Boutcha a été ouverte aux journalistes le 3 avril, les Ukrainiens avaient organisé 18 bus ; je crois qu’il y avait 182 caméramans et photographes, d’après ce qu’on m’a dit.
Il y avait quatre cadavres dans la rue, et donc 182 journalistes qui essayaient de faire des photos et des images de télévision de ces quatre personnes-là. Cela devient compliqué de travailler dans de telles conditions. Par contre en Ukraine, le gouvernement exerce un contrôle extrêmement strict de l’information, pour des raisons de sécurité très évident. Je m’explique : dès lors que quelqu’un prend une photo et la met sur un réseau social, elle est vue de tous. Si l’endroit est localisable et qu’il y a une arme dans la photo, vingt minutes plus tard, un missile peut tomber ; le gouvernement est donc très strict là-dessus. Le moindre journaliste qui poste quelque chose en temps réel peut se faire expulser du pays, et avec raison, parce que c’est dangereux.
Quand Boutcha a été ouverte aux journalistes le 3 avril, les Ukrainiens avaient organisé 18 bus ; je crois qu’il y avait 182 caméramans et photographes, d’après ce qu’on m’a dit.
Jonathan Littell
L’accès à la première ligne du front – que nous n’avons pas connue, nous étions aux arrières – est donc extrêmement difficile. Il faut pour cela être implanté depuis longtemps et connaître en détail des gens ; ou alors, cela prend la forme de visites guidées dans des conditions spécifiques, pour des grands médias comme le New York Times ou le Washington Post.
De temps en temps, les militaires ukrainiens vous font une démonstration, parce qu’il est important d’avoir le soutien américain. Ils vous emmènent donc pour vous montrer comment fonctionnent les HIMARS (lance-missiles) ; mais le tout reste très contrôlé.
Quand l’on est hors des zones de combat, à l’arrière, on travaille très librement. Il n’y a aucune censure, aucune personne qui nous suit et l’on ne nous embête pas. Mais dès qu’on se rapproche des zones de combat, tout devient d’emblée très contrôlé.
Pourquoi aller en Ukraine, plutôt qu’en Syrie ou en Iran ?
Antoine d’Agata
C’est avant tout une histoire de fidélité. Depuis des années, l’Ukraine est une terre et une communauté qui m’a donné des choses ; je lui suis redevable.
Quand la guerre est arrivée, j’avais le sentiment, avant même de faire des images, de rendre d’une certaine manière tout ce qui m’avait été donné, d’être présent, même si c’est pour ne rien faire. Dès les premiers jours de mars, j’ai très peu travaillé, et j’ai surtout passé mon temps avec les gens avec qui j’étais resté.
C’était important d’être là, même si c’était inutile, plutôt que de regarder ce qui se passait de loin. Une fois qu’on est sur place, on essaie d’être le plus pertinent possible, de trouver des manières de rendre compte d’une réalité qu’on partage. Mais il s’agit au départ, d’une histoire de présence et de fidélité, d’attente.
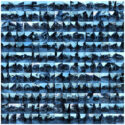
Jonathan Littell
C’est un peu la même chose pour moi. Antoine et moi n’avons pas tout à fait la même histoire, mais je travaille sur des projets en Ukraine depuis 2019, dont un projet de film qui n’a toujours pas abouti.
Avec Antoine, depuis 2021 — juste après le Covid — nous avons commencé un projet qui n’a rien à voir avec la guerre ; c’est un autre projet. Nous travaillions déjà ensemble en Ukraine quand la guerre a commencé, laquelle a d’ailleurs liquidé notre projet ; on a donc cherché à rebondir. C’est aussi un pays où j’ai énormément d’amis. L’année dernière, avant la guerre, je cherchais des appartements à Kiev, parce que je pensais peut-être m’y installer. C’est un endroit qui me plaît beaucoup.
J’avais donc un sentiment très fort de proximité quand la guerre a éclaté. Ce n’était pas comme s’il s’agissait du Yémen ou de la Syrie, où je ne connais personne. Pour moi, c’était moins abstrait : mes amis et des choses beaucoup plus proches étaient impliquées.
Les premiers mois de la guerre, j’étais donc très occupé, avec tous mes proches et mon entourage, à sortir des gens, les loger — ce que tous ceux qui ont des connaissances en Ukraine ont fait, et même énormément de gens qui n’ont pas de connaissances en Ukraine. L’implication est pour moi plus personnelle dans cette guerre-ci que d’autres que j’ai pu couvrir.
J’ai couvert la Syrie, mais je ne parle pas arabe, et je n’y connais personne. Pour moi, c’était un one shot, parce que je n’avais pas d’attaches en Syrie. En Ukraine, j’en ai beaucoup plus.
L’implication est pour moi plus personnelle dans cette guerre-ci que d’autres que j’ai pu couvrir.
Jonathan Littell
Antoine d’Agata
Dans notre histoire commune avec l’Ukraine, ce qui est intéressant, c’est que nous sommes partis là-bas pour travailler sur des moments d’histoire et sur une horreur qui a eu lieu, mais pour laquelle il n’y avait rien à voir. Pendant plusieurs mois, on a travaillé sur des territoires où il n’y avait absolument rien à regarder, rien à voir, parce qu’il ne restait plus aucune trace des horreurs qu’ils ont connus.
Jonathan Littell
Le projet qu’on a fait ensemble a démarré à un endroit qui est aujourd’hui dans la ville de Kiev et qui s’appelait jadis Babi Yar ; beaucoup de gens ne le connaissent pas. C’était un ravin, qui n’existe plus puisqu’il a été comblé après la guerre, où les Allemands ont exécuté à peu près 100 000 personnes pendant les deux ans d’occupation de Kiev : 60 000 juifs et 40 000 autres personnes, dont des soldats soviétiques agents du NKVD, ont été tués là-bas.
D’après leur propre décompte en 1941, les Allemands ont commencé ce massacre vingt jours après la prise de Kiev. Ils ont massacré 33 771 juifs entre le 29 et 30 septembre. Ils ont ensuite utilisé le même endroit pour tuer des gens pendant toute l’occupation avant la libération de la ville en août 1943.
Ensuite, les Soviétiques ont complètement aplani toute cette zone avec des coulées de boue et ils ont construit un quartier dessus : il n’y avait donc plus rien à voir. Nous faisions un projet sur cet endroit, qui a été interrompu par une guerre où il y avait beaucoup de choses à voir. Sauf que dans les guerres, même celle-ci, ils nettoient très vite. Il n’y a par exemple déjà plus rien à voir à Boutcha. Lorsque nous y sommes allés, il y avait certes encore toutes les maisons en ruines, mais tout le reste avait été nettoyé, les rues et les passages cloutés avaient été repeints. Ils remettaient même les panneaux de signalisation, donc ils faisaient cela proprement. On recommençait donc à travailler sur des crimes atroces, qui avaient eu lieu beaucoup plus récemment, mais où il y avait très peu d’éléments visuels.
Mais contrairement à notre projet sur Babi Yar, on pouvait interviewer des survivants, des gens qui avaient perdu des proches. On a par exemple rencontré quelqu’un qui avait survécu par miracle, mais seulement après avoir été longuement torturé. On a donc beaucoup travaillé sur des situations qui étaient toutes récentes, avec des gens qui étaient profondément impliqués. Pour retrouver la trace des disparus, nous sommes aussi allés dans les morgues.
Pouvez-vous nous dire dans quel contexte cette série sur les morgues a été effectuée ?
Antoine d’Agata
Je m’y suis rendu au mois de mars. À ce moment-là, il n’était pas possible de photographier quoi que ce soit. Mais Jonathan, parlant russe, est venu me voir. Les soldats ukrainiens avaient besoin d’un professionnel pour photographier les corps de soldats russes. Pendant une heure et demie, j’ai donc pu photographier une certaine quantité de cadavres laissés derrière par l’armée russe. En échange, je devais leur donner les fichiers. En fin de compte, ces soldats m’ont aussi donné des photos qu’ils avaient prises de ces cadavres retrouvés. Parmi les images que l’on voit en fin de série, il y a 108 portraits pris par des soldats ukrainiens.
On a aussi pris des photos dans ce qu’ils appelaient le train de la mort.
Les clefs d’un monde cassé.
Du centre du globe à ses frontières les plus lointaines, la guerre est là. L’invasion de l’Ukraine par la Russie de Poutine nous a frappés, mais comprendre cet affrontement crucial n’est pas assez.
Notre ère est traversée par un phénomène occulte et structurant, nous proposons de l’appeler : guerre étendue.
Jonathan Littell
Pour comprendre ce que c’est, il faut savoir que les Ukrainiens sont très stricts sur la question de l’enregistrement des morts. Tous les cadavres qu’ils récupèrent sont répertoriés. Il y a un procès légal, un dossier avec un numéro et le nom du mort. Si c’est un cadavre non identifié, on lui donne un numéro. Puis l’on répertorie. C’est donc un important travail de photographe légiste, avec des photographies de face, de profil, du corps entier et des signes distinctifs. Enfin, ils font aussi un test ADN, dont le résultat est inclus dans le dossier.
De leur côté, on sait que les Russes le font très peu, mais les Ukrainiens font de leur côté ce qu’ils estiment nécessaire pour qu’ il y ait une identification maximale de tous les morts. Ils collectent donc des cadavres partout où il y a des batailles. Ils sont ensuite stockés dans des trains frigorifiques, d’anciens wagons à viande… Ceux-ci sont assemblés, et quand il y a un accord avec les Russes, ils font un échange de train. Les Ukrainiens leur donnent des cadavres, parfois récupérés sur le champ de bataille, parfois déterrés : certains sont en très mauvais état… On a donc eu un coup de chance, parce que leur caméra était cassée le jour où nous les avons rencontrés : ils avaient besoin de ce matériel et Antoine s’est donc retrouvé à faire le photographe légiste pour les militaires ukrainiens.
Sur ces photographies, on voit des visages, mais aussi des corps et des signes distincts. Est-ce vous qui avez fait tout le travail ?
Antoine d’Agata
Je n’avais pas de but précis quand j’ai fait ces images. Il s’agissait juste de réagir à une situation donnée : avant même de penser à un cadre précis, je voulais photographier les corps de face, de profil, les tatouages et les objets. Ensuite, les images étaient tellement réelles, tellement concrètes et tangibles, que ce n’était juste pas regardable.
J’ai donc mis quelques semaines à essayer de trouver une manière de les rendre pertinentes, en les passant d’abord au négatif et ensuite au noir et blanc, pour essayer de toucher une certaine abstraction qui parlerait au-delà de ces corps et de leur réalité, une abstraction qui parlerait de la guerre. Souvent, on ne montre pas les morts quand on documente un conflit. C’était donc une manière de montrer la réalité de cette violence.
Jonathan Littell
Le Monde a d’ailleurs refusé de publier ces photos dans le magazine, car ils trouvaient cela trop angoissant — ils les disaient « anxiogènes ».

Du côté des vivants, comment les photographiez-vous ?
Antoine d’Agata
Avant la guerre, j’ai l’impression d’avoir beaucoup photographié les vivants par défaut parce que c’était la manière commune de saisir la réalité contemporaine. En Ukraine, j’ai surtout photographié des corps et des ruines. Ponctuellement, je me suis occupé des vivants dans les maternités, les bars, les parcs, et même dans un asile psychiatrique !i Dans ces lieux, le vivant est pris dans une certaine obscurité. C’était un moyen de retrouver un lien avec l’histoire.
Avant la guerre, j’ai l’impression d’avoir beaucoup photographié les vivants par défaut parce que c’était la manière commune de saisir la réalité contemporaine. En Ukraine, j’ai surtout photographié des corps et des ruines.
ANtoine D’Agata
Jonathan Littell
Tu as aussi fait des portraits de soldats…
Antoine d’Agata
Lorsque je photographiais les vivants, je voulais effectivement le faire de manière systématique, presque propagandiste. C’était une manière de défendre cet esprit, cet état de résistance d’une communauté entière, et donc de photographier à la fois les soldats, les politiciens et les civils, en essayant de tous les mettre au même niveau.
Jonathan Littell
Ce qui est intéressant avec Antoine, c’est qu’il n’est pas du tout un journaliste d’actualité. Il fait bien sûr des photos d’opportunité quand une image se présente. Mais, par exemple, il met ses portraits en série : il travaille à partir d’un protocole qui est extrêmement strict. Chaque sujet est photographié de trois quarts, à côté d’une fenêtre, avec une source de lumière. Que ce soit le maire de Lviv ou les soldats dans les tranchées, tout le monde posait de la même manière avec la lampe de poche braquée sur eux – même l’état-major du chef de l’administration du président ou les gens dans les hôpitaux. Tous les portraits sont donc identiques, avec des profils illuminés de la même manière, dans le même angle, la même optique et le même cadre. C’est souvent moi qui expliquait aux gens comment ils devaient poser.
Ce processus sériel permettait ensuite de faire des grilles avec des dizaines de portraits identiques dans leur forme.
Antoine d’Agata
Pour revenir à cette question du vivant, une dimension importante de notre travail est cet accès direct et brutal à la réalité des exactions, que nous avons photographiée. On a photographié une salle de torture, des survivants, des lieux où avait eu lieu des viols et des meurtres…
Dans les photos, il y a des combattants, des politiques et des civils… tout le monde, en vérité !
Antoine d’Agata
C’est une dimension importante de la réalité. Mais ce qu’on a surtout vécu — on y a été confronté par l’image — ce sont les fosses communes, des cadavres déterrés, des restes, des outils, des décors, des chaises et des sommiers qui ont été utilisés. C’était des traces de ce qui venait d’arriver.
Essayiez-vous de retrouver l’histoire derrière ces traces ?
Jonathan Littell
Bien sûr, s’il était possible de faire des recherches et de creuser. Mais dans ce type d’investigation, il y a une question de moyens : il faut du temps et des équipes, deux choses dont nous étions relativement dépourvus.
Nous avons pu enquêter dans des cas très spécifiques : par exemple à propos d’une corps d’une jeune femme qui avait été retrouvée dans une cave, probablement violée, ou des individus de la défense territoriale exécutés près d’un bâtiment. Dans d’autres situations, j’ai pu faire des choses très superficielles comme discuter avec les propriétaires d’une maison ou des gens qui travaillaient dans un immeuble qui se trouvaient près d’une tuerie.
Plusieurs mois après, j’ai vu que le New York Times avait sorti des enquêtes sur les mêmes cas, où ils avaient mis 10 personnes dessus pendant trois mois, passé en revue toutes les vidéos de surveillance de la ville, ce qui représentent des milliers d’heures d’images.Ils arrivent ainsi à reconstituer, minute par minute, le moment où les Russes arrêtent les gens dans une maison. Ces vidéos leur ont également permis de retrouver des témoins. Dans ce type d’investigation, les moyens comptent énormément.
J’ai dû m’y prendre différemment, même si débarquer dans un endroit et parler avec des gens peut donner une vision impressionniste des choses qui n’est pas sans intérêt : c’est l’esprit d’un article comme celui que j’ai écrit, qui offre de petits éclats.
Ce que vous écriviez reste pourtant précis, non ?
C’est précis, mais pas fouillé. Dans le travail que je fais maintenant, je m’appuie aussi sur le travail d’autres enquêteurs, plus sérieux et avec beaucoup plus de moyens que moi. Ils arrivent vraiment à reconstituer des choses très précises, notamment à propos de la chronologie tragique. Qui est mort à quel moment ? Dans quel ordre ? Quelles unités étaient impliquées ? Quelle était la logique derrière ces meurtres ?

Par exemple, quand nous étions ensemble à Boutcha, nous n’établissions aucune chronologie : certains étaient morts au début de l’occupation, et d’autres à la fin. Au contraire, dans les travaux de longue haleine comme ceux du New York Times, on arrive à des unités précises en établissant qui était là à quel moment. Ceci permet de reconstituer les séries de meurtres, et de comprendre comment les Russes opèrent : la première série de meurtre est liée au moment où ils entrent dans la ville et nettoient ; la deuxième est plus opportuniste car elle prend place pendant l’occupation ; quant à la troisième, elle survient à la fin de celle-ci et elle est sans doute liée à un effet de panique, à la fureur et la rage de perdre et de partir. Quand on arrive à ce degré de détails, on arrive bien davantage à comprendre les motivations des tueurs et, ce qui est quand même le plus intéressant, pourquoi cela a eu lieu. Mais je n’ai pas les moyens de faire des recherches.
La première série de meurtre est liée au moment où les Russes entrent dans la ville et nettoient ; la deuxième est plus opportuniste car elle prend place pendant l’occupation ; quant à la troisième, elle survient à la fin de celle-ci et elle est sans doute liée à un effet de panique, à la fureur et la rage de perdre et de partir.
Jonathan Littell
Antoine d’Agata
On voit un petit peu la nature essentielle des journalistes et des photographes volontaires : ils continuent à y aller, à parler et à faire des choses, mais en même temps celles-ci restent toujours dérisoires. Pour ce qui me concerne, j’ai toujours du mal à discerner la limite entre ce qui est important et utile, et ce qui ne l’est pas.
Jonathan Littell
Il y a aussi la question de la masse de corps à documenter. On a parlé de dizaines de milliers de morts à Boutcha ; il n’y en a pourtant que 450 identifiés et répertoriés.
Quand êtes-vous arrivés exactement, et que se passait-il à ce moment à Boutcha ?
Jonathan Littell
Il ne passait rien ; c’était cinq semaines après la libération de la ville, ils étaient en train de nettoyer.
Antoine d’Agata
Cinq semaines, c’est quand même mieux que 70 ans trop tard…
Jonathan Littell
Oui, bien sûr, cinq semaines, c’est mieux. Trois mois après, j’y suis retourné, en septembre ; il y avait des endroits qui avaient été complètement rasés. Il y avait des ruines en mai, mais quand nous y étions ensemble en septembre, ils avaient déjà aplani les terrains.
Moins de six mois après, les Ukrainiens étaient en train de tout reconstruire à neuf. Par exemple, dans la rue où ils ont détruit cette colonne russe — la photo des blindés russes a beaucoup circulé à l’époque — l’armée ukrainienne avait aussi détruit beaucoup de maisons. Quelques mois après, ils étaient en train de tout refaire à neuf.
La question du temps est très importante, mais il faut aussi garder en tête le fait qu’il y a une dimension sérielle. De mon côté, je faisais des listes. Par exemple, j’ai commencé à faire une liste de tous les noms de gens morts à Boutcha que je pouvais trouver. J’en ai déjà une soixantaine. Mais il ne s’agit pas d’une simple liste de noms ; je cherche aussi à savoir quand ils sont morts, quel jour et dans quelles circonstances. Commencer à travailler de cette manière sur les 450 corps répertoriés leur fait prendre beaucoup plus de consistance, parce que tous ces gens avaient des familles et des vies. Chacun a une histoire, mais si on ne travaille que sur des histoires individuelles, on ne va pas très loin. Au contraire, si on les prend ensemble, cela devient beaucoup plus consistant.
C’est un travail d’archivage macabre en quelque sorte…
Jonathan Littell
Oui, mais en même temps 33 771 juifs ont été assassinés à Babi Yar, selon l’organisation avec laquelle on travaille, le Babi Yar Holocaust Memorial Center, qui essaie d’établir une liste des 33 771. Je dis 33 771, parce que c’est le chiffre des nazis. Évidemment, personne ne sait comment ils ont compté, c’est donc un chiffre fictif.
Mais avec Boutcha, ils essaient de faire des listes. Comme ce sont des listes par ordre alphabétique, il y a parfois trente noms qui désignent une même fratrie, une seule famille étendue. J’essaie donc de les restituer. On dit que les nazis ont tué 60 000 juifs à Kiev, 25 000 personnes âgées à Zhytomyr, 22 000 personnes à Berdychiv et 22 300 à Lviv ; si l’on essaie de restituer qui sont les gens derrière ces chiffres, on arrive à cette expérience de pensée : « prenez une pièce, et imaginez la moitié des personnes qui l’occupent mortes. »
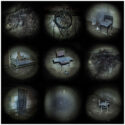
Antoine d’Agata
Ce que tu dis me renvoie à un travail que j’avais fait avec des migrants dans différents pays d’Europe. Au jour le jour, la réalité peut sembler un peu banale ou anodine : ce n’était pas l’horreur, plutôt des douleurs. Mais tous les soirs, quand j’étais à l’hôtel, je faisais un travail personnel qui était de transformer ces chiffres en mots. Sur Internet, on trouve qu’il y a 30 000 migrants morts en Méditerranée ces trente dernières années, et ne serait-ce que de transformer ces chiffres, de les mettre en mots, de savoir comment sont morts ces personnes sans même connaître leur nom, de passer du chiffre à la lettre, cela force à chacun à tenir compte de cette horreur.
Êtes-vous satisfaits que les Ukrainiens soient en train de regagner du terrain ? Avez-vous l’impression de voir émerger un nouvel ordre mondial ?
Jonathan Littell
Le mot « satisfaction » n’est pas le mot juste. J’ai commencé à travailler en Tchétchénie en février 1996 : j’ai donc un recul de 26 ans sur les guerres que mène la Russie, d’autant que j’ai aussi couvert l’invasion de la Géorgie en 2008. J’ai aussi beaucoup de pratique, j’ai eu beaucoup de discussions avec leurs militaires quand je faisais de l’humanitaire en Tchétchénie, donc j’ai négocié avec l’armée russe que je connais très bien dans son fonctionnement. Ce qui arrive aujourd’hui en Ukraine n’est pas tellement une surprise pour moi. Je ne suis pas étonné que l’armée russe se révèle fragile, chaotique, corrompue et finalement incapable de se battre. On aurait tous pu s’en douter un peu, malgré les velléités de modernisation de Poutine.
Je ne ressens donc pas de satisfaction. Je suis triste de voir que tout le monde a mis 20 ans à comprendre des choses qui étaient parfaitement compréhensible au début des années 2000 pour ceux qui s’intéressaient un peu à la situation. Tout ce qui se passe maintenant était évident dès les deux premières années de Poutine, mais lorsque j’en parlais à des politiciens français à l’époque de Sarkozy, ils me riaient au nez : « Poutine est un homme raisonnable, on peut faire des affaires avec lui ». Après la guerre de Géorgie, Sarkozy s’était empressé de lui vendre des mistrals… C’est donc comme le réchauffement climatique, ça fait quarante ans qu’on dit qu’il y a un problème.
On dit que les nazis ont tué 60 000 juifs à Kiev, 25 000 personnes âgées à Zhytomyr, 22 000 personnes à Berdychiv et 22 300 à Lviv ; si l’on essaie de restituer qui sont les gens derrière ces chiffres, on arrive à cette expérience de pensée : « prenez une pièce, et imaginez la moitié des personnes qui l’occupent mortes. »
Jonathan Littell
Mieux vaut tard que jamais, sans doute, que les gens se réveillent et se rendent compte qu’il y a un problème avec la Russie, bien que celui-ci soit vieux de 22 ans. Mais nous n’aurions pas eu ce problème si nous avions réagi beaucoup plus tôt. On a laissé Poutine arriver jusque-là, on l’a laissé faire en Crimée, en Géorgie, dans le Donbass, en Syrie, en Centrafrique et au Mali. À chaque fois, on ne voulait pas l’énerver. Lui, de son côté, parce qu’on s’est constamment couché devant lui, pense qu’on va continuer à faire de même. Notre politique allait dans son sens puisqu’ill estime que les démocraties sont faibles, qu’elles n’arrivent qu’à un consensus mou. C’est pour cela qu’il s’est dit qu’il pouvait envahir le territoire ukrainien dans sa totalité.
Mais les Ukrainiens n’étaient pas d’accord. Même dans nos sociétés démocratiques à consensus mou, il y a des points de rupture. Ici, on en a touché un quand tout le monde s’est rendu compte que ça ne pouvait pas continuer, parce que la situation devenait trop dangereuse, pour l’Ukraine bien sûr, mais aussi pour l’Europe.
L’invasion de 2022 a constitué la ligne rouge, et on a finalement mis les moyens. Et aujourd’hui, quand on lit la presse allemande ou française, on trouve beaucoup de fantasmes sur les Américains et l’OTAN. Du point de vue américain, si on ne les arrête pas en Ukraine aujourd’hui, on va être obligés de les arrêter en Pologne demain ou en Lituanie et en Lettonie ; donc autant les arrêter en Ukraine aujourd’hui, parce que cela coûte moins cher matériellement et que ce ne sera pas nos soldats. Ce sont des Ukrainiens qui se battent.
Je ne sais pas quelle est l’issue probable pour le moment ; tant que Poutine sera là, il ne s’arrêtera pas, c’est certain.
Je sais que les trois révolutions russes du XXème siècle ont été la conséquence d’une guerre perdue qui avait fini par fragiliser le pouvoir : 1905, c’était les Japonais ; 1917, c’était la Première Guerre mondiale ; 1991, c’était l’Afghanistan. Nous verrons donc si ce schéma-là peut se répéter encore une fois, mais il faudrait pour cela qu’ils perdent décisivement. On ne peut pas geler le conflit, parce qu’alors l’on remet les cartes comme en 2015, et on repart pour dix ans de guerre larvée avant qu’ils ne tentent à nouveau de prendre l’Ukraine. Que Poutine soit encore à la tête de la Russie, ou qu’il ait planifié sa succession, ce sera la même chose
Il faut une défaite décisive, une défaite réelle des forces russes qui soient repoussées d’une énorme partie du territoire ukrainien, pour arriver à une résolution du conflit qui permettrait d’avoir quelque chose de stable sur le moyen terme.
Antoine d’Agata
Mon constat est le même, même si j’ajouterais que les Américains font depuis longtemps la même chose que ce que font les Russes. Cela ne peut pourtant pas être une excuse pour ne pas être du côté des Ukrainiens. Nous n’avons pas le choix.
Jonathan Littell
Je ne suis pas tout à fait d’accord, parce que les Américains ne font pas des choses comme Boutcha. Quand les États-Unis entrent en guerre, ils essayent de faire le bien … et ils échouent complètement, alors que les Russes essaient de faire le pire possible.
Malgré ce désaccord, vous collaborez …
Antoine d’Agata
Sur le terrain il n’y a jamais eu de divergence : une évidence s’impose dans le travail.
Crédits
En septembre 2021, pour la commémoration des 80 ans du massacre de Babyn Yar (le plus grand massacre de la Shoah en Ukraine, en 1941, lors duquel 34 000 juifs ont été fusillés dans le ravin de Babyn Yar à Kyiv, ndlr), ils ont présenté un travail d’étape sous la forme d’une exposition dans la station de métro Dorohozhychi, celle qui mène à Babyn Yar.
Après l’invasion du 24 février 2022, ils sont retournés ensemble à Kyiv, Boutcha, Khrkiv et d’autres villes, semées de corps de civils, de soldats ukrainiens ou russes, pour rédiger deux reportages pour M, le Magazine du Monde. Pour le festival Hors Pistes, dont le Grand Continent est partenaire, et sur une idée de Danielle Arbid, Jonathan Littell et Antoine d’Agata partagent leurs regards et récits personnels sur un pays ravagé par la guerre.



