Droits sans frontières, une conversation avec Laurent Cohen-Tanugi, Nicolas Dufourcq et Jean-François Bohnert
Relais de plus en plus assumé de la puissance publique, le droit s’étend — il transperce les frontières nationales. À l’occasion de la sortie de son dernier livre, Laurent Cohen-Tanugi échange avec Nicolas Dufourcq et Jean-François Bohnert sur la manière dont les États-Unis, l’Union européenne et la Chine ont usage géopolitique de leurs systèmes juridiques.
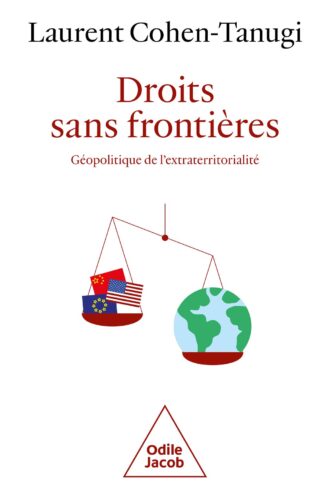
Laurent Cohen-Tanugi
À la différence de mes précédents ouvrages, ce nouvel essai, Droits sans frontières : Géopolitique de l’extraterritorialité, a été largement nourri par mon activité professionnelle des dix dernières années dans le domaine du droit pénal international des affaires, conjuguée ici avec mes centres d’intérêt habituels que sont la géopolitique et les relations économiques internationales.
L’extraterritorialité est un mot un peu barbare, mais l’on peut en donner la définition suivante : l’application extraterritoriale du droit d’un État consiste pour cet État à appliquer son droit à des personnes étrangères pour des actes commis au moins en partie à l’étranger ; ce qu’on appelle une « double extranéité » dans le jargon des internationalistes.
Le terme a fait irruption dans le débat public à travers le procès très médiatisé fait à l’application extraterritoriale du droit américain, à l’occasion d’abord de l’affaire BNP Paribas en 2014, avec ses neuf milliards d’amende retentissants – pour violation des embargos américains contre l’Iran, le Soudan et Cuba. Il y a eu ensuite l’affaire Alstom – affaire de corruption – dans laquelle l’entreprise a été condamnée à plusieurs centaines de millions de dollars d’amende. On a vu d’ailleurs émerger à cette occasion une sorte de théorie du complot, selon laquelle les autorités américaines auraient sanctionné Alstom pour permettre à General Electric de prendre le contrôle d’une partie du groupe à bas prix.
On a donc parlé d’extraterritorialité à l’occasion de ces affaires ; et l’on a pu qualifier les procédures américaines de violation du droit international. Quelqu’un d’aussi modéré que Michel Rocard a même parlé d’extorsion dans le cas de BNP Paribas, et un courant de pensée très présent dans les médias français qualifie de « guerre économique » des États-Unis contre les entreprises françaises et européennes ces procédures anticorruption ou relatives aux sanctions économiques.
J’ai ainsi voulu clarifier le débat, en commençant par le droit international. Celui-ci repose depuis les traités de Westphalie de 1648 sur le principe de territorialité – mais il y a des exceptions, notamment depuis cet arrêt « Lotus » de 1927 de la Cour permanente de justice internationale, qui déclare qu’un État peut exercer sa compétence normative et juridictionnelle de manière extraterritoriale, à la différence de sa compétence d’exécution : autrement dit, un État ne peut pas accomplir des actes d’exécution sur le territoire d’un autre État, mais il peut par contre prendre des mesures législatives ou juridictionnelles qui ont des effets extraterritoriaux.
Il y a donc bien cette possibilité dans le droit international classique ; et la question qui se pose est évidemment celle de la nécessité d’un rattachement avec l’État qui prend ces mesures – c’est-à-dire un rattachement entre les personnes, les actes qui sont sanctionnés et l’État. Tout le débat porte sur la nature de ce lien.
Si on en vient maintenant au droit américain, il y a à l’évidence une forte tendance de celui-ci à se projeter extraterritorialement. C’est le reflet de la puissance économique, politique et juridique des États-Unis, notamment dans les domaines de la lutte contre la corruption, des sanctions économiques, mais également de la fiscalité.
La plupart du temps, ces projections extraterritoriales ne sont cependant pas contraires au droit international, dans la mesure où il y a un lien avec le territoire américain. Je prends un exemple, l’affaire BNP Paribas ; l’interprétation communément admise en France est que c’est l’utilisation du dollar qui a justifié la compétence des États-Unis. On en conclut ceci : si l’on utilisait l’euro ou une autre monnaie, on pourrait éviter les griffes de l’Oncle Sam.
En réalité, ce n’est pas le cas : la BNP a une licence bancaire aux États-Unis et des activités sur le sol américain ; elle est de ce fait soumise à la compétence législative et juridictionnelle des États-Unis ; quand bien même on n’aurait pas utilisé le dollar et le système financier américain, le problème aurait été le même. Les États-Unis se servent du dollar ou de l’utilisation d’Internet en dernier ressort, lorsqu’il n’y a vraiment rien d’autre pour poursuivre notamment les personnes physiques ; mais en général, dans la plupart des cas, il y a tout un ensemble de liens de rattachement qui permettent d’exercer la compétence américaine.
Au-delà du droit américain, on constate que l’Union européenne elle-même édicte des normes d’application extraterritoriale. Cette dernière s’est même longtemps définie comme une puissance normative internationale, qui édicte des lois et règlements dont elle aspire à ce qu’ils aient une portée universelle. C’est ce qui fait la spécificité du projet européen.
Le droit de la concurrence européen — comme le droit de la concurrence américain — applique ainsi ce qu’on appelle la théorie des effets ; c’est-à-dire que si une opération de concentration ou une entente, y compris entre deux entreprises non européennes, a des effets sur le Marché unique européen, la Commission européenne est compétente pour la contrôler et la sanctionner.
D’autres exemples répondent à la même logique d’application extraterritoriale du droit européen : le Règlement sur la protection des données personnelles, le fameux RGPD, maintenant d’application universelle ; le devoir de vigilance, qui là aussi s’intéresse à ce qui se passe dans les filiales des entreprises européennes dans les pays émergents ou en développement ; la régulation des plates-formes numériques avec le Digital Market Act et le Digital Services Act ; l’environnement, naturellement.
Ce qui fait la différence avec les États Unis, c’est que ces derniers disposent d’une force de frappe – à travers le Département de la justice (DOJ), l’OFAC et d’autres agences fédérales – que l’Union européenne ne possède pas — sauf la Commission européenne en matière de concurrence. L’Union européenne n’a pas encore d’institutions comparables pour pouvoir sanctionner l’application de son droit. Il y a certes le Parquet européen, d’existence récente, mais qui n’a pour le moment compétence que sur les fraudes au système européen ; c’est un embryon qui devrait évoluer.
On constate donc une expansion de l’extraterritorialité, qui était au départ une exception au droit international classique. Pourquoi ? Tout simplement en raison de la mondialisation économique, même si celle-ci est un peu plus contrainte et compliquée aujourd’hui. Nous vivons dans un univers globalisé, c’est-à-dire avec des flux informationnels numériques globaux. C’est le décalage entre cette mondialisation et le caractère encore national et territorial du pouvoir politique et juridique qui crée ce besoin d’extraterritorialité.
Il y a un deuxième phénomène : de plus en plus, l’on assiste à une interpénétration entre la régulation économique et financière et des enjeux planétaires autres : la lutte contre le changement climatique, la lutte contre le terrorisme ou les droits de l’homme. On peut citer en exemple l’affaire Lafarge – Lafarge a plaidé coupable aux États Unis pour avoir financé le terrorisme en Syrie, et transigé au prix d’une amende de plusieurs centaines de millions de dollars. Nous avons aujourd’hui en France un instrument de justice négociée, ce qu’on appelle la Convention judiciaire d’intérêt public ou CJIP – , mais elle n’est pas applicable pour des affaires de terrorisme. Les Américains ont donc pu conclure très rapidement une transaction sur ce sujet, alors que la France était engluée dans les procédures judiciaires.
D’où la double thèse de ce livre : l’extraterritorialité a vocation à prospérer dans le monde globalisé d’aujourd’hui ; et elle contribue à faire avancer positivement le droit international.
Je prendrai là aussi quelques exemples, dont la corruption. On est parti d’une loi américaine de 1972, le FCPA, en réponse au scandale du Watergate. Vingt ans après, une convention internationale – la Convention OCDE, le pilier aujourd’hui du droit international de la lutte contre la corruption – induit à son tour des lois nationales : en France, par exemple, il s’agit de la loi Sapin II de 2016. Ainsi, à partir d’une projection unilatérale de la puissance d’un État – les États-Unis –, découle progressivement l’élaboration d’un instrument international, puis de lois nationales dans différents États.
Mais cette dynamique n’est pas propre aux États-Unis : l’Union européenne, avec le règlement sur les données personnelles, a fait des émules. La Californie a adopté une loi qui reprend très largement les normes européennes. On assiste donc progressivement à une mondialisation des normes à partir d’une initiative unilatérale ; en fiscalité internationale également, le FATCA américain donne ensuite lieu à une convention sur la fiscalité internationale.
L’extraterritorialité provoque naturellement des conflits, des tensions, des frictions – comme on l’a souvent vu entre les États-Unis et la France ou l’Europe – mais leur solution passe par l’harmonisation des législations, comment on vient de le voir, et par la coopération des autorités de poursuite et des juridictions – au sein d’une opération judiciaire et juridique internationale. C’est la bonne approche : c’est ce qu’on a fait en France avec la loi Sapin II, par exemple en introduisant une convention judiciaire d’intérêt public, équivalent des instruments transactionnels américains ou anglais, qui permettent d’une part de sanctionner et faire appliquer la loi beaucoup plus rapidement, tout en ouvrant une coopération entre les différents États, qui disposent ainsi des mêmes instruments. Ceci a permis à la France d’intervenir en première ligne dans les dossiers d’Airbus et de la Société générale. C’est une bien meilleure réponse que la loi de blocage française, qui est là depuis des années mais qui n’a jamais vraiment été utilisée.
Une dernière remarque s’impose, cela ne peut naturellement fonctionner qu’entre des États de droit. Et ce qu’on constate aujourd’hui, c’est que les régimes autoritaires, la Russie, la Chine, l’Iran, instrumentalisent le droit de manière arbitraire pour en faire une arme géopolitique. On passe de l’État de droit au Far West. C’est extrêmement préoccupant pour les démocraties occidentales et pour la poursuite de la mondialisation, parce qu’on a affaire à des détentions arbitraires, des jugements sommaires et des prises d’otages, comme on le constate aujourd’hui en Russie. C’est donc pour moi quelque chose de totalement différent de l’application extraterritoriale des droits américain ou européen. C’est un autre référentiel qui me préoccupe énormément.
Nicolas Dufourcq
Je suis assez familier de ces usages du droit, dans le cas iranien notamment. En 2015, la France avait signé le JCPoA (Joint Comprehensive Plan of Action), un traité qui permettait de renouer les relations diplomatiques et économiques avec l’Iran, porté notamment par l’administration Obama, mais également par les administrations française, britannique, allemande et russe. À l’époque, la question du rétablissement des relations économiques entre les entrepreneurs français et l’Iran se posait avec une très grande acuité : c’est un très grand marché pour Peugeot par exemple, qui était l’acteur dominant du secteur automobile iranien, mais la question est aussi importante dans les secteurs de l’agroalimentaire ou de la santé, et dans le gaz aussi.
Comme BNP Paribas avait tout juste été condamnée, de même que la Société générale – pour des raisons similaires — les autres grandes banques de la place, notamment les banques mutualistes, ne voulaient pas rétablir des relations bancaires avec l’Iran. Elles subissaient toutes la logique des autorités financières américaines sur le secteur bancaire français, pour une raison très simple : elles manipulaient toutes du dollar, sans même avoir forcément de licence bancaire aux États-Unis.
Le pouvoir américain paraissait sans limites. J’ai eu beau me démener auprès des directeurs généraux de ces banques pour leur demander de rétablir des flux de trade finance pour les entrepreneurs français vers l’Iran, la réponse était systématiquement négative, à part deux banques microscopiques qui passaient entre les gouttes à l’époque. Il a donc été demandé à la BPI de devenir une sorte de banque franco-iranienne : le raisonnement était que la banque avait des capitaux publics, et qu’elle devrait donc pouvoir échapper à la férule américaine.
On s’est donc mis au travail. Évidemment, à partir du moment où vous commencez à manipuler des dollars, vous êtes pris au piège : nous avons donc bâti une deuxième banque, une espèce de BPI bis avec son système d’information à part, dans laquelle il n’y avait pas l’ombre du moindre dollar. Cela n’a rien de simple puisque, évidemment, on lève de la liquidité sur les marchés mondiaux pour pouvoir faire des prêts aux entrepreneurs français. Et cette liquidité, on la swappe en dollars ou on la lève en dollars pour faire nos prêts. Il y a donc toujours un peu de dollars quelque part. Même si on ne fait pas de crédit en dollars, on fait des swaps. Il a donc fallu créer une deuxième structure. On l’a fait sous Obama, on ne l’a pas fait sous Trump. Sous Obama, le JCPoA fonctionnait encore, le traité n’avait pas été dénoncé, et on a réussi à le faire.
Cette BPI franco-iranienne permettait donc de faire du crédit export en euros à des acheteurs iranien de biens d’équipement français, de produits agroalimentaires ou de santé : le trade finance, les flux financiers se faisaient au travers d’une petite famille de six ou sept banques européennes qui avait encore le courage de le faire.
Nous étions ainsi prêts à démarrer quelque chose. Ce dispositif, je suis allé le présenter à l’OFAC à New York pour obtenir un accord des américains, stipulant qu’ils ne nous attaqueraient pas sur le cœur souverain de la Banque publique d’investissement française. C’est dire l’état de dépendance dans lequel on s’était mis. On peut donc dire que le droit international finit toujours par baver comme du buvard, et c’est vrai, mais il y a parfois le fort et le faible. L’Europe était faible, et surtout elle n’avait pas très envie d’être forte, parce que les acteurs eux-mêmes avaient été épouvantés par les neuf milliards de la BNP.
Là dessus est arrivé Trump et tout s’est terminé d’un coup. Le JCPoA a été dénoncé par les Américains, et les Européens ont suivi parce qu’ils étaient terrorisés par les sanctions secondaires. Tandis que les sanctions primaires touchent votre entreprise, les sanctions secondaires affectent tous les sous-traitants possibles de l’entreprise condamnée. Prenons la Banque publique d’investissement : est-ce que je vais faire prendre des risques à une PME familiale qui fabrique des valves à Montmirail ? Malheureusement, le risque existe, quand bien même vous seriez souverain et que vous auriez bâti — comme nous — votre deuxième banque afin de construire proprement un cluster : même si l’OFAC d’Obama l’avait validé, rien ne disait que l’OFAC de Trump ferait la même chose. Pire, même s’il l’avait validé, cela ne valait pas grand-chose, puisque Trump était d’humeur changeante. Donc est-ce que vous faites prendre un risque à un entrepreneur de Montmirail ? Non, bien sûr, et vous arrêtez tout. Avec Peugeot, et ses actionnaires, nous sommes donc sortis de l’Iran. De ce point de vue-là, l’administration américaine, dans sa volatilité politique et sa radicalisation, a gagné. Et les Iraniens n’étaient pas dupes : ils nous disaient : « vous n’y arriverez pas ; vous êtes sympathiques, mais vous n’y arriverez pas. » L’ambassadeur d’Iran à Paris était content qu’on fasse tous ces efforts pour appliquer le droit. On avait signé ce traité, mais il nous regardait avec incrédulité — et en effet, il avait raison, toute l’Europe a renoncé.
Laurent Cohen-Tanugi
Vous avez pu faire cela parce que vous n’étiez pas présents aux États-Unis.
Nicolas Dufourcq
Bien sûr. Et, justement, j’ai des représentants de BPI France partout dans le monde. Aux États Unis, par exemple, j’ai recruté le consul de France à San Francisco : on a tout fait pour qu’il ne soit pas considéré comme un patron d’agence et pour qu’il n’ait aucune activité commerciale. Il est resté consul de la BPI à San Francisco ; on se débrouille ainsi. Échaudés par cela, on ne traite toujours pas en dollars et on ne fait pas de crédit export en dollars.
Le deuxième chapitre, qui se relie directement aux opérations que vous avez décrites, c’est la loi Sapin II. Nous avons été de bons élèves de l’application de cette loi, et on a été les premiers à être contrôlé par l’agence française, qui s’est faite la main sur la BPI avant d’aller voir ailleurs. Globalement, on a été bien notés, mais dans le portefeuille de la BPI il y avait Technip, qui était prise dans une affaire de corruption au Brésil. Elle n’avait rien à voir avec les États-Unis, mais cela a suffi pour que l’administration américaine les condamne à des amendes significatives.
À l’époque, j’ai interrogé le Trésor pour savoir pourquoi on faisait passer les deux lois Sapin, qui étaient particulièrement exigeantes. La réponse était qu’ils préféraient prendre l’initiative de condamner des entreprises françaises plutôt que de laisser les Américains le faire. En réalité, les États-Unis attaquent avec leur dispositif normatif avant de l’imposer de facto aux États européens. Le problème, c’est qu’une fois que les Américains ont vu qu’il y avait un alignement juridique sur leur position, ils condamnaient quand même les entreprises fautives qui se retrouvent à payer deux amendes — l’américaine et la française.
Il y a quand même une conséquence à cette législation. J’ai accompagné le Président de la République pendant deux des étapes de son récent voyage en Afrique : en RDC et en République du Congo. Dans les deux cas, j’ai constaté que les entreprises françaises avaient énormément de difficultés à opérer, largement à cause de la législation Sapin. À la place, ce sont des investisseurs chinois ou turcs qui s’installent. Ce n’est pas très embêtant pour les Américains, qui ont peu d’activités en Afrique, mais cela pose beaucoup plus de problèmes aux Européens.
Les Français n’avaient de fait pas souhaité ces lois-là. Michel Sapin est très fier de les avoir préparées et d’avoir légué son nom à l’histoire : on en parle beaucoup ensemble. Mais il faut dire ce qui est : la contagion du corpus juridique américain sur la France a des conséquences. Ce n’est jamais gratuit.
Laurent Cohen-Tanugi
On ne peut tout de même pas dire que la perte d’influence française en Afrique est principalement due à la lutte anticorruption !
Nicolas Dufourcq
La perte d’influence de l’Occident, certainement. La Chine et la Turquie ont pris le relais.
Laurent Cohen-Tanugi
Cela revient à dire : nous sommes obligés de corrompre dans certains pays ; je pense que c’est une thèse qu’on ne peut plus défendre.
Nicolas Dufourcq
Il faut juste ne pas se payer de mots. Nos progrès dans l’ordre de la morale ne sont pas un ticket gratuit. Je veux juste dire qu’il ne faut pas aller se plaindre ensuite – comme le fait la presse française – en disant que la France a disparu du continent africain.
Les entreprises chinoises sont-elles sanctionnées aux États-Unis ? Ou bien les entreprises turques ? Si corruption il y a, elles pourraient être exposées à la loi américaine. 1
Nicolas Dufourcq
Ils l’ont effectivement fait pour Huawei, qui est massivement déployé en Afrique. Mais de nombreuses autres entreprises chinoises présentes sur le continent n’ont pas d’activités aux États-Unis (par exemple dans le secteur des mines) : les Américains sont donc impuissants. Du reste, il s’agit de la Chine, ils ne peuvent pas sanctionner trente entreprises comme ils l’ont fait avec Huawei, d’autant qu’elle impose de plus en plus sa propre monnaie, le renminbi, pour échapper aux sanctions attachées à l’usage du dollar.
Jean-François Bohnert
Je vais vous donner un point de vue judiciaire ; le Parquet national financier a dans ce milieu un rôle de perturbateur sur plusieurs secteurs.
Je rejoins complètement l’analyse de M. Cohen-Tanugi sur les fondements et surtout l’évolution, la réponse qui a été apportée à l’extraterritorialité. L’analyse que vous faites, Monsieur Dufourcq, sur les États-Unis, je la faisais aussi à un moment donné, jusqu’à ce que les relations franco-américaines évoluent au sein du parquet ; et là, je porterai un regard différent du vôtre sur la loi Sapin II – étant magistrat, je ne peux avoir de position – ce que j’observe en revanche, c’est que la loi Sapin II en créant l’AFA, mais aussi la convention judiciaire d’intérêt public, nous a permis de nous rapprocher par l’outil législatif des outils américains et de pouvoir lutter au plan juridique et judiciaire.
J’entends l’aspect économique et financier. Ce sont des réalités différentes ; mais en tant que magistrat français, je peux vous dire que grâce à la CJIP et notamment grâce à l’affaire Airbus en 2020, le parquet national financier français a retrouvé une initiative. Lors de l’affaire Airbus, des faits de corruption planétaire de la part de l’entreprise pendant des années ont donné lieu à de triples poursuites, américaine, françaises et britannique ; c’est le parquet national financier français qui les a pilotées. Une amende a été décidée et calculée séparément par les Américains, les Français et les Anglais ; et c’est un montant total de 3,6 milliards qui a été imposée comme sanction à Airbus.
On reviendra tout à l’heure sur la question de la corruption : qui fait quoi ? Est-ce qu’il n’y a que les Français et Européens qui y aient recours et soient sanctionnés ? Mais cette affaire, qui date de 2020, je la cite d’autant plus volontiers qu’elle a marqué au plan judiciaire un tournant. Auparavant, c’était les Américains (vous avez cité BNP Paribas, Alstom, Société Générale) qui sanctionnaient les entreprises françaises, au motif que les Français ne faisaient pas le travail de la lutte anticorruption. Les États-Unis étaient rejoints sur ce point par l’OCDE au début des années 2010.
Aujourd’hui, la lutte anticorruption, notamment celle dirigée contre la corruption d’agents publics étrangers, est la priorité d’action du parquet national financier (PNF) : ce domaine d’action représente près de la moitié de nos affaires. Il s’agit des questions d’atteinte à la probité, portant sur l’extraterritorialité et les compétences pour traiter de la corruption d’agents publics étrangers, en particulier depuis la loi Sapin II – ce qui me donne aujourd’hui la compétence suivante : imaginez une succursale d’une entreprise américaine, située en France, qui serait prise la main dans le sac en train de commettre des faits de corruption à travers le monde, voire aux États-Unis : j’aurais alors compétence pour engager des poursuites. Il nous faut cependant un lien de rattachement avec le sol français. Ce lien ne sera évidemment pas le dollar, ni le franc qui n’a plus cours ; ce n’est pas non plus l’euro.
Depuis la loi Sapin II, en particulier lorsque j’ai traité en 2020 le dossier Airbus avec le président du tribunal judiciaire de Paris, qui a validé la CJIP française, je constate une répartition plus claire des rôles entre les États-Unis et la France.
Ainsi, aujourd’hui, lorsque le DOJ (Department of Justice), mon homologue américain, voit apparaître une société française posant problème sur le terrain de la corruption, son premier réflexe n’est plus d’engager des poursuites sur le sol américain, pour peu qu’il y ait effectivement un lien – son premier réflexe est de m’appeler ou de m’envoyer un mail en disant : « Êtes-vous au courant des faits qui concernent cette société ? Si oui, est ce que vous êtes prêt à vous en saisir ? Sinon, je suis prêt à m’en occuper. Mais si vous êtes prêt à le faire, on vous laisse la main et on est prêt à vous donner les éléments que nous avons recueillis sur le sol américain pour que vous puissiez faire votre travail à partir du sol français. »
Voilà aujourd’hui la réalité, encore une fois sur le terrain judiciaire : j’ai conscience que sur l’aspect financier, que vous évoquez à juste titre, on voit la géopolitique qui évolue et le rôle croissant de la Chine. Mais la vigilance nous imposerait de nous demander qui impose sa compétence pour les sociétés françaises et étrangères.
L’on peut certes dire : « mais si on fait le ménage en France et en Europe sur le terrain de la lutte anticorruption – aux États-Unis aussi – qu’en est-il si, effectivement, d’autres grandes nations, comme par exemple la Chine, se permettent tout dans des continents que nous connaissons bien pour les avoir traversés ? » On retrouve là cette inégalité des armes, dont les entreprises américaines s’étaient plaintes dans les années 70, 80 et 90, en critiquant les entreprises européennes ; critiques qui avaient suscitées la loi américaine que l’on connaît, le FCPA, en 1977. Il y a donc là un véritable enjeu — vous avez raison. Je pense que ces considérations ne relèvent pas de l’angélisme, mais d’une vigilance que doivent avoir les autorités judiciaires, pas seulement en France, mais en Europe et aux États-Unis. Il faut aller voir précisément ce que font les acteurs chinois.
Le principe est de savoir si l’on admet la corruption comme une fatalité économique, commerciale et financière – ou non. On voit les effets pervers de la corruption dans de nombreux États – à commencer par notre pays. Il y a des choses qui aujourd’hui ne sont plus acceptées dans le cadre de la démocratie, et dans le cadre du regard porté par une population à l’égard de ses dirigeants. Il y a effectivement quelques règles qu’il faut parfois rappeler, sinon il n’y aura plus de limite aux excès et ce sera juste la loi du plus fort, le Far West, pour utiliser l’expression que vous aviez indiquée tout à l’heure.
Il y a des règles de jeu qu’il faut, à un moment donné, rappeler et fixer — mais à condition, comme le dit Nicolas Dufourcq, que tout le monde s’y mette et qu’on soit tous sur la même longueur d’onde.
Faisons donc le travail chez nous sur le territoire français – il y a des instruments comme le parquet national financier qui sont prêts à le faire – mais soyons vigilants aussi, avec les armes qui sont les nôtres, au plan financier, juridique ou judiciaire, et rappelons aux hauts responsables, quels qu’ils soient, notamment à l’étranger, qu’il y a nécessité pour tous d’aller dans la même direction. Je sais que c’est là défendre une conception un peu idéale.
Laurent Cohen-Tanugi
Ce qui est intéressant, c’est que l’OCDE commence à s’intéresser au côté de la demande de corruption, c’est à dire aux corrompus. Jusqu’à présent, le problème de la corruption a été pris du côté des entreprises, des corrupteurs ; c’était le moyen le plus facile pour s’attaquer au problème.
Toutefois, aujourd’hui, l’OCDE a commencé à s’intéresser aux fonctionnaires étrangers demandant ou recevant des pots-de-vin. Comme cela touche les pays concernés, cela entrave les entreprises chinoises : les États-Unis y ont eu recours contre Huawei ; j’ai aussi souvenir d’une entreprise de télécoms russes qui a été sanctionnée, et même mise sous monitorship américain il y a quelques années.
Il est néanmoins souvent difficile de trouver des liens rattachant ces entreprises au sol américain.
Vous employez le terme de terreur pour parler des Américains. À défaut de les terroriser, pourrions-nous aussi les gêner et imposer nos règles pour qu’ils ne soient pas les maîtres absolus et qu’ils ne fassent pas ce qu’ils souhaitent ?
Jean-François Bohnert
Je peux répondre, sans trop en dire, car c’est une affaire en cours chez nous.J’ai actuellement sous notre férule une entreprise américaine qui est en indélicatesse par rapport aux règles sur la probité. On en a parlé avec les Américains, qui nous laissent faire. Pour le moment, on va voir, mais j’ai lancé plusieurs enquêtes qui sont encore dans leur phase initiale. Quoi qu’il en soit, dès lors que nous avons un critère de compétence, c’est-à-dire des points de rattachement avec le territoire français, je ne m’interdis pas d’aller m’intéresser à des entreprises américaines.
Regardez ce qu’il s’est passé lorsque nous avons traité au parquet national financier la fraude fiscale commise par McDonald : cette affaire s’est soldée par 1,245 milliard d’euros d’amende et de pénalités fiscales pour l’entreprise. À des étagements différents, certes – mais en tout cas nous étions compétents en France. Il y a donc des règles fiscales qui n’ont pas été respectées par une entreprise à ascendance américaine, quand bien même les sociétés qui auraient finalement été poursuivies et condamnées sont françaises.
Nicolas Dufourcq
La question des sanctions va se poser lorsque l’embrasement américano-chinois commencera vraiment.
Jean-François Bohnert
C’est le prochain enjeu.
Nicolas Dufourcq
Je peux vous dire que dans toutes les entreprises dans lesquelles on est investi, la question de la Chine se pose tous les matins. Vous avez de grandes entreprises qui ont déjà commencé à doubler leurs systèmes d’information pour avoir un système d’information occidental et un système d’information chinois. Il s’agit de couper l’entreprise en deux pour rester une multinationale en conservant des liens d’appartenance extrêmement ténus.
Est-ce que cela tiendra si les Américains imposent des sanctions secondaires pour les entreprises qui souhaitent commercer avec la Chine ? Ce scénario est possible : l’arsenal est disponible et nous ne sommes absolument pas préparés.
Jean-François Bohnert
La question va effectivement être celle-ci : est-ce que les Américains vont s’en prendre aux Chinois comme ils l’ont fait avec la France et l’Europe – notamment sur le sol africain ? Le problème, c’est que les Américains ont tendance à se désintéresser du continent africain, alors qu’il y a sous leurs yeux une mutation profonde. Il n’y a pas que la Russie, et il n’y a pas que Wagner ; et effectivement, il y a la Chine, comme on le disait tout à l’heure dans le cas de l’Algérie. Je l’ai vu aussi en me déplaçant là-bas, c’est évident.
Nicolas Dufourcq
On l’a vu avec STMicroelectronics, la grande puissance du conducteur européen ; elle vend des produits en Chine, elle y a même des implantations industrielles. Le licou se resserre constamment ; on a un certain nombre de machines qu’on ne peut plus envoyer en Chine à cause de leurs chipsets ; non pas que ceux-ci aient été faits par les Américains ; ils ont été développés en Europe, mais en utilisant des outils de design, des softwares américains.
Ceci date de septembre dernier ; de même, on ne peut plus exporter de machines ASML, ni de GPU Nvidia. On ne va plus pouvoir travailler avec la Chine qu’avec de la propriété intellectuelle 100 % française ou européenne. Le licou s’est donc resserré ces neuf derniers mois, avec une nouvelle règle tous les deux mois – la dernière concernait les machines ASML.
Les Chinois ont très fortement réagi ; ils ont dit « si vous en êtes arrivé là, c’est donc que c’est la guerre ». La situation est très préoccupante.
Laurent Cohen-Tanugi
Sur les entreprises chinoises en Afrique, l’une des difficultés, c’est qu’elles n’ont pas de lien de rattachement avec les États-Unis, donc on ne peut rien faire. Les entreprises chinoises se sont souvent retirées des bourses américaines pour éviter la compétence juridictionnelle des États-Unis.
Dans le cadre des sanctions contre la Russie à propos de l’Ukraine – un certain nombre d’entreprises françaises ont quitté la Russie, d’autres sont restées. Est ce qu’elles étaient motivées par le danger de sanctions américaines ? Qu’est ce qui a motivé certaines entreprises françaises à rester – ou d’autres à partir, comme Total ?
Nicolas Dufourcq
Total est au capital de Novatek, qui n’était pas sanctionné. Juridiquement, Total pouvait donc rester, mais il a fini par partir pour des raisons d’étouffement politique. Alors, pourquoi Novtaek n’a pas été sanctionné ? Pourquoi Rosatom non plus ? Il fournit quand même du nucléaire pour toute l’industrie européenne ; on rentre dans le détail des raisons pour lesquelles on choisit celui-ci, et non celui-là – et l’on n’est pas dans toutes les coulisses. Rosatom est fondamental pour l’industrie nucléaire américaine, ce qui explique qu’il n’ait pas été sanctionné.
Un point dont je me souviens, dans la veine de ce que nous disions : quand le Cloud Act est sorti, il a suscité un certain nombre d’articles de juristes, disant qu’il permettrait de fluidifier la relation judiciaire entre les parquets ; néanmoins, il ne peut être activé dans le cadre d’affaires judiciaires où il faut s’échanger des data. On ne peut donc pas parler de grandes oreilles américaines – au risque de rendre cela un peu sensationnel – il s’agit de collaboration judiciaire dans des cas très particuliers.
Jean-François Bohnert
C’est le cas, effectivement, étant observé qu’avec les États-Unis, on ne se dispense pas pour autant de passer par les fourches caudines des règles propres à l’entraide pénale internationale. Le Cloud Act est important, tout simplement parce que pour des questions de souveraineté nationale française, on est obligé de respecter les règles relatives à l’entraide, qui sont de véritables fourches caudines ; l’échange d’éléments de preuve est un exercice sous haute contrainte légale, même si parfois on aimerait que ce soit assoupli pour aller chercher ces éléments plus facilement ou pour pouvoir y procéder plus rapidement – c’est un filtre un peu contraignant par lequel nous sommes obligés de passer.
Mais ce filtre a aussi l’avantage de sauvegarder certains principes essentiels. Prenons par exemple l’affaire Airbus : dans le cadre du volet compliance, qui concernait la mise en conformité de la société via un programme confié pendant trois ans à l’AFA (Agence française anticorruption), c’est moi qui avait imposé aux Américains et aux Anglais le recours à l’AFA, pour éviter qu’à l’occasion du monitoring nos amis américains ne soient tentés d’aller chercher des informations qui n’auraient pas du tout relevé du monitoring anticorruption ni de la compliance, mais qui auraient pu intéresser d’autres niveaux d’intelligence économique. Le rôle du PNF aura donc aussi consisté à préserver la souveraineté économique française.
C’est le travail que nous faisons côté judiciaire, en collaboration avec Bercy – c’est un point de vigilance, et non de défiance vis-à-vis des américains. Il s’agit simplement de dire : nous avons aussi un niveau de souveraineté française à respecter et à faire respecter à l’étranger.
Pourquoi la loi de blocage ne fonctionne pas et n’a jamais été efficace ?
Jean-François Bohnert
Parce que le niveau de sanctions est relativement faible, il faut le reconnaître. Si vous prenez les dispositions de la loi du 26 juillet 1968, c’est une loi qui interdit aux entreprises françaises de divulguer à l’étranger – quel que soit le motif de la demande qui leur est adressée – des informations qui seraient susceptibles de mettre en cause fois la souveraineté et le bon fonctionnement de l’entreprise, mais, plus largement, qui porteraient atteinte aux intérêts supérieurs de la France, notamment en termes de souveraineté économique, financière et industrielle.
Cette interdiction qui est faite, et qui s’adresse d’ailleurs aussi aux autorités judiciaires, par exemple dans le cadre de l’entraide pénale internationale, est sanctionnée par un niveau d’emprisonnement et d’amende relativement dérisoire, à côté de ce que l’entreprise risquerait aux États-Unis. Mais en cas de violation de ces interdictions, la loi du 26 juillet 1968 ne prévoit que des sanctions peu dissuasives : les peines maximales encourues sont de 6 mois d’emprisonnement et/ou 18 000 euros d’amende pour les personnes physiques, et 90 000 euros d’amende pour les personnes morales.
Faut-il donc augmenter les sanctions ?
Laurent Cohen-Tanugi
Je ne le pense pas, parce qu’on place alors les entreprises entre le marteau et l’enclume. Ce qui a été mis en place avec le SISSE dernièrement, à savoir un guichet unique à Bercy qui filtre l’information et conseille les entreprises, me paraît utile. Mais interdire systématiquement aux entreprises francaises de communiquer des informations à des juridictions ou des agences étrangères, c’est très dangereux pour elles.
Nicolas Dufourcq
Il ne faut pas oublier qu’on est une économie qui représente un dixième de l’économie américaine. Beaucoup d’entreprises européennes considèrent qu’il est plus important d’être américain que français.
Quel est le poids de l’empire de la norme, du soft power européen par rapport au hard power américain ? Faisons-nous le poids sans être une puissance militaire, et sans non plus être une vraie puissance diplomatique ?
Laurent Cohen-Tanugi
Dans certains domaines, oui. C’est le cas du RGPD. Meta, la société-mère de Facebook, a par exemple été condamnée pour violation du RGPD : ce n’est donc pas que du soft power, il commence à y avoir du hard power. On a certes du retard, mais c’est aussi parce que l’Europe n’est pas un État, jouissant d’une unité politique.

