La France en Orient : entre alliances et ingérence
Au fil des siècles, la diplomatie orientale de la France constitue ainsi le reflet des tendances et des développements en cours sur la scène politique intérieure. Pour Jean-François Figeac, l’Orient a été et continue d’être un « instrument de politisation français ». Gabriel Rousset a lu son dernier livre, La France et l'Orient.
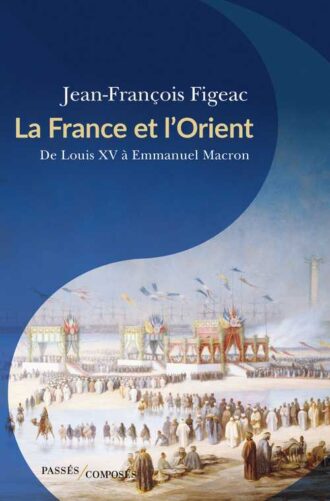
Comment se définit la politique orientale de la France ? En quoi les liens entretenus par ce pays avec l’Orient sont-ils spéciaux voire privilégiés ? Pour répondre à ces questions, Jean-François Figeac appréhende les évolutions de la politique orientale de la France sur trois siècles, invitant à prendre la mesure de ses nombreuses ruptures et de sa complexité. Pour lui, la politique contemporaine de la France en Orient ne peut être considérée comme un seul et même héritage multiséculaire. Au contraire, elle s’inscrit dans une trajectoire ayant parfois manqué de cohérence et est influencée par l’imbrication complexe de puissances tierces. Il interroge notre rapport au monde oriental par le biais d’une analyse des connexions entre opinion publique et diplomatie, au prisme de dynamiques géopolitiques en mutation constante. Par l’étude de cette « psychologie collective », il entend également déconstruire la part de mythe dans la conception des rapports souvent idéalisés entre la France et l’Orient. Notons que sa conception de « l’Orient », large, s’étend du Maghreb à la Turquie, en passant par Israël et les pays du Golfe.
D’un rapprochement timide aux mandats français
Longtemps, la politique de la France en Orient est instable, du fait des velléités récurrentes des rois chrétiens dues au « devoir de croisade », très ancré dans la culture populaire, qui empêche une alliance pérenne pragmatique avec les Turcs. Il faut attendre Vergennes — ministre sous Louis XVI — pour que soit défini pour la première fois un cadre à la stratégie française en Orient. Perçu par l’opinion publique comme très affaibli, l’Empire ottoman devient progressivement la cible de projets interventionnistes conçus par des diplomates et orientalistes français tels que François de Tott et Volney. Ceux-ci se prononcent en faveur d’un démantèlement de l’Empire, duquel la France tirerait un renforcement de ses points de contrôles commerciaux en Égypte et en Syrie. La Révolution française met un coup d’arrêt à ces ambitions et fait du maintien de la « Sublime porte » une condition de l’équilibre européen. On observe à la fin du XVIIe siècle les prémisses d’une stratégie d’influence d’ordre politique qui se manifeste par un soutien aux réformes administratives et militaires du sultan Selim III ou encore par la création en 1795 de l’École spéciale des langues orientales sous l’impulsion de Joseph Lakanal.
La conquête menée par Bonaparte en Égypte dès 1798 fait entrer une réalité orientale concrète dans le quotidien de l’opinion publique française jusqu’alors bercée par un imaginaire de l’Orient fantasmé. L’ensemble des crises ayant lieu dans la région de 1798 à 1860 sont très suivies depuis la France. Malgré le revers décisif en septembre 1801 lors du siège d’Alexandrie, la campagne d’Égypte est perçue comme le triomphe d’une France émancipatrice et victorieuse au Levant. Ce mythe constitue le socle de l’opinion publique sur la « question d’Orient » (concept théorisé par Adrien Féline) jusqu’à la IIIe République. Durant la première moitié du XIXe, les écrits de Chateaubriand, Pouqueville ou encore Lamartine permettent à l’opinion publique lettrée de connaître précisément le contexte politique en Orient. Majoritairement philhellène, l’opinion française se montre alors très critique à l’égard de l’Empire ottoman. Parallèlement, elle voue une admiration à Méhémet Ali qui fait figure de héros occidentalisé émancipé du pouvoir ottoman en Égypte. À partir des années 1830, celui-ci devient un véritable allié de la France. Sur le plan intérieur, la guerre de Crimée constitue quant à elle un moyen pour le Second Empire d’unir l’opinion publique autour des succès de son armée, faisant ainsi d’une crise orientale un catalyseur du nationalisme français.
Les crises de la première moitié du XIXe siècle font prendre conscience aux élites françaises que pour gagner en efficacité, la diplomatie de la France se doit d’être plus pragmatique et de se détacher de l’idéal du lointain Orient fantasmé. Au lendemain de l’expédition française au Liban (1860-1861), cette diplomatie s’accompagne de stratégies d’influence culturelle qui tendent à se rapprocher du soft power contemporain 1. En plus d’assurer un rôle de médiateur pour les crises régionales, la France remplit les fonctions d’une puissance modernisatrice en Orient. La guerre contre la Prusse et la chute de Napoléon III mettent fin au rapprochement diplomatique initié avec les Ottomans. Ces deux événements ouvrent une période de déclin de l’influence française en Orient que l’auteur nomme le « cycle du désenchantement ». Il faut attendre le début du XXe siècle pour que l’influence politique de la France en Orient trouve un nouveau souffle et se démarque de celles de ses rivaux européens. À la veille de la Première Guerre mondiale, les diplomates français font le choix de soutenir le nationalisme arabe en Syrie et au Liban, anticipant ainsi le démantèlement de l’empire ottoman et la création des mandats au Levant.
Au début des années 1920, la France se heurte à des difficultés pour faire accepter sa présence mandataire au Levant, d’autant que les chrétiens du Liban pèsent de moins en moins face aux musulmans et que la révolte arabe des Hachémites menée par Fayçal jusqu’en Syrie y est très populaire. Tout au long de la décennie 1920, l’opinion publique française se montre par ailleurs très concernée à l’égard de la protection des minorités maronite, druze et alaouite du Levant. Les limites de l’administration mandataire se cristallisent dans la grande révolte syrienne (1925-1927) qui éclate notamment en réponse au mépris des spécificités du mandat syrien pour lequel les administrateurs français appliquent les mêmes politiques que dans les autres colonies. Encore une fois, la France s’entête dans un imaginaire collectif qui ne colle pas à la réalité. Hors des mandats levantins, on observe dans les années 1930 un réchauffement des relations entre la France et la Turquie kémaliste, très apprécié par l’opinion publique française. Dans le même temps s’opère un rapprochement similaire avec l’Égypte. Ces deux mouvements simultanés correspondent encore une fois à la volonté d’affaiblir les influences allemande et britannique au Proche-Orient dans l’espoir d’y asseoir une emprise française considérée comme stratégique et décisive lorsqu’éclate la Seconde guerre mondiale.
Une position redéfinie par les indépendances
Au sortir de celle-ci, dans le contexte de l’inévitable indépendance syrienne puis de la nationalisation du canal de Suez, la France scelle définitivement son passage d’une diplomatie de hard power héritée du colonialisme et de l’impérialisme à une diplomatie d’influence exclusivement axée sur le soft power. Elle se voit petit à petit contrainte d’adopter en Orient une posture en retrait. Au lendemain de la période mandataire, l’opinion publique prend conscience qu’elle devient désormais spectatrice de l’affrontement des blocs américain et soviétique dominant l’échiquier mondial. Cela ne signifie pas pour autant qu’elle se désintéresse tout à fait des dynamiques orientales, comme le montre son clivage dans les débats sur la question sioniste au moment de la création de l’État d’Israël. À son retour au pouvoir en 1958, Charles de Gaulle fait du renouvellement de l’influence française en Orient une priorité. Après une décennie de refroidissement diplomatique, c’est à partir des accords d’Évian (1962) que la France parvient à rétablir progressivement ses relations avec l’ensemble des pays arabes. Concernant Israël, le général perpétue avec force le soutien français à l’État hébreu jusqu’en 1967. Le tournant radical opéré au lendemain de la guerre des Six jours divise jusque dans les rangs gaullistes. À gauche comme à droite, l’opinion publique se montre alors majoritairement pro-sioniste, ce qui explique les critiques quant au choix de De Gaulle de condamner l’occupation des territoires nouvellement conquis par l’armée israélienne. Dans le monde arabe, cette position permet parallèlement à la France d’infléchir sa volonté de transition vers le statut d’une puissance d’influence en y acquérant une aura de prestige.
L’héritage des années De Gaulle se manifeste dans la continuation d’une politique arabe guidée par des considérations d’ordre purement pragmatiques, dans le sens d’un réchauffement des liens avec les États arabes. À cet égard, un rapprochement avec la Libye de Kadhafi est notamment opéré par Georges Pompidou tandis que Valéry Giscard d’Estaing entreprend de lancer un dialogue avec Yasser Arafat et l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) tout en veillant au renforcement des relations avec l’Égypte et le Liban — dans un fragile jeu d’équilibre avec la Syrie occupante d’Hafez al-Assad. Enfin, la normalisation des relations avec les anciennes colonies mène Giscard à rétablir des liens avec le Maroc, l’Algérie et la Tunisie. Les postures arabophiles de Pompidou et Giscard ont permis à la France d’avancer ses pions dans les monarchies du Golfe nouvellement indépendantes et d’y promouvoir ses intérêts au moment de la crise pétrolière de 1973. Toutefois, Jean-François Figeac rappelle qu’une grande partie de l’opinion publique demeure résolument pro-sioniste et désapprouve les choix diplomatiques de l’après-1967. À son arrivée au pouvoir, François Mitterrand renforce les liens entretenus avec l’OLP tout en favorisant le dialogue avec Israël. Malgré ses efforts, l’influence française au Moyen-Orient s’effrite au profit de celle des Américains. Le choix de s’engager dans la guerre du Golfe contre l’ancien allié Saddam Hussein aux côtés des États-Unis résulte en partie du constat que la France ne peut plus se permettre de faire cavalier seul si elle souhaite conserver le contrôle sur ses intérêts dans la région. À la fin des années 1990, Jacques Chirac ravive l’héritage gaullien et encourage une diplomatie de l’aura en réaffirmant son respect de la souveraineté des principaux partenaires arabes (Liban, Égypte ou encore Irak) ainsi que par son soutien ostensible au peuple palestinien. Selon l’auteur, les années Chirac constituent l’apogée de l’aura française au sein du monde arabe.
À partir de 2007, Jean-François Figeac estime que la politique orientale de la France ne s’inscrit plus dans une vision d’ensemble cohérente. Nicolas Sarkozy mise au début de son mandat sur la valorisation du sentiment méditerranéen commun à la France et aux pays arabes en lançant l’Union pour la Méditerranée. Mais les Printemps arabes de 2011 initient un cycle de crises qui déstabilisent l’ensemble de la région. L’intervention française en Libye marque un tournant caractérisé par l’application du concept néo-conservateur de « droit à l’ingérence » et le désaveu des régimes autoritaires. Le mandat de François Hollande est quant à lui marqué par la crise syrienne qui rencontre au sein de l’opinion publique un fort écho émotionnel suite aux attentats de 2015. Durant cette période, l’influence française dans la région est au plus mal, y compris dans des pays traditionnellement francophiles comme le Liban. C’est ce qui motive à présent Emmanuel Macron à sortir la France de son isolement au Moyen-Orient en misant sur l’ouverture d’un dialogue de médiateur « autant avec la Jordanie, l’Égypte et les pays du Golfe, qu’avec l’Irak et l’Iran ».
Au fil des siècles, la diplomatie orientale de la France constitue ainsi le reflet des tendances et des développements en cours sur la scène politique intérieure. Ce qui fait dire à Jean-François Figeac que l’Orient a été et continue d’être un « instrument de politisation français ».

