La traîne des empires
Islam, christianisme et bouddhisme représentent aujourd’hui environ 4,8 milliards d’humains — ce sont des créations d’empires. Pourtant, selon Gabriel Martinez-Gros les trois religions milliardaires se cristallisent précisément lorsque l’impuissance croissante des empires dissocie leur action politique de leur système de valeurs. Nous l'avons rencontré à l'occasion de la sortie de son livre La traîne des empires chez Passés composés.
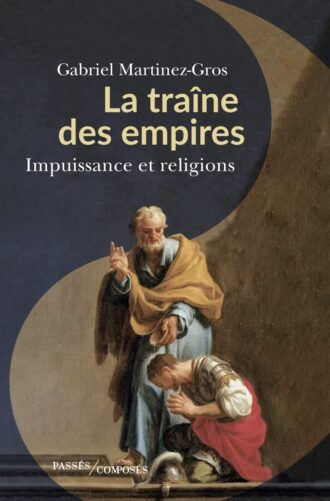
Que recouvre cette expression assez mystérieuse qui donne son titre à votre dernier livre, La Traîne des empires ?
C’est une manière de dire que les religions sont les suites, les conséquences inévitables même, des empires, qu’elles maintiennent par d’autres moyens les buts, les objectifs, les pratiques fondamentales des empires. Autrement dit, les religions continuent de porter les valeurs impériales, parmi lesquelles les plus importantes sont sans doute la pacification interne et une forme d’universalisme.
La Traîne des empires s’inscrit dans le prolongement de votre Brève histoire des empires (2014) et de Fascination du djihad (2016). Ces œuvres, nourries par votre travail sur Ibn Khaldûn, se situent-elles plutôt du côté de la philosophie de l’histoire ou de l’histoire à proprement parler ? Distinguez-vous ces deux catégories dans votre travail ?
Je ne pense pas vraiment en fonction de ces distinctions. Je pense simplement que pour comprendre ce que recouvrait le phénomène impérial, il m’a fallu élargir considérablement le champ de l’enquête en essayant de comparer des espaces et des civilisations qui en général sont étudiées séparément. Cela n’était pas aisé : si je suis plutôt à l’aise avec le monde occidental ou l’islam, je le suis beaucoup moins lorsqu’il s’agit de la Chine, qu’il fallait absolument traiter.
Mais c’est la réunion ou la comparaison de ces trois empires fondamentaux, Rome, l’islam et la Chine, qui m’a donné l’idée de cette traîne religieuse des empires. Inversement, c’est aussi cette idée qui m’a permis de mieux déterminer ce que c’est qu’un empire. Si j’ose dire, c’est lorsque se lève la chouette de Minerve, au terme de cette enquête de presque dix ans, que je suis parvenu à la meilleure définition : un empire s’achève par une grande religion.
C’est l’une des définitions possibles de l’empire et l’une de celles que jusqu’à présent je n’avais pas avancées. Cela me permet par exemple de répondre assez aisément maintenant à ceux qui me demandent si je considère l’empire aztèque, l’empire du Mali ou, géographiquement plus proche de nous, l’empire allemand comme des empires. La plupart de ces phénomènes historiques ne sont pas des empires au sens où je l’entends. Quelques-uns d’entre eux — l’empire ottoman, l’empire mongol — sont des rejets d’empires. D’autres — l’empire allemand ou l’empire russe — portent des noms d’empires, parce qu’ils se réfèrent toujours à l’empire romain, qui fut pleinement un empire dont la traîne fut le christianisme. Le même modèle s’applique à l’empire chinois qui affirme l’emprise du bouddhisme sur toute l’Asie à partir du IIIe siècle, alors même que celui-ci était né en Inde. L’empire islamique s’inscrit dans le même modèle : c’est lui qui donne véritablement naissance à la religion musulmane, et non l’inverse.
Votre livre est centré sur trois religions : le bouddhisme, le christianisme et l’islam. Vous justifiez ce choix car ce sont les trois religions les plus répandues du monde. Ce critère est-il suffisant pour engager une analyse comparative ? N’est-il pas trop téléologique ?
Si l’on excepte l’hindouisme — et l’athéisme, que l’on ne peut pas exactement compter comme une religion — ces trois grandes religions sont presque les seules à être pratiquées dans le monde aujourd’hui, ce qui permet, me semble-t-il, d’en faire une catégorie pertinente. C’est simplement une preuve par neuf. Je veux dire par là que les religions au total prouvent l’existence d’une spécificité des empires. L’étude de leur traîne religieuse vient simplement confirmer la définition des empires sur laquelle j’ai travaillé dans mes livres précédents.
Et quelle place donnez-vous à l’hindouisme ? Pourquoi ne pas l’intégrer à votre modèle ?
Je pense que, si on le considère au prisme de mon modèle, l’hindouisme justifie la vision générale des grandes religions comme traîne des empires. De fait, ce n’est qu’aux XIXe et XXe siècles que s’établit une religion hindouiste qui rassemble des centaines de sectes, de castes, de pratiques sous le British Raj, c’est-à-dire l’occupation britannique. Autrement dit, l’hindouisme est la traîne lointaine d’un empire qui a considérablement évolué dans le temps : d’abord l’empire moghol, musulman ; puis l’empire britannique qui s’est inscrit dans les cadres constitués par son prédécesseur. Et c’est dans cette dernière incarnation impériale que l’hindouisme, qui était la religion de la grande majorité du peuple dominé par ces empires musulman et britannique, émerge. Contrairement à ce qu’affirme Narendra Modi, l’hindouisme n’est pas la preuve que l’Inde moderne aurait des racines antiques. Cette religion naît à la suite des empires qui ont marqué l’histoire de l’Inde du XVIe au XXe siècles.
Vous argumentez que les religions universelles prennent le relais des empires, en conservant leurs « valeurs sédentaires », lorsque les peuples fondateurs d’empires — Romains, Chinois, Arabes — commencent à être dominés par les combattants issus de leurs marches. En somme, pour vous, ce que nous appelons des valeurs religieuses sont en réalité des valeurs sédentaires. Mais cela n’exclut-il pas toute la part transcendante de ces religions ? Qu’y a-t-il de « sédentaire » dans la parole du Christ ou dans les paroles divines rapportées par Mahomet ? Est-ce qu’il n’y a pas une tension qui se joue de ce côté-là, entre les « fondateurs » et leurs religions ?
D’une part, je ne fais pas de théologie. En tant qu’historien, j’essaye de discerner simplement les contours extérieurs des religions et ce qu’elles ont en commun. Si on adopte une posture internaliste, qui est celle de la théologie, la réponse est simple : elles ont très peu en commun puisque chacune de ces religions disqualifie les autres comme des ébauches imparfaites de la vérité qu’elle propose elle-même. C’est aussi pour cela que les religions se donnent des origines qui ne sont pas décisives à mes yeux d’historien : je veux dire que le christianisme naît au IIIe siècle et non pas avec le Christ ; l’islam sunnite au XIe-XIIe siècles et pas avec Mohammad. Dans L’Empire islamique, j’essayais précisément de démontrer que le sunnisme était né dans un milieu sédentaire. C’est à Bagdad au IXe siècle, que les premiers groupes d’oulémas commencent à constituer, non pas les armes à la main, mais le sermon à la bouche, et le peuple derrière eux, un espace complètement désarmé qui vient s’opposer à la puissance militaire de l’empire.
C’est à partir de là, et assez tardivement, que le sunnisme, plutôt que de prendre les armes, reconnaîtra le pouvoir des Turcs ou celui des Berbères à partir du XIe siècle. Dans les faits, ces nouvelles puissances renversent définitivement le califat arabe. Et je pense que la raison pour laquelle les autorités sunnites reconnaissent ces pouvoirs c’est qu’ils sont profondément illégitimes, ce qui permet aux autorités religieuses de conserver toute la légitimité de l’ancien pouvoir impérial. C’est ce que j’ai appelé « le pacte sunnite », c’est-à-dire que le sunnisme reconnaît précisément un pouvoir qui n’est pas califat, tout en ayant une attitude extrêmement distante sinon conflictuelle avec le pouvoir. Incidemment, c’est tout le contraire de ce que croient les jihadistes contemporains qui entendent rétablir le califat.
Renversons la question. Dans votre modèle, les fondateurs des religions viennent toujours des marges de l’empire, tout comme les pouvoirs tribaux qui finissent par s’imposer aux populations sédentarisées. Faut-il nécessairement être éloigné du centre pour réussir à le conquérir ? Et cet éloignement du centre participe-t-il de la construction de ces religions ? Dans le cas du christianisme par exemple, l’itinéraire d’une secte juive née en Palestine jusqu’à Rome participe-t-il de la construction de son universalisme ?
J’avoue que j’ai peu étudié cette question, même si je crois en effet qu’elle est importante. Je peux néanmoins essayer de vous répondre en disant ceci : je crois très profondément que le milieu dans lequel le christianisme a réussi à triompher est profondément un milieu impérial. Pour être encore plus précis, et comme le montre Peter Brown, il se constitue d’abord dans les marges des grandes villes impériales, comme Rome ou Lyon. En parlant de cette dernière, ville centrale dans la Gaule romaine, je pense bien sûr à Irénée : c’est un Grec, totalement étranger à la ville dans laquelle il va fonder la première communauté chrétienne. Cette rencontre-là n’est possible que dans un espace aussi gigantesque que l’empire. Mais sa mutation en religion implique une méditation sur l’échec, qui constitue une analogie entre la petitesse de l’homme et la petitesse de l’empire, au moment où celui-ci rencontre ses limites — autrement dit, au moment où les rendements impériaux deviennent trop décroissants pour que cette structure puisse se soutenir. Ce qui est frappant à ce moment-là dans la constitution de ces religions qui prennent le relais de l’empire, c’est que ces hommes qui y sont nés, occupant parfois le sommet de sa hiérarchie intellectuelle, vont chercher des réponses à leurs questions dans des systèmes élaborés au sein des marges les plus méprisées de l’empire.
Cette soudaine exaltation de la marge, c’est d’abord le signe de l’échec de l’empire. C’est ainsi que je comprends les religions. Elles partagent les mêmes valeurs que les empires qui les ont précédées. Mais celles-ci sont en échec, ce qui inspire une méditation qui constitue le cœur de la prédication religieuse.
Cette analyse me pousse à me demander si une nouvelle religion émerge aujourd’hui. Après avoir connu des succès éclatants pendant les deux derniers siècles et demi, notre monde commence à faiblir et à éprouver le sentiment de l’échec et de l’impuissance. Je crois en effet que la crise de modèle que nous traversons se traduit par un changement de paradigme dans la conception de la politique. Depuis deux siècles et demi, celle-ci était orientée par des objectifs que les décideurs donnaient aux sociétés. Si proche du discours religieux qu’ait pu être, par moments, le discours soviétique, il n’en demeure pas moins qu’en 1957, Khrouchtchev affirmait devant le Politburo que, trente ans plus tard, l’URSS aurait dépassé les États-Unis. Voilà une promesse portée par une claire limite temporelle, et elle est politique et non religieuse. Quelques décennies plus tard, il apparaît clairement qu’elle n’a pas abouti et que l’État soviétique a failli. Par conséquent, la promesse se retourne contre le régime qui l’a faite et qui n’a pas réussi à la tenir. En ce sens, le communisme soviétique s’est placé non pas dans la position d’une religion mais dans la position d’un projet politique falsifiable, dont l’échec aboutit à sa chute.
Une religion n’a pas ce problème puisqu’elle naît précisément d’un échec impérial dont elle va porter, des siècles durant, la traîne : quinze siècles, par exemple, pour l’Église catholique qui porte l’échec de l’empire romain. « Le silence de ces espaces infinis m’effraie » de Pascal ne dit pas autre chose dans le siècle qui découvre l’infinitude de l’univers et, en même temps, son silence, qui accroît le sentiment de la petitesse de l’homme.
Dans Escape from Rome : The Failure of Empire and the Road to Prosperity (2019), Walter Scheidel réfléchissait à l’importance de la disparition de l’Empire romain d’Occident dans le développement subséquent de l’Europe de l’Ouest. Qu’en pensez-vous ? Les empires finissent-ils toujours par devenir un frein au développement, que celui-ci soit religieux ou économique ?
Je ne sais pas si cette analyse peut être étendue à tous les empires. Dans le cas de de l’Occident, l’empire ne s’est jamais reconstitué. C’est ce que ce que j’avais déjà essayé de dire dans Une brève histoire des Empires. L’une des grandes caractéristiques de l’Occident, c’est la disparition de l’empire, en deux temps : d’abord, l’incapacité de Justinien à reconstituer le Mare Nostrum ; puis l’invasion islamique qui a définitivement écarté la possibilité pour l’empire romain, maintenu sous la forme de l’empire byzantin, de reconstituer son hégémonie au moment où l’empire islamique retrouve le territoire de l’empire d’Alexandre ou de l’empire achéménide. Bref, en Occident, seule l’Église maintient la mémoire de l’empire et, dans une certaine mesure, ses pratiques, ce qui lui donne une capacité d’action absolument extraordinaire. La réforme grégorienne ou les guerres de religion m’apparaissent du reste comme les moments où l’Église a été la plus proche de reconstituer cette unité impériale perdue. Mais son développement était inséparable de la disparition de l’empire romain. Inversement, lorsqu’on considère des résurgences impériales réussies, dans le monde chinois ou islamique, on se rend compte que très vite les religions universelles y représentent un problème.
Donc non seulement la religion naîtrait de l’échec impérial, mais les empires seraient incompatibles avec le fait religieux qu’ils ont enfanté ? Pourquoi ?
Pour comprendre cette incompatibilité, il faut revenir aux causes de l’échec des empires et je crois paradoxalement qu’au moment où cela advient, c’est qu’ils ont réussi. Là c’est la théorie d’Ibn Khaldoun qu’il faut de nouveau convoquer. Pour lui, il y a des petites entités qui sont naturelles pour organiser les communautés humaines. La solidarité y est très forte, comme c’est le cas dans les familles, les clans ou les tribus. Mais leurs capacités productives sont très minces et leurs échanges sont presque nuls, précisément parce que leur grande solidarité fait qu’elles regardent tout ce qui est extérieur à leur existence comme étranger, voire hostile.
Si vous voulez aller au-delà, si vous voulez à la fois amener plus de prospérité et plus d’échanges en élargissant les horizons économiques, il vous faut constituer une entité artificielle, l’empire, dont la fonction est de désarmer les populations — de les désolidariser — pour permettre la synergie du travail et la levée de l’impôt, c’est-à-dire la mobilisation du capital et, à partir de celle-ci, une énorme contrepartie productive : la création de nouveaux métiers et de nouvelles techniques. C’est ce qui permet l’enclenchement d’une spirale de prospérité. Mais pour y parvenir, les populations qui occupent le cœur de l’empire doivent être totalement pacifiées, et l’empire doit créer des relations avec ses marges pour trouver des groupes qui ont conservé des solidarités traditionnelles et qui peuvent donc combattre pour lui. Généralement, ces groupes finissent par prendre le pouvoir.
C’est là qu’émerge une contradiction fondamentale du gouvernement impérial : ceux qui exercent le pouvoir, et qui, pour ce faire, recourent à la violence, agissent en fonction d’une éthique qui n’est pas celle de l’immense majorité de la population sédentaire qu’ils administrent. La seconde est pacifique, attachée aux gestes techniques, à l’amélioration des conditions de la vie quotidienne, à l’obéissance aux lois, et à l’éducation. Les premiers sont solidaires et brutaux, pour le dire très rapidement. Il y a donc une distance considérable entre ces deux parts, qui sont toutes deux nécessaires à la société impériale.
Il y a une deuxième contradiction, qui est encore plus fondamentale pour comprendre les raisons de l’échec de l’empire. Le désarmement de l’immense majorité des sédentaires a plusieurs conséquences. D’abord, les populations s’accroissent. Ensuite, dans la mesure où ces groupes sont toujours plus incapables de se défendre et de de s’entraider fait que toute la charge de la société retombe sur l’empire, généralement sous la forme d’une charge financière écrasante qu’il n’arrive plus à soutenir, même en augmentant la charge fiscale. La plupart des empires disparaissent à cause de crises financières qui sont le résultat du dessaisissement par l’empire de l’autonomie de ses sujets. La conséquence ultime c’est qu’au moment où l’empire est existentiellement menacé, il n’a plus personne à mobiliser sur son territoire. Mais c’est aussi à ce moment-là qu’émergent les religions.
Vous admettez que votre modèle est en partie remis en question par la période qui va de la Révolution américaine jusqu’au début du XXIe siècle. Pourriez-vous nous expliquer pourquoi ?
On peut même remonter un peu en amont, à la « Glorieuse Révolution ». C’est à ce moment-là que la chrétienté se disloque véritablement, confirmant ce que les traités de Westphalie avaient déjà signifié quarante ans plus tôt. À ce moment-là, la traîne de l’empire romain s’estompe lorsque l’État-nation émerge. Nombre d’entre eux vont chercher à constituer des empires coloniaux qui s’inscrivent mal dans le principe impérial tel qu’Ibn Khaldoun le définit, c’est-à-dire la division de la population entre une immense majorité assignée aux tâches productives qui recherche le perfectionnement de l’homme et une petite minorité qui assume les fonctions de violence. Autrement dit, vous avez d’un côté ceux qui préparent la prospérité, et de l’autre ceux qui assument les conditions politiques et militaires de la prospérité simplement. Si les deux se confondent et que les mêmes personnes assument à la fois la fonction de prospérité et la fonction militaire, comme ce fut le cas dans le système colonial européen, alors ce n’est pas véritablement un empire.
Mais n’est-ce pas une définition extrêmement restreinte de l’empire ? Ne pourrait-on dire au contraire que les États-nations européens émergent véritablement au moment de la décolonisation ?
Je ne le pense pas. Pour que l’empire colonial français ait été un empire au sens où je l’entends, il aurait fallu que les grands centres producteurs de l’empire se situent au Maghreb ou en Afrique subsaharienne, tandis que les Français auraient assumé la fonction de violence. Ou, inversement, il aurait fallu que la métropole soit le principal espace productif de l’empire, mais que règne sur l’empire français un général issu des troupes coloniales. Or, pendant la période coloniale, l’essentiel de la richesse était produite en France, tout comme la fonction de violence était assurée par des métropolitains ou des Européens qui leur étaient associés.
Dans le cas de l’empire britannique, le modèle fonctionne mieux si l’on accepte de renverser la perspective en considérant que son centre ne se trouve pas en Grande-Bretagne, mais en Inde. Cette réalité va sans doute s’affirmer maintenant que le pays a quitté l’Union européenne : le Royaume-Uni va retrouver sa dimension impériale en s’installant comme une périphérie de l’empire indien. Je doute que c’était à cette résurgence impériale que rêvaient les promoteurs du Brexit.
Si l’on remonte dans le temps, il me semble que l’expansion coloniale ibérique cadre mieux avec de modèle impérial. Si l’on conçoit que le centre de l’empire espagnol est Mexico et pas Tolède, alors cela fonctionne assez bien. De fait, Mexico est une ville comme il n’en existe pas en Europe. Entre 1492 et 1535, jusqu’à la conquête du Pérou, les Espagnols s’emparent de territoires colossaux et imposent leur domination à une population cinq fois plus importante que la population espagnole (30 millions contre 6 millions à peu près). Quoi qu’il en soit, le rapport entre la fonction productive et la fonction militaire correspond assez bien au modèle impérial : les Amérindiens, sédentarisés, désarmés et dominés, assument la première tandis que les seconds exercent la violence. Simplement, les rois d’Espagne ne sont pas allés au bout du processus, qui aurait induit de déplacer la capitale de l’empire au Mexique car les intérêts américains ne prennent jamais la préséance sur les intérêts européens de la couronne espagnole.
Quelle place donnez-vous à l’héritage impérial dans la construction de l’Union européenne et dans l’évolution des États-Unis contemporains ?
C’est assez complexe. L’Union européenne me semble mélanger deux dimensions, religieuse et impériale, qui ont en commun de vouloir dépasser le seul mode d’organisation que nous connaissons depuis deux siècles et demi, c’est-à-dire l’État-nation. De ce point de vue, la différence entre les États-Unis et l’Europe est importante. Celle-ci exerce un pouvoir qui est profondément religieux en exerçant un magistère moral et juridique. Son pouvoir est essentiellement un pouvoir du dire.
Malgré, la puissance globale qu’exerce les États-Unis, le pays demeure, aux yeux de nombre d’Américains, un État-nation. C’est même l’une des principales lignes de fracture aujourd’hui entre une portion importante du Parti républicain et leurs adversaires. Pour Trump et ses soutiens, la meilleure façon de make America great again c’est l’isolationnisme, c’est justement de couper avec toute tentation impériale. De ce point de vue, Trump renonce complètement à ce pouvoir du dire qui caractérise les empires, et après eux les religions. Il ne prétend exercer aucune forme de souveraineté globale. La seule cohérence qui prévaut revient, au cas par cas, à traiter avec des interlocuteurs ou à affronter des adversaires sur la base d’une conception très restrictive de l’intérêt national américain. Les adversaires de cette ligne considèrent au contraire que les États-Unis ne peuvent abandonner leurs prétentions globales, qui passent par une capacité de projection impériale, mais aussi par un pouvoir de dire le bien et le mal — et d’imposer cette lecture bien sûr. Mais cette vocation n’est pas du tout une évidence pour la totalité des Américains. Il n’est pas certain que leur empire ait un avenir, ou que les États-Unis continuent de revendiquer une supériorité morale qui justifierait leur interventionnisme. En ce sens, la ligne de Samuel Huntington s’est largement imposée au sein du Parti républicain : en 2003, il s’opposait à la guerre en Irak en considérant que c’était une erreur fondamentale de vouloir imposer à des populations arabes des valeurs qui, essentiellement, n’étaient pas les leurs. C’est le contraire de la pensée impériale.
Votre modèle interprétatif est ancré dans une conception très cyclique de l’histoire qui permet des rapprochements et des analogies souvent stimulantes. Mais à trop chercher les récurrences ne risque-t-on pas d’être aveugles aux ruptures ou les nouveautés ? Je pense notamment aux critiques que Philippe Ariès ou Friedrich Hayek adressait à l’historicisme, entendu comme la recherche dans le passé de lois immuables qui permettraient de saisir la raison profonde des sociétés humaines, passées, présentes et futures ?
C’est une critique qu’on peut parfaitement entendre, que tout historien, en réalité, peut entendre parce que nous avons toujours été mis en garde contre des rapprochements trop brutaux. Et en effet, ils risquent de manquer ce que l’histoire a de très profondément d’imprévisible et de très profondément événementiel. À trop multiplier les structures, on risque de négliger la chair de l’histoire, tout simplement. Je ne néglige pas du tout la critique. Mais à l’inverse, dès que vous essayez de théoriser, ce que les historiens font trop peu à mon avis, vous prêtez le flanc à cette critique.
Ceci dit, et contrairement à ce qui a pu m’être reproché, je ne cherche pas du tout à écrire une histoire de l’humanité — qui serait une tentative de théorisation du devenir humain. C’est que je suis complètement d’accord avec Levi-Strauss, qui n’était pas nécessairement l’homme le plus tendre avec les historiens, lorsqu’il faisait remarquer que l’essentiel de l’aventure humaine, depuis l’émergence d’homo sapiens, nous échappe. L’immense majorité des sociétés humaines ont disparu en ne laissant pas ou peu de traces — sans parler des traces qui sont difficiles, voire impossibles à interpréter. Et je suis bien conscient que le modèle que je propose, centré sur un mode d’organisation très particulier — l’empire — ne couvre qu’une part infime de l’histoire de l’humanité qui s’ouvre entre le VIIIe et le Ve siècles avant notre ère, c’est-dire entre l’exil à Babylone et l’affirmation, aux marges de l’empire perse, du monde grec. Et même là, je suis le premier à dire que mon modèle a des limites évidentes : en Occident par exemple, le schéma khaldounien fonctionne très mal avant le XVe siècle.
Je détesterais, en somme, que l’on pense que je conçois l’histoire comme un mécanisme.

