Syrie, le pays brûlé
Contre le négationnisme, la banalisation, l’indifférence ou le silence, et contre l'impunité de ceux qui, en exécutant le mot d’ordre « Assad ou on brûle le pays », ont mis la Syrie à feu et à sang, il faut faire entendre une multitude de voix. Dans une interview fleuve, les spécialistes qui ont coordonné l'ambitieux ouvrage collectif Syrie, le pays brûlé. Le livre noir des Assad (1970-2021) reviennent sur certains témoignages importants de ce livre et sur la méthodologie qui a guidé leur démarche.
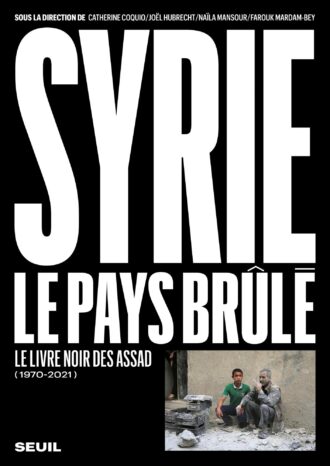
Chercheurs, journalistes et écrivains, syriens et occidentaux, ont participé à la production de Syrie, le pays brûlé. Du fait de la diversité de ses contributeurs, du mélange des genres et de la variété des sources mobilisées, cet ouvrage possède un format atypique. Pouvez-vous nous expliquer votre démarche ?
Catherine Coquio
La création du comité « Syrie-Europe, après Alep » en 2016, déclenchée par la chute de la ville d’Alep et l’intervention russe, est à l’origine de ce projet. Le groupe, composé de Syriens et de Français, chercheurs, journalistes et activistes des droits de l’homme, a commencé par des réunions de veille, d’alerte, des communiqués dans la presse, des lettres ouvertes au président, des demandes d’audition à l’Assemblée Nationale et des colloques à dimension de recherche. L’idée d’un livre noir des Assad a rapidement émergé et c’est au printemps 2017 que nous avons commencé à réaliser ce projet. Il était alors question de traiter de la criminalité politique dans la guerre syrienne et de recenser l’ensemble des phénomènes et faits de résistance en essayant de continuellement donner voix à ceux qui avaient agi. Il nous importait de faire comprendre que ce que le régime avait voulu écraser n’était pas seulement une population–cible, mais une révolution.
C’est aussi de là que vient la diversité générique du volume, qui fait alterner les témoignages et les analyses de chercheurs historiens, anthropologues, juristes, linguistes, spécialistes des violences de masse, de l’archive, de l’image, etc. Nous avons désiré cette alternance entre les récits des témoins internes et externes (survivants, journalistes, acteurs et parfois transfuges du régime) et des travaux scientifiques à caractère réflexif. Le livre avait plusieurs objectifs à la fois : livrer des faits, faire comprendre l’engrenage des violences et en saisir l’ampleur, instruire un dossier à charge mais aussi rendre hommage à ces activistes devenus archivistes du crime, et tenter de transmettre les valeurs en jeu dans ce conflit mortel. Le travail de documentation supposait de sélectionner parmi l’étourdissante archive née de l’auto-documentation du mouvement et de la mettre en perspective critique, en s’appuyant sur les enquêtes de journalistes et d’ONG et sur la bibliographie savante à disposition ; comme les analyses précieuses que Michel Seurat avait faites de « l’État de barbarie » assadien sous Hafez…
Le livre avait plusieurs objectifs à la fois : livrer des faits, faire comprendre l’engrenage des violences et en saisir l’ampleur, instruire un dossier à charge mais aussi rendre hommage à ces activistes devenus archivistes du crime, et tenter de transmettre les valeurs en jeu dans ce conflit mortel.
Catherine Coquio
Joël Hubrecht
Cette transversalité provient ainsi d’une combinaison entre l’engagement et l’énergie du collectif précédemment cité et l’expertise d’intellectuels avec un objectif commun : celui de faire comprendre la nature même du régime syrien dans la durée et la teneur des crimes perpétrés.
Farouk Mardam-Bey
Nous tenions aussi à intégrer dans ce livre des textes littéraires extraits de romans ou poèmes en rapport avec les massacres, la torture dans les prisons-abattoirs, les sièges, et cela aussi bien du temps de Hafez al-Assad que pendant le soulèvement.
Catherine Coquio
Plusieurs générations d’écrivains sont représentées au sein de l’ouvrage, avec de grandes plumes de la littérature syrienne telles que Mustafa Khalifé, qui ouvre le volume et Yassin al-Haj Saleh qui le ferme, ou Faraj Bayrakdar dont nous avons intégré des poèmes de prison, et des auteurs plus jeunes qui se sont formés dans les années précédant le soulèvement, ou pendant, comme Abdallah el-Khatib, Omar Kaddour, Nisrine al-Zahre…
Joël Hubrecht
Nous avons introduit une dimension artistique en insistant sur les productions d’artistes détenus dans les prisons syriennes. Par exemple, les dessins à la plume de Najah al-Bukai — dont nous avons recueilli le témoignage carcéral — et les gravures et aquarelles d’Azza Abo Rebieh, qui constituent un témoignage à part entière des exactions commises au sein de la branche 215, l’une des plus dures du régime, où elle fut détenue avec 15 autres femmes pendant 70 jours. Comme l’a très bien montré Catherine (dans le Livre noir et dans À quoi bon encore le monde ?, paru chez Actes Sud cet automne), la révolution sociale et politique de 2011 était également, et indissociablement, une révolution culturelle.
Il s’agit d’un travail de recherche et de collecte d’information colossal. Vous évoquez six années d’écriture. Alors que la guerre sévit toujours en Syrie et que les exactions du régime sur sa population perdurent, pourquoi avoir décidé de le faire paraître aujourd’hui ?
Catherine Coquio
C’est justement parce que les exactions perdurent qu’il fallait sortir le livre, pour les mêmes raisons qu’il avait fallu le commencer et le faire. Il nous était impossible de laisser les choses se poursuivre simplement en les regardant ou en ne les regardant plus. En réalité, nous aurions même voulu le faire sortir plus tôt. Au-delà de constituer une archive conséquente et de l’inscrire sur un temps long, il s’agissait aussi d’une tentative d’agir encore, même si celle-ci était un peu désespérée, par une prise de conscience plus large de la population.
Vous avez restitué les textes de nombreux auteurs syriens. À quels dangers font-ils face en acceptant de témoigner publiquement ? Qu’est-ce qui les pousse à s’exposer ainsi ?
Naïla Mansour 1
Quelle est ma motivation à moi par exemple ? Je ne sais pas. On ne peut pas parler de motivation car la motivation est un ressort positif interne ou externe qui te pousse vers l’avant. Dans ce cas-ci, il s’agit d’un état naturel des choses. On n’a pas le choix, il faut payer sa contribution à sa propre syrianité. C’est comme la résilience : ce n’est pas de l’héroïsme, c’est un manque de choix. On n’a pas le luxe d’oublier notre identité profonde forgée par le massacre et on n’a pas non plus le luxe de devenir fou. On n’est pas non plus des salauds qui profitons du régime et prêts à se vendre, donc on le fait. On le fait car on s’est trouvé dans des circonstances et avec des gens prêts à le faire. On nous a sollicités, on ne peut pas refuser, c’est tout. Pour les dangers, on ne peut jamais savoir et c’est en soi effrayant. Qu’est-ce que risquent les proches toujours dans le pays ? On ne peut jamais savoir.
On n’a pas le choix, il faut payer sa contribution à sa propre syrianité. C’est comme la résilience : ce n’est pas de l’héroïsme, c’est un manque de choix.
Naïla Mansour
Joël Hubrecht
Quand nous avons commencé à échafauder cet ouvrage, les espoirs des révolutionnaires syriens apparaissaient d’ores et déjà hors d’atteinte. Mais ils poursuivent aujourd’hui leur combat par la force de leurs témoignages que le régime tente toujours d’étouffer. Les risques qu’ils encourent demeurent. Plusieurs auteurs ont dû user de pseudonymes, le plus souvent parce que leurs familles en Syrie sont menacées de représailles. La situation en Turquie se dégrade également pour les réfugiés : d’un côté les dernières issues de secours se ferment, comme le montre la situation d’un collaborateur du livre noir, Hussam Hammoud dont la demande de visa humanitaire a été refusée par la France, et de l’autre, les aides se tarissent et la pression que l’on exerce sur eux s’accroit afin de les pousser à retourner en Syrie.
Naïla Mansour
Nous avons voulu donner une place aux témoignages des Syriens, malgré leur fatigue, leur irritabilité et cette restitution des faits devenue sisyphéenne après une décennie d’impunité et d’absurdité. Nous avons essayé de redonner une voix aux Syriens comme étant une voix d’introspection et de production de connaissance sur leur propre expérience.
Une des visées de cet ouvrage est d’informer et de sensibiliser ses lecteurs sur l’ampleur de la répression du régime syrien. Quel rôle joue l’opinion publique française dans l’évolution de la guerre en Syrie ? Selon vous, la médiatisation de ce conflit et ses répercussions sont-elles insuffisantes ?
Farouk Mardam-Bey
Au début du soulèvement, en 2011 et au cours des premiers mois de 2012, la Syrie n’a pas été absente des médias, ni plus tard aux grands tournants, surtout dans la presse écrite. Moins que nous le souhaitions sans doute, et les horreurs de Daech ont souvent occulté toutes les autres. L’opinion publique en France, comme ailleurs dans le monde, était plutôt favorable au soulèvement en Syrie, déclenché dans le sillage du « Printemps arabe ». Parmi les forces politiques, seule l’extrême-droite lui était franchement hostile, ou du moins était la seule à exprimer avec enthousiasme son soutien au régime. Les choses ont changé par la suite, en raison de l’irruption des islamistes de Daech dont les exactions délibérément spectaculaires ont été mises à profit par la propagande du régime et de ses protecteurs iranien et russe, pour présenter Bachar al-Assad comme le dernier rempart contre cette barbarie. À droite, on le disait protecteur des minorités religieuses, et de tout ce qui se passait en Syrie il n’était presque plus question pour elle que du sauvetage des « chrétiens d’Orient ». Une partie notable de la gauche, spontanément campiste, comme du temps de la guerre froide, prenait, elle, pour argent comptant la phraséologie anti-impérialiste du régime, et croyait ou feignait croire qu’il faisait face à un vaste complot occidental. Contre toute évidence, elle n’a cessé d’agiter le spectre d’une intervention militaire américaine en vue de le renverser. Plus généralement, il faut reconnaître que l’opinion publique en France s’intéresse de moins en moins aux causes lointaines, les élans de solidarité ne durent qu’un moment, puis, c’est l’indifférence. Dans les médias, on a tendance, à chaque nouvelle crise internationale, à oublier celle qui l’a précédée.
Une partie notable de la gauche, spontanément campiste, comme du temps de la guerre froide, prenait, elle, pour argent comptant la phraséologie anti-impérialiste du régime, et croyait ou feignait croire qu’il faisait face à un vaste complot occidental. Contre toute évidence, elle n’a cessé d’agiter le spectre d’une intervention militaire américaine en vue de le renverser.
Farouk Mardam-Bey
Joël Hubrecht
À un certain moment, le conflit a été très médiatisé, comparé à ce qu’il est aujourd’hui. Il a aussi suscité de fortes indignations comme en 2015, face à la photo du petit Aylan, trois ans, échoué sur une plage en Turquie, ou en 2014 au moment de la publication dans la presse des photos des cadavres de prisonniers du dossier César. Toutefois, Garance Le Caisne, qui en retrace la découverte, montre qu’après le blocage de la Cour pénale internationale par le veto russe au Conseil de sécurité et du fait du manque de persévérance d’Obama qui ne recevra jamais César, on est vite passé à autre chose. Les mobilisations amorcées se sont perdues au profit d’une focalisation sur les violences commises par Daesh. Et puis il y a la durée des conflits. Comme cela avait été le cas dans les années 1990 face au siège de Sarajevo en Yougoslavie, l’opinion publique finit par s’accoutumer aux images de guerre. En Syrie, le siège de la Ghouta orientale a duré cinq années, mais le trop plein d’horreurs, leur démesure, finit par servir leurs auteurs. En mai dernier, la publication de la vidéo du massacre de 2013 de Tadamon et plus récemment, la révélation d’un nouvel ensemble de photographies de 800 corps de prisonniers torturés n’ont eu que peu d’échos.
[Le monde se transforme. Si vous trouvez notre travail utile et souhaitez contribuer à ce que le Grand Continent reste une publication ouverte, vous pouvez vous abonner par ici.]
Naïla Mansour
La politique et les médias de manière générale, en France et ailleurs, n’arrivent plus à mobiliser une opinion publique qui est lassée du flux d’informations, du flux de catastrophes planétaires et des modalités classiques de faire la politique. D’ailleurs, dire que « la crise syrienne est la plus documentée » est devenu une banalité mais cela n’a pas donné de résultats concrets contre l’impunité.
Au printemps 2011, c’est une révolution qui éclate en Syrie et non une guerre, car les aspirations du peuple syrien sont de nature démocratique. Dans ce sens, comment aurait-on pu mieux accompagner le soulèvement populaire syrien ?
Farouk Mardam-Bey
Le point le plus faible du soulèvement syrien, et pas seulement au plan médiatique, a été l’absence d’une représentation politique crédible à l’intérieur du pays comme à l’extérieur. Le Conseil national syrien puis la Coalition nationale des forces de la révolution et de l’opposition syriennes, autoproclamés et sans enracinement militant sur le terrain, ont été bien en-deçà des immenses sacrifices et des espoirs de la population. Par leurs illusions et leurs divisions, ils ont laissé le soulèvement se noyer aux yeux du monde, ainsi que le souhaitait le régime, dans le marécage des conflits régionaux et des alliances douteuses. Cela a eu pour effet de rendre inaudible la voix des forces vives du pays qui s’organisaient localement comme elles le pouvaient, dans des conditions extrêmement difficiles. Il a manqué au soulèvement, surtout après son inévitable militarisation, une direction révolutionnaire, démocratique, réellement indépendante et représentative, avec une vision stratégique et un programme en due forme.
Il a manqué au soulèvement, surtout après son inévitable militarisation, une direction révolutionnaire, démocratique, réellement indépendante et représentative, avec une vision stratégique et un programme en due forme.
Farouk Mardam-Bey
Joël Hubrecht
Cette faiblesse représentative s’explique aussi par la longévité de la dictature syrienne. Depuis un demi-siècle, il est impossible de débattre, d’organiser et d’incarner à un niveau politique une véritable alternative. Par ailleurs, c’est paradoxalement le caractère populaire et démocratique du soulèvement qui a constitué un frein à son soutien par les États occidentaux. À rebours de la propagande du régime, qui dénonçait un complot fomenté de l’extérieur, force est de constater que nos gouvernements parviennent mieux à aider un État agressé par un autre État, comme aujourd’hui l’Ukraine par la Russie, qu’une population réprimée par son propre État. Cela interroge douloureusement notre rapport aux autres sociétés et à la démocratie et nous devrions en tirer des leçons.
Catherine Coquio
L’absence d’incarnation dans une figure forte est par ailleurs l’une des causes de la division de la gauche française à l’égard de ce mouvement. Le soulèvement syrien a attiré une partie libertaire de la gauche, tandis que sa partie jacobine, portée par Mélenchon, a préféré l’ignorer. Cette gauche a réagi de façon pavlovienne en activant son anti-atlantisme et son laïcisme, à contretemps et à contresens car la « laïcité » du régime est aussi fantomatique que son « socialisme » et son pro-palestinisme, qui relève de l’imposture. Il y a bel et bien eu une expérience de démocratie directe en Syrie, passée par les comités locaux des régions insurgées. Elle a souffert de conditions épouvantables et a été altérée puis détruite par les menées islamistes. Mais elle existe et doit être recueillie, reconnue, comprise jusque dans ses erreurs ou limites. Malheureusement, cette dernière a été laissée en souffrance, alors même qu’il faudrait tout mettre en œuvre pour ne pas la laisser s’effacer. On a préféré marteler qu’il n’y avait pas d’opposition crédible en Syrie.
Vous dénoncez l’inaction des puissances occidentales face aux crimes de guerre du régime syrien. On se souvient de la « ligne rouge » fixée par le président des États-Unis Barack Obama au début de la guerre qui, maintes fois franchie par Bachar al-Assad, n’aura en fin de compte jamais poussé les puissances occidentales à s’impliquer dans le conflit. Comment l’expliquez-vous ?
Même lorsque les photos et les films des massacres ont produit de l’indignation, les élans de l’opinion publique ont été désamorcés par les empêchements d’agir au niveau international, à l’ONU notamment, du fait des vétos russes et chinois immédiats. Dès lors, l’aggravation croissante des faits immédiatement répercutés dans les médias mondiaux a eu un effet pervers qu’analyse Chamsy Sarkis, le créateur l’agence franco-syrienne SMART : Bachar al-Assad et bien sûr Vladimir Poutine s’en sont servi pour tester le degré de tolérance de la communauté internationale. Celui-ci s’est révélé immense, ouvrant ainsi la porte aux pires crimes et à une sorte de convergence de deux nihilismes : cynisme politique inouï d’un côté, consentement finalement consensuel de l’autre.
La gauche de Mélenchon a réagi de façon pavlovienne en activant son anti-atlantisme et son laïcisme, à contretemps et à contresens car la « laïcité » du régime est aussi fantomatique que son « socialisme » et son pro-palestinisme, qui relève de l’imposture.
Catherine Coquio
Joël Hubrecht
Il y a eu des barrages et des oppositions à l’action occidentale mais il y a aussi eu des renoncements et un aveuglement persistant. Contrairement au cas ukrainien, où des armes ont été fournies aux agressés pour se défendre, il n’y a pas eu de soutien militaire consistant envers l’Armée libre syrienne ni de tentatives pour imposer une zone aérienne d’exclusion. Mais même sur les volets de l’aide humanitaire ou de l’information, nous avons fini par abdiquer. Chamsy Sarkis montre que non seulement l’aide a été trop tardive, la période décisive s’étant jouée en 2011-2012, mais aussi qu’elle s’est révélée parfois contre-productive. Ainsi les agences européennes de soutien aux médias ont censuré les médias indépendants qu’elles étaient sensées soutenir en leur imposant une vision « neutre et dépolitisée » du journalisme. Sur un plan diplomatique aussi, les négociations de Genève, supervisées par l’ONU, se sont enlisées et nous avons finalement laissé la Russie, la Turquie et l’Iran prendre la main pour mettre en place des accords de cessez-le-feu qui ont consolidé la reconquête du territoire par Bachar et conduit à la mise sous tutelle du pays par des « parrains » régionaux.
Vous mentionnez l’existence en France d’un négationnisme des crimes perpétrés en Syrie par le régime et déclarez vouloir lutter contre. Sous quelles formes se manifeste ce phénomène et comment le déjouer ?
Farouk Mardam-Bey
Le négationnisme est d’abord le fait du régime pour lequel tous les témoignages irréfutables sur ses crimes sont fabriqués. Selon lui, son armée, ses milices, ses services de renseignement n’ont pas massacré, torturé, violé, volé, déporté, en dépit de ce que prouvent les dizaines de milliers de documents produits par leurs victimes, et parfois par les criminels eux-mêmes. Ce discours falsificateur se répercute ensuite par l’intermédiaire de relais internationaux, dont une multitude de sites conspirationnistes. Il y a un autre type de négationnisme qu’on entend en France, c’est quand quelqu’un vous dit : « Oui, c’est vrai, je ne le nie pas, Bachar est un dictateur, mais… ». Mais quoi ? « mais il est laïque, il est moderne, il est anti-impérialiste, il protège les chrétiens, et puis, franchement, les Arabes sont-ils mûrs pour la démocratie ? ». Pour nous qui recevons tous les jours des preuves supplémentaires des crimes commis par le régime, c’est absolument insupportable, surtout pour moi quand celui ou celle qui profère de telles insanités se proclame « de gauche ». Cela dit, il faut noter que tous les partisans en France de Bachar al-Assad ne nient pas ses crimes. Certains les reconnaissent et les approuvent. Les plus cyniques d’entre eux au nom de la realpolitik et de la « stabilité régionale », cette belle stabilité qui ne profite qu’aux despotes, aux mafieux et aux islamistes les plus obtus. Les mêmes admirent forcément Vladimir Poutine.
Joël Hubrecht
Finalement, aucune famille politique n’était complètement indemne d’une certaine complaisance vis-à-vis de Poutine. La portée du négationnisme opéré par le régime syrien aurait été très réduite sans la puissance extraordinaire des relais dont il a pu bénéficier grâce aux réseaux de fake russes dont la diffusion mord bien au-delà des réseaux d’extrême droite et d’extrême gauche. Dès lors, l’amoncellement des preuves ne compte plus face à l’état de confusion et de suspicion créé et les places des victimes et des bourreaux peuvent être confondues, voire inversées.
Catherine Coquio
On retrouve à propos de cette « guerre civile » tous les grands classiques de la rhétorique négationniste : falsification des faits, renversement des responsabilités, disqualification des témoins, etc. Une des singularités du cas syrien est la force de frappe de la fabrique à trolls poutinienne, qui, beaucoup plus active et puissante que l’Electronic Army syrienne, a rendu cette guerre de l’information redoutable. Face à cette artillerie lourde du fake, l’Occident n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation en temps voulu. Par ailleurs, ce n’est pas parce que l’on déconstruit un négationnisme que l’on en triomphe. Le besoin de dénier est tellement fort que le démontage critique ne suffira pas.
Une des singularités du cas syrien est la force de frappe de la fabrique à trolls poutinienne, qui, beaucoup plus active et puissante que l’Electronic Army syrienne, a rendu cette guerre de l’information redoutable. Face à cette artillerie lourde du fake, l’Occident n’a pas pris la mesure de la gravité de la situation en temps voulu.
Catherine Coquio
Farouk Mardam-Bey
En effet, le déni est confortable et, de toute façon, on ne voit pas quand on ne veut pas voir. Quand on craint, si l’on ouvre les yeux, de devoir renoncer à ses certitudes idéologiques et brûler les idoles qu’on a longtemps adorées. Je doute fort que les négationnistes des atrocités commises en Syrie par les Assad se jettent sur le Livre noir ! Combien de fois avons-nous eu affaire à des gens qui affirmaient que les images documentant ces atrocités provenaient d’une officine de la CIA.
Naïla Mansour
C’est la conséquence d’une politique étrangère des pays occidentaux qui traite la région comme une gestion de crises successives, au mépris des peuples et au profit de dirigeants dictateurs « gestionnaires ». La macro-géopolitique imposée à notre région est la vraie « nécropolitique poscoloniale », comme l’exprime très bien le politiste Yasser Munif dans The Syrian Revolution : Between Politics of Life and the Geopolitics of Death 2.
Vous revenez sur la répression exercée par la famille Assad depuis son arrivée au pouvoir en 1970, ce qui soulève la question des distinctions et des similitudes entre le régime de Hafez al-Assad et celui de son fils Bachar. Vous évoquez notamment une perpétuation des institutions de répression. Plus généralement, comment l’usage de la violence par le régime syrien a-t-il évolué depuis 1970 ?
Farouk Mardam-Bey
Notons d’abord, pour ce qui est de la similitude entre les deux hommes, que Hafez al-Assad puis son fils Bachar ont accédé tous les deux au pouvoir dans des conditions qui leur étaient très favorables. Quand Hafez a mené son coup d’État en novembre 1970 contre ses compagnons du parti Baath, la population était lasse de la surenchère gauchiste du régime précédent. Sur le plan régional, il a été salué par les pays arabes « modérés », notamment l’Arabie saoudite et l’Égypte. Les Américains espéraient quant à eux gagner la Syrie, considérée jusqu’alors comme prosoviétique, tandis que les Soviétiques, qui y étaient solidement installés, étaient évidemment soucieux de ne pas la perdre. Les deux superpuissances ont donc marqué leur soutien au nouveau maître du pays. Après la guerre d’Octobre 1973, son refus d’accompagner Sadate dans le processus de paix avec Israël lui a permis de se présenter comme un intraitable anti-impérialiste. Il a tiré ensuite profit de tous les événements qui ont bouleversé le Moyen-Orient pour jeter les fondements de son régime, un régime clanique où l’armée, tournée contre l’ennemi intérieur, est flanquée d’une milice sans foi ni loi dirigée par son frère Rifaat, et de services de renseignement tentaculaires. La guérilla lancée par des djihadistes en 1979 sera le prétexte d’une répression féroce étendue à toutes les forces politiques et à une destruction systématique, ou une subordination, de toutes les organisations de la société civile. C’est ainsi qu’entre 1980 et 1983, avec les massacres de la prison de Palmyre, puis de Hama, d’Alep et d’autres localités, et l’enfermement sans jugement de dizaines de milliers de personnes, la Syrie est devenue le « royaume de la peur et du silence ».
En 2000, lorsque Bachar a accédé au pouvoir, il était adoubé par les pays occidentaux, surtout par les États-Unis et la France qui voyaient en lui un homme d’ouverture. Une majorité de la population pensait qu’il n’allait pas tarder à lancer un train de réformes, non seulement administratives et économiques, mais aussi politiques. Espoir vite déçu quand ont été fermés les clubs de débat qui étaient apparus après son élection. Crispé depuis lors à l’intérieur, cramponné au Liban où il entendait prolonger la tutelle syrienne, il a réagi aux événements considérables qui se sont succédés durant la première moitié de cette décennie (le 11 septembre 2001, l’invasion de l’Irak en 2003, la résolution 1559 du Conseil de sécurité exigeant entre autres l’indépendance et la souveraineté du Liban suivie de l’assassinat en 2005 de Rafiq Hariri et de la mise en cause des services de sécurité syriens dans ce crime) par l’étouffement dans l’œuf de toute forme d’opposition politique. Il s’est alors montré le digne successeur de son père avant de le dépasser en cruauté quelques années plus tard avec le déclenchement du soulèvement.
Joël Hubrecht
Pour perdurer, la dictature d’Hafez a su tirer profit du contexte de la guerre froide puis se placer adroitement lors de la première guerre du Golfe. Lorsque Bachar arrive au pouvoir en 2000, il fait mine de s’adapter au contexte plus ouvert et moderne de la globalisation. Mais ce « dictateur malgré lui », comme certains l’ont cru, se révèlera fidèle à l’héritage de son père et aux intérêts de son clan. Lorsque la répression monte en puissance avec les manifestations de 2011, le régime n’a pas besoin d’ouvrir de nouvelles prisons. Il va seulement les faire plonger dans une dimension encore plus inhumaine en entassant toujours plus de prisonniers dans les cellules. L’appareil répressif, y compris l’armement chimique qu’il ne va pas tarder à utiliser, est en place et bien rôdé depuis des décennies.
Tous les partisans en France de Bachar al-Assad ne nient pas ses crimes. Certains les reconnaissent et les approuvent. Les plus cyniques d’entre eux au nom de la realpolitik et de la « stabilité régionale », cette belle stabilité qui ne profite qu’aux despotes, aux mafieux et aux islamistes les plus obtus. Les mêmes admirent forcément Vladimir Poutine.
Farouk Mardam-Bey
Catherine Coquio
Il faut aussi rappeler l’influence des « Printemps arabes ». Si le soulèvement de 2011 en Syrie a eu lieu, c’est parce qu’il y en a eu d’autres avant lui et qu’il s’inscrivait dans une logique historique. C’est à cela qu’a réagi Bachar avec une violence qui a surpris les insurgés, malgré les décennies de terreur passées. Lorsqu’on lit les récits des premières manifestations, on retrouve sans cesse l’idée qu’il était impossible de revenir en arrière, tant la libération enivrante de la parole et des gestes a été vécue comme une naissance. Dès lors, le soulèvement ne pouvait que se radicaliser dans une sorte de sacrifice, comme si risquer ou donner sa vie était la seule forme de « dignité » désormais possible. C’est tout le tragique du printemps syrien. Le régime a crevé le plafond du cynisme politique en écrasant le soulèvement par tous les moyens possibles de destruction, physique et morale. C’est pourquoi la notion de guerre ne suffit pas à rendre compte de l’ensemble des événements.
Farouk Mardam-Bey
Sur le plan intérieur, la continuité entre le père et le fils se manifeste surtout dans le caractère clanique de leur pouvoir. Il n’est pas exagéré de dire que la Syrie a été gouvernée pendant un demi-siècle par une mafia dont ils ont été les parrains, l’un après l’autre. Sur le plan régional, la continuité est dans la proximité entretenue avec l’Iran. Bachar est même allé plus loin que son père dans le soutien aux ambitions impériales de Téhéran, et cela au détriment des relations amicales nouées par Hafez avec l’Arabie saoudite. Enfin, sur le plan international, l’alliance de Hafez avec l’Union soviétique s’est prolongée par celle de Bachar avec la Russie, qui s’apparente dans les faits, depuis 2015, à une tutelle russe sur la Syrie.
Lorsqu’éclate la guerre civile, les Assad sont au pouvoir en Syrie depuis déjà plus de quatre décennies. L’année 2011 semble avoir plongé le pays dans une décennie d’extrême violence marquée par des dynamiques conflictuelles complexes. Onze ans après le début de la guerre, comment caractériseriez-vous le conflit syrien ?
C’est avant toute chose une révolution, une révolution au destin tragique, et c’est ensuite une guerre sans merci menée contre elle, avec une dimension que je n’hésite pas pour ma part à qualifier de génocidaire. À la faveur de cette guerre, Bachar al-Assad a cherché à remodeler démographiquement la société syrienne afin de concrétiser le mot d’ordre de ses partisans : « Assad pour l’éternité ». Comment ? En massacrant sauvagement des centaines de milliers de Syriens, en réduisant leurs villes et leurs villages en un champ de ruine, en faisant fuir le tiers de la population hors les frontières du pays, en déportant les habitants des localités réputées récalcitrantes et en les remplaçant en partie, dans une logique de toute évidence confessionnelle, par des familles venues d’ailleurs. Selon Bachar, la société syrienne serait ainsi devenue plus « homogène ». Il l’aurait débarrassée de ses « classes dangereuses » qui ont osé se révolter contre lui. Cette ingénierie démographique, du moins dans son esprit, ressemble à un génocide.
Selon Bachar, la société syrienne serait ainsi devenue plus « homogène ». Il l’aurait débarrassée de ses « classes dangereuses » qui ont osé se révolter contre lui. Cette ingénierie démographique, du moins dans son esprit, ressemble à un génocide.
Farouk Mardam-Bey
Catherine Coquio
Le vocabulaire de « l’assainissement » démographique, cher à Bachar, remonte à l’ère Hafez, lorsque Rifaat al-Assad, chef des brigades de défense, affirmait en 1980 « nous sommes prêts à sacrifier un million de martyrs ». C’est d’ailleurs dans ces mêmes années 1980 que s’est mis en place le dispositif d’armes chimiques en Syrie. « L’assainissement » touchait à l’appartenance ethnico-confessionnelle, mais aussi sociale. Sous Bachar, l’éradication du soulèvement populaire a pris aussi une allure de guerre de classes, puisque la population sunnite qui a été visée était aussi une population pauvre, considérée comme illettrée et présumée terroriste. Cette inspiration génocidaire ne s’est pas cantonnée dans la métaphore. Elle ne se prête pas à la qualification juridique mais on la déchiffre dans des conduites déshumanisantes et exterminatrices qui ne relèvent plus du tout de la guerre.
Joël Hubrecht
Effectivement, il faut entendre dans les propos de nombreux Syriens qui parlent de violences génocidaires non pas une ignorance du droit ou une surenchère dans leur victimisation mais le fait que le degré de cruauté va au-delà de ce que la définition du crime contre l’humanité décrit lorsqu’il parle d’attaques généralisées ou systématiques contre une population. La persécution est un des crimes contre l’humanité qui peut rendre compte de la nature discriminatoire et ciblée d’une grande partie de la répression. Mais comment rendre compte de l’acharnement du régime contre des familles entières et contre les enfants ? Comment dire cette violence qui, sans remplir entièrement les critères de la définition juridique du crime de génocide, évoque néanmoins la dimension exterminatrice du génocide. Le droit tente de saisir au mieux la réalité pour en dégager des faits et des responsabilités mais il ne surplombe pas et n’épuise pas cette réalité. Ce pour quoi cette violence a besoin d’être qualifiée en droit mais doit aussi être dite autrement que dans le vocabulaire du droit. C’est cette pluralité de langages que mobilise le Livre noir.
L’ouvrage a pour sous-titre Le livre noir des Assad et mêle témoignages et preuves des crimes commis par le régime syrien. Le processus de justice pour les victimes de la répression syrienne se prépare-t-il dès maintenant, dans la perspective d’un procès d’Assad devant la Cour pénale internationale ?
Dès l’été 2011, des ONG telles qu’Amnesty International ont alerté que la réaction du régime prenait l’allure d’une attaque systématique ou généralisée contre une population, ce qui est la définition du crime contre l’humanité. Leur commission, ainsi que celle de crimes de guerre, n’a fait que se confirmer avec la militarisation et la milicisation de la répression. Rapidement, des éléments de différentes natures ont pu être recueillis par un grand nombre d’organisations, des ONG mais aussi la commission onusienne dirigée par Paulo Pinheiro et depuis 2017, le mécanisme dit M3I dirigé par la magistrale Catherine Marchi-Uhel à Genève. Les preuves dont nous disposons aujourd’hui sont suffisantes pour condamner Bachar al-Assad. Il manque le tribunal pour le juger. Mais, au-delà de la seule figure du dictateur, vers qui certes tout converge, ce sont les multiples responsables et les différents niveaux de ce système de répression à qui il faut demander des comptes. Malheureusement, les procédures entamées n’ont abouti qu’à la condamnation de deux responsables du régime syrien et à une poignée de mandats d’arrêts internationaux. Seuls les dossiers ouverts dans une quinzaine de pays, au titre de la compétence universelle des juges nationaux pour réprimer les crimes internationaux les plus graves, portent l’espoir que la mobilisation des victimes syriennes ne sera pas vaine. Or elle ne doit pas l’être. Non seulement pour faire reconnaître la dignité de leurs proches disparus, dont chaque vie importait, mais aussi parce que, comme le montrent plusieurs articles de ce livre, l’impunité est un facteur décisif de la montée progressive de la violence. De plus, la demande de justice ne constitue pas seulement un enjeu pour les Syriens. Ne pas y répondre, c’est saper définitivement la crédibilité du droit international dont dépend en grande partie la sécurité internationale. De ce point de vue, les enjeux sont étroitement liés à ceux de la guerre en Ukraine et à la crise que traverse l’ONU.
[Le monde se transforme. Si vous trouvez notre travail utile et souhaitez contribuer à ce que le Grand Continent reste une publication ouverte, vous pouvez vous abonner par ici.]
Depuis l’invasion de l’Ukraine par la Russie en février 2022, de nombreux observateurs affirment que la Syrie a constitué le terrain d’expérimentation de Vladimir Poutine. En actant progressivement le retour en force de la Russie sur la scène internationale, l’ingérence russe en Syrie a-t-elle posé les jalons de l’équilibre géopolitique mondial actuel ?
Farouk Mardam-Bey
Oui. Il n’y a pas de doute. Poutine a utilisé la Syrie comme terrain d’expérimentation à la fois politique et militaire. Par son intervention militaire, pour la première fois en dehors des frontières de l’ex-Union soviétique, la Russie a marqué son retour en force sur la scène internationale. Cela après avoir à plusieurs reprises volé au secours du régime en opposant son veto à des projets de résolution du Conseil de sécurité qui lui étaient défavorables. Et depuis 2015, les généraux russes eux-mêmes se vantent d’avoir expérimenté en Syrie plus de 300 armes de nouvelle génération. Poutine a également voulu tester la réaction des pays occidentaux. Elle a été minable et il en a profité pour agir impunément, à sa façon éprouvée à Grozny. Toutefois, il a eu tort de penser que leur réaction serait la même dans le cas d’une invasion de l’Ukraine. L’Ukraine est en Europe et les Ukrainiens ne sont pas des Arabes pour que l’Occident se désintéresse de leur sort.
Catherine Coquio
Une partie des acteurs de la guerre en Ukraine était déjà présente en Syrie. Cela constitue l’un des éléments de continuité entre la Syrie et l’Ukraine. C’est notamment le cas de la milice Wagner, qui était active en Syrie dès 2013.
Joël Hubrecht
Les méthodes sont similaires mais les théâtres de guerre sont très différents. En Ukraine, un État en agresse un autre alors qu’en Syrie, il s’agissait de la répression d’une population par son régime et, sous couvert de lutter contre le djihadisme international, d’aider un dictateur allié à reconquérir le territoire perdu. Avec l’appui russe, Bachar al-Assad, a complètement renversé la situation. Il avait perdu le contrôle de plus de 70 % du pays. Aujourd’hui il a repris la main sur plus de 70 % du territoire. Mais en Syrie, l’aide militaire de la Russie a été essentiellement apportée par l’armée de l’air russe, sous le commandement de Dvornikov. En Ukraine, Poutine a dû déployer des troupes au sol, avec les échecs que l’on sait, et le héros de guerre Dvornikov, décoré pour ses « exploits » à Alep a été vite remercié pour ses insuffisances sur le front ukrainien. Les succès de l’ingérence russe en Syrie ont conduit Poutine à défier la communauté internationale et à attaquer directement Kiev, mais l’hubris est mauvaise conseillère. Il reste à voir si, se retrouvant dans la même situation de déroute que Bachar au début de la révolution, il va lui aussi se lancer dans une fuite en avant militaire et jusqu’où cela le mènera. Mais une chose est évidente : alors que Bachar a pu survivre grâce à l’aide salvatrice de Moscou, le soutien indéfectible que lui montre aujourd’hui Damas en retour ne sera d’aucune utilité au maître du Kremlin.
La chronologie en fin d’ouvrage a pour dernière entrée « 202… ? : fin de la dynastie des Assad et chute de la dictature ». Pourtant, lorsque paraît ce livre, l’heure semble être à la réhabilitation progressive du régime de Bachar al-Assad. De nombreux pays tels que l’Arabie saoudite, les Émirats arabes unis, Bahreïn ou encore la Hongrie, la Serbie, la Grèce et Chypre ont par exemple rouvert leur ambassade à Damas. Le maintien au pouvoir de la famille Assad pour les années à venir est-il inévitable ?
Naïla Mansour
Penser l’avenir des Syriens dans un contexte de réhabilitation progressive du régime, c’est déjà le cas et c’est l’enfer pour des millions de Syriens. Très concrètement, c’est un cauchemar. Les Syriens craignent toujours leurs vies, exactement comme avant 2011 et pendant la guerre. Je dirais même que c’est pire, étant donné que le régime sent que tout est permis actuellement.
L’essentiel pour les démocrates syriens n’est pas de jouer aux devins, mais de tirer les leçons de leur défaite. De ne pas baisser les bras, mais de dénoncer sans cesse les crimes monstrueux commis contre leur peuple. De réclamer justice et ne pas désespérer de l’obtenir…
Farouk Mardam-Bey
Farouk Mardam-Bey
La normalisation des relations diplomatiques avec le régime syrien est en effet en marche, et ce n’est pas très étonnant du moment où la contre-révolution a triomphé, et pas seulement en Syrie, mais partout dans le monde arabe. La seconde vague de soulèvements populaires, à partir de 2019, en Algérie, au Soudan, en Irak, au Liban, avait ravivé l’espoir d’un changement démocratique, mais elle a reflué comme la première, celle de 2011. Je suis cependant persuadé qu’il y en aura d’autres, car les conditions de vie de la grande majorité des populations sont insupportables et que les régimes en place, de par leur nature despotique, oligarchique ou communautariste, vont les détériorer davantage. S’agissant de la Syrie, pays occupé, morcelé, et où 90 % de la population vit en-deçà du seuil de pauvreté, nul ne peut dès à présent prévoir comment évolueront les choses, tant elles sont changeantes. Que feront les Russes en Syrie s’ils sont défaits en Ukraine ? Et les Iraniens, alors qu’ils sont empêtrés dans toutes sortes de problèmes ? Qu’adviendra-t-il si les Turcs se retirent du Nord-Ouest ? À quoi aboutira le modus vivendi entre le régime et l’« Autorité autonome du Kurdistan syrien » ? Et le régime lui-même, qui peut raisonnablement affirmer dans ces conditions qu’il se comportera de telle ou telle façon ? L’essentiel pour les démocrates syriens n’est pas de jouer aux devins, mais de tirer les leçons de leur défaite. De ne pas baisser les bras, mais de dénoncer sans cesse les crimes monstrueux commis contre leur peuple. De réclamer justice et ne pas désespérer de l’obtenir…
Joël Hubrecht
Le régime des Assad a beau être en voie de réhabilitation, de par son essence il appartient au passé. Il aura beau « hisser des drapeaux tout neufs sur les décombres », pour reprendre la métaphore de Moustafa Khalifé, il ne reconstruira plus rien de grand ni de durable. Il a sacrifié toute une génération d’enfants syriens qui a grandi dans la guerre et la misère. En cela, l’éternité d’Assad est sans avenir. L’avenir du pays, c’est cette partie de la jeunesse qui s’est soulevée en 2011, qui a expérimenté, même si c’était dans la souffrance et la mort, des lieux et des moments de plus de liberté et de solidarité. Certaines de ses voix continuent à se faire entendre, dans le Livre noir et dans d’autres publications, pour écourter cette éternité assadienne et sortir du « temps des monstres ».
Sources
- Co-directrice de l’ouvrage, Naïla Mansour écrit sous pseudonyme. Ne pouvant pas être présente lors de l’entretien, elle nous a fait part de ses réflexions par écrit.
- https://www.plutobooks.com/9780745340722/the-syrian-revolution/

