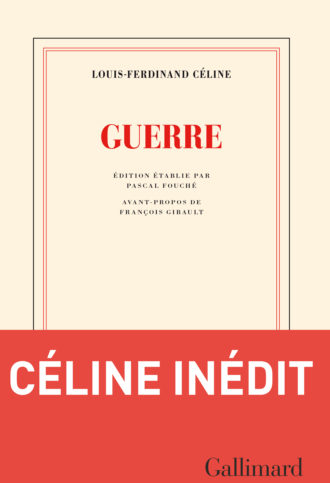« Céline » après coup
Une lecture de Guerre par Jérôme Meizoz, professeur associé à l’Université de Lausanne et auteur de Coulisses du nom propre. Louis-Ferdinand Céline (BSN Press, 2021).
Quelle étrange expérience que de lire, huit décennies après sa rédaction, un « ouvrage » inédit de celui qui se fit appeler « Céline ». Roman où se succèdent de brefs épisodes autofictifs (130 pages imprimées), de Ferdinand blessé sur le champ de bataille à la vie d’hôpital dans une ville de l’arrière. Ce manuscrit de premier jet, l’auteur l’aurait abondamment révisé s’il l’avait pu et il nous serait parvenu sous une forme assez différente. La presse et la critique ont déjà commenté la réémergence des manuscrits inédits et à ce sujet, la mise au point du spécialiste Philippe Roussin, fait autorité 1. D’autres universitaires se sont prononcés sur les problèmes soulevés par Guerre 2, notamment quant aux réappropriations voire récupérations qu’une telle publication posthume ne peut que susciter dans le débat polarisé au sujet de son auteur.
Guerre, publié par Gallimard, préfacé pour les ayant-droits par l’avocat François Gibault, est qualifié par ce dernier de « célinien ». Difficile de réfuter un tel pléonasme. Mais surtout, ce texte est accompagné d’un long discours de validation à l’argumentaire simple : nous avons sous les yeux, en 1934, le génie stylistique de Céline à l’état pur, exempt de toutes les polémiques qui ont suivi. L’occasion de se refaire une vertu. La collection « blanche », d’ailleurs, tend à transformer en littérature pure un texte très lié à ses circonstances d’énonciation et dans les enjeux d’époque. Rappelons ici trois des saillances où il se cogne.
D’abord, Guerre arrive après bien des récits et romans de 14-18. En 1934, le genre a une longue histoire et fait encore quelques succès. Pour s’en démarquer, Céline choisit de faire éprouver de l’intérieur, jusqu’à la limite du langage, l’effet d’une grave blessure de guerre (« J’ai attrapé la guerre dans ma tête »). C’est très réussi. Tout le système nerveux du narrateur est durablement ébranlé par cette expérience, ainsi que sa vision du monde. Il cherche moins à raconter des scènes de guerre (Ferdinand est désormais à l’écart du théâtre des opérations) qu’à faire sentir dans la langue le champ de bataille qu’est devenu le monde sensoriel et psychique du traumatisé (« J’aurais jamais cru ça possible si on m’avait raconté »).
Ensuite, le style fortement marqué par l’école « populiste » dont Céline, en relation avec Eugène Dabit, minimise l’impact sur son propre travail. Pourtant, on sait désormais combien la conjoncture populiste constitue, avec le courant prolétarien et les essais formels des communistes, le terreau de son élaboration stylistique 3. Notons au passage que la fameuse technique des points de suspension, émergente dans Voyage puis massive dans Mort à crédit, est ici quasi absente. La forme a-t-elle été mise au point ensuite, lors de la révision de Mort à crédit ? Il faudra, pour cela, aller aux manuscrits disponibles.
Enfin, le personnage de « Ferdinand » revient ici, dans la continuité du Voyage et juste avant de raconter son enfance dans Mort à crédit. S’esquisse peu à peu une posture, énonciative de toute l’œuvre romanesque, qui se signale par un singulier rapport à la langue, une diction que Céline qualifiera d’« antibourgeoise » et de style « franc grossier ». Il y a bien sûr ce style narratif oralisé avec son lot de dislocations syntaxiques, de tournures perçues comme incorrectes, inspirées de l’oral-populaire. Céline malaxe la langue comme un auteur latin : il teste toutes les positions possibles des mots dans la phrase, jusqu’à trouver la petite musique. Assurément, c’est un riche laboratoire. Et puis, très marqué dans Guerre, voici l’argot militaire et urbain. À ce titre, le Lexique donné en fin de volume a pour effet paradoxal, par la caution philologique qu’il incarne, de rendre maniérée ou datée la langue du roman : or bien des mots qui y figurent ont aujourd’hui passé dans la littérature voire dans l’usage courant. Pour Céline, l’argot est la langue jubilatoire de la « haine », et Guerre l’illustre tant dans la profération de Ferdinand que dans les relations venimeuses entre les personnages.
À partir de ces trois éléments d’historicité, tentons de résumer l’orientation argumentative implicite du roman, sous formes de brèves propositions : les atroces combats de 1914 ont définitivement déniaisé Ferdinand qui a vu et vécu l’horreur ; désormais, il sait ce dont l’humain est capable ; il croit savoir (avec Freud) les pulsions qui l’animent et croit pouvoir en déduire (avec Freud et Schopenhauer) que le discours humaniste n’est qu’un vernis de surface ; partout, il décèle les instincts animaux en l’homme, et d’abord en lui-même : « cul », argent, égoïsme, lâcheté, mensonge, trahison, racisme, misogynie, haine des parents, etc. (« C’est l’instinct qui trompe pas contre la mocherie des hommes »). Au moins Ferdinand ne s’exempte-t-il de rien. Dans sa perspective, toute croyance métaphysique, politique ou sociale est désuète (« Ça brille pas fort, l’espérance, une mince bobèche au fin bout d’un infini corridor parfaitement hostile »). Ferdinand ne peut plus « fraterniser », par exemple l’entente avec Cascade-Bébert s’avère très ambivalente. La seule personne qui fasse preuve de « sincérité » selon lui, c’est L’Espinasse, la « branleuse » de poilus agonisants.
Dès lors, on n’est pas surpris de la haine recuite de Ferdinand pour ses parents qui représentent l’envers de sa macabre prise de conscience (« Ils ne concevaient pas ce monde d’atrocités, une torture sans limite. Donc, ils le niaient. […] leur énorme optimisme, niaise, pourrie connerie, qu’ils rafistolaient envers et contre toutes les évidences […] »). On ne s’étonne pas non plus du désir brut que suscite Angèle, l’épouse de Cascade (« Où qu’on était placés nous autres, et moi surtout si je me compare, dans le fond du bocal de douleur, pour que je regrimpe à l’échelle fallait vraiment qu’elle soye tendue sa biologie la môme Angèle »). Inutile d’y chercher des révélations biographiques : le roman répond avant tout au besoin de transgression généralisé emprunté à la mode freudienne et à la « biologie » revisitée par les fantasmes céliniens. Il s’agit de s’affranchir des censures verbales et rationnelles pour reconnaître le vrai « instinct ». Mais ce savoir traumatique, né dans l’esprit fragilisé d’un Ferdinand blessé, à aucun moment il ne l’interroge. Serait-il un raccourci de pensée ? Une conséquence des souffrances endurées ? Une rationalisation du choc émotionnel ? Peut-être un aveuglement individuel ? Non, pour Ferdinand, cette expérience a le statut d’assertion existentielle, voire philosophique, qui ne souffre aucune discussion. Il lui faudra donc faire avec : dans ce monde du darwinisme social (Destouches a connu les usines Ford), chacun pour soi poursuit sa nébuleuse, comme le chante Alain Bashung. Il s’agit donc uniquement de survivre et pour cela tout est permis… Ferdinand ose désormais dire les choses avec franchise (dans Bagatelles pour un massacre, le seul « franc » est le français de souche ! on est caucasien, de type breton, dans son cas, ou on ne l’est pas) : la haine des parents, le racisme (« bicots », « arabes »), la misogynie (telles femmes sont des « raclures » : il n’y a pas d’amour dans Guerre – sauf peut-être la « bonne Agathe », mais qui est-ce ? – ce qui n’était pas le cas dans Voyage). Tout cela prend appui sur la « biologie », Guerre le dit en toutes lettres. Or dès ses études, le médecin Destouches a cru au racisme bio-médical tel qu’élaboré notamment par son ami suisse Georges Montandon. Cette adhésion traverse tous les écrits de Céline, jusqu’à sa mort. Il ne l’a jamais reniée. Elle légitime tous ses jugements politiques, sur les Juifs, les étrangers, les « bicots », bien sûr les bourgeois et, pour finir, les Chinois.
Dans un essai récent, Coulisses du nom propre (2021), j’ai tenté de montrer combien « Céline » désigne un énonciateur de fiction distinct de Louis Destouches. L’autofiction de « Céline » n’est pas la vérité de Destouches (tous les historiens le savent) mais sa version spectaculaire et publique, à destination du milieu littéraire et des lecteurs. « Céline » est donc un personnage plus qu’une personne : sa posture s’adapte stylistiquement, rhétoriquement, à cette visée. Elle affecte l’exagération en tous points, s’exalte de sa propre puissance et fonde ses effets sur le dépassement de toute censure verbale. Dans Guerre, avant Mort à crédit, on assiste rien moins qu’à la naissance de la singulière posture « Céline », par la libération concomitante d’un style et d’une idéologie. L’énonciateur blessé et furibond a le droit de tout dire, et même le plus terrible, puisqu’il a été mentalement dépucelé (c’est son mot), traumatisé par une guerre atroce. Ce droit de tout dire sans nuancer, sans analyser ni douter, sans prendre acte d’autres points de vue, c’est moins le courage de la vérité cher aux Grecs (Foucault l’a longuement commenté) que la parole que s’arroge en public le beau parleur, le bateleur de foire 4. Et il a son équivalent sur la scène politique : on voit bien que Mussolini et Hitler jouissent en parlant. « Céline » connaît ce type de transe : la parole existe pour le noir plaisir solipsiste qu’elle procure, autrui n’y existe plus que comme objet. Guerre, même s’il met en scène de nombreux personnages, ne rend qu’une seule note, qu’un seul ton, celui de Ferdinand blessé et revenu de tout. Personne ne discute les assertions d’un tel souffrant, la douleur lui donne ce privilège, celui d’une sorte de Christ négatif. Aucun autrui n’existe plus pour lui en vue de l’intelligence collective ou de la solidarité.
Seul s’affirme jusqu’au bout son unique point de vue, auquel définitivement il se complaît. Même si cette posture est efficace énonciativement, elle n’est de loin pas la seule possible, idéologiquement. Bien des contemporains de Céline se sont refusés à de telles conclusions (Guilloux dans Le Sang noir, Barbusse, Giono, le jeune Fernand Deligny et tant d’autres).Pour le reste, il y a dans Guerre des scènes d’anthologie (le réveil sur le champ de bataille ; la fête de la médaille militaire) et des personnages à l’onomastique burlesque (Dr Méconille, chanoine Présure, Amandine Destinée, M. Harnache, et le roi Krogold, qui ouvre Mort à crédit). C’est entre la plainte élégiaque rentrée, le grand-guignol et le monde des petites frappes (Un de Baumugnes l’avait fait juste avant), tout ça, bien sûr, à propos de faits tragiques. Mais ce qui domine à mon sens, c’est le plaisir du déniaisé à jouir sans entraves de sa déception et de sa haine. Il ne manque dès lors qu’un déclic politique (Le Front populaire) et littéraire (l’échec critique de Mort à crédit), pour libérer la « bête immonde » dont parlait Brecht.
Sources
- Philippe Roussin, « Déshonneur et patrie : retour sur l’affaire Céline », https://www.en-attendant-nadeau.fr/2021/12/15/deshonneur-patrie-affaire-celine/, voir aussi du même, Misère de la littérature, terreur de l’histoire. Céline et la littérature contemporaine, Gallimard, 2005.
- Pierre Benetti & Tiphaine Samoyault, « Comment peut-on lire Céline aujourd’hui ? », https://www.en-attendant-nadeau.fr/2022/05/05/guerre-lire-celine/
- Jérôme Meizoz, L’Âge du roman parlant 1919-1939, Genève, Librairie Droz, 2001 et Coulisses du nom propre. Louis-Ferdinand Céline, Lausanne, BSN Press, « Verum factum », 2021.
- Philippe Roussin, Misère de la littérature, terreur de l’histoire. Céline et la littérature contemporaine, Gallimard, 2005.