Le Conseil de sécurité entre puissance et impuissance, une conversation avec Alexandra Novosseloff
« Le Conseil de sécurité a été bousculé pendant la rivalité entre les États-Unis et l’URSS et maintenant, de même, il se divise à travers la rivalité sino-américaine ». Nous revenons avec Alexandra Novosseloff sur les évolutions du Conseil de sécurité et les débats qu'il suscite.
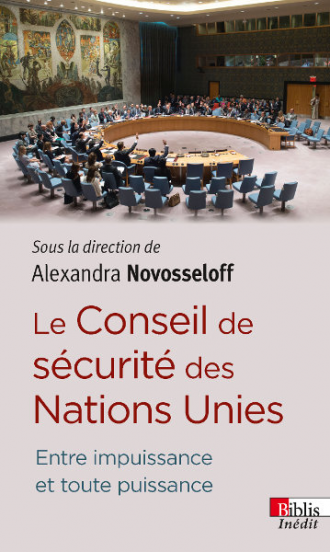
Le Conseil de sécurité de l’ONU est au cœur d’obsessions et de fantasmes qui agitent le débat public et politique. Pourtant, comme vous le montrez dans la préface que vous signez à cet ouvrage collectif fort utile, son fonctionnement et ses prérogatives restent très peu connues : comment expliquez-vous cette contradiction apparente ?
Le Conseil de sécurité est un organe complètement méconnu dans ses mécaniques et ses mécanismes, bien qu’il soit régulièrement sous le feu des projecteurs. Puisqu’il occupe régulièrement la Une des médias, les gens pensent connaître cette institution dont ils entrevoient la puissance potentielle. Mais les médias en parlent aussi souvent quand il n’arrive pas à prendre des décisions, quand un veto est mis à tel ou tel projet de résolution, moins quand il prend des décisions et met en place des mécanismes permettant d’apaiser un conflit ou du moins d’en éviter l’escalade. Il y a donc ce constant va-et-vient entre la visibilité et l’ombre, entre la puissance et l’impuissance.
Dans le livre, plusieurs contributions soulignent qu’il s’agit d’un organe qui a plus de 75 ans. Pensez-vous que le fait que l’on questionne le siège français de membre permanent contribue au sentiment de la relégation de la France sur la scène internationale ?
Il est vrai que la France, comme le Royaume-Uni, fait l’objet de beaucoup de questionnement à cet égard, alors que personne n’attaque la puissance américaine, la puissance chinoise et ce que nous pourrions appeler, avec précaution, la puissance russe.
Quoi qu’il en soit, la composition du Conseil de sécurité est issue de l’histoire et le monde actuel opère toujours selon le cadre et les règles définis par la Charte des Nations Unies pour réguler les relations entre les États. Il ne faut par ailleurs pas oublier que les membres permanents ne font pas tout au Conseil de sécurité, nous ne pouvons pas négliger l’importance des dix autres membres non permanents, élus tous les deux ans. La question de la réforme du Conseil de sécurité s’est posée au fil des années car l’ONU comprenait 51 États membres au départ, elle en a 193 aujourd’hui et tout le monde se pose donc la question de la légitimité et de la représentativité d’un organe comme le Conseil de sécurité, qui n’a que 15 membres.
Il y a ce constant va-et-vient entre la visibilité et l’ombre, entre la puissance et l’impuissance.
Alexandra novosseloff
Les Nations Unies ont-elles su répondre à ces interrogations ?
Des solutions ont effectivement été apportées pour accroître cette représentativité, que ce soit par le système des Nations Unies ou par les différents États membres. Il y a notamment eu un élargissement en 1964-1965 grâce auquel le Conseil de sécurité est passé de 11 à 15 membres.
Certains l’ont ensuite critiqué en pointant du doigt son élitisme, et la réforme a eu pour but de le rendre plus transparent, plus inclusif et plus proche des autres membres des Nations Unies. Il faut dire que le Conseil de sécurité a en réalité été conçu comme un organe restreint, capable d’agir au nom de l’ensemble des États d’une manière rapide et efficace, car il régit la paix et la sécurité internationales.
C’est le seul organe des Nations Unies agissant de manière permanente, pouvant se réunir à n’importe quelle heure du jour et de la nuit. C’est cette réactivité qui, à un moment donné, est mise en balance avec la nécessaire représentativité, cette dernière étant la pièce maîtresse de l’argumentaire des États qui veulent en être.
Par sa réactivité et à sa représentativité, parvient-on, en étudiant le Conseil de sécurité, à définir des phases distinctes de la géopolitique à l’échelle du monde ?
En effet. Dans son introduction à mon ouvrage, Serge Sur distingue six périodes distinctes au cours des 75 ans d’existence du Conseil de sécurité :
“Au cours des sept décennies et demi de sa courte mais aussi longue existence, on peut schématiquement distinguer six périodes. Il est clair qu’elles se chevauchent et se recoupent, mais l’identification et la caractérisation de chacune n’est pas trop caricaturale.
– La première est celle de la genèse, en 1945-1946. Ce sont les accords de Yalta, de février 1945, et non la conférence de San Francisco en juin, qui ont établi la structure et les règles de fonctionnement du Conseil. Celles-ci procèdent donc de l’entente entre les trois dirigeants de la coalition victorieuse de la Seconde Guerre mondiale, Staline, Roosevelt, Churchill. Ils l’ont élargie à deux autres membres permanents, la Chine et la France. Ils ont voulu un organe puissant, hiérarchique, politique, actif, décisionnel, en quelque sorte à la Carl Schmitt par opposition à l’idéologie kantienne qui marque plus largement l’ONU et surtout l’Assemblée générale. Ils ont voulu pérenniser la grande alliance des vainqueurs de la Seconde Guerre mondiale, mais aussi instituer un organe qui soit leur instrument, mais, hypothèse alternative, qui ne les gêne pas en cas de désaccord entre eux. Alors il importait que le Conseil ne puisse pas aggraver les tensions, ne pas faire de mal s’il ne pouvait faire de bien.
– La deuxième est celle de la paralysie. Elle recouvre la Guerre froide et l’opposition Est-Ouest sous ses divers avatars. Le Conseil ne peut guère fonctionner et reste paralysé face aux conflits directs ou indirects de la période. Au minimum, il n’interfère pas avec ces conflits, sauf au début, avec la guerre de Corée à partir de 1950, lorsque l’absence temporaire de l’URSS permet aux États-Unis d’instrumentaliser le Conseil. Sur le plan fonctionnel et institutionnel, cette guerre apporte la Résolution dite Acheson, du 3 novembre 1950 (Résolution 377/V), « Union pour le maintien de la paix », par laquelle l’Assemblée générale se reconnaît le droit d’autoriser le recours à la force armée en cas de blocage du Conseil. Son adoption montre qu’à cette époque, l’ONU est largement dominée par une majorité pro-américaine, qui contrôle l’Assemblée générale.
– La troisième période est celle du détournement, grosso modo des décennies 60 et 70. Elle correspond au moment de décolonisation et de post-décolonisation. L’Assemblée générale, organe plénier qui regroupe à égalité tous les États membres, est alors dominée par les nouveaux États qui détiennent plus des deux tiers des sièges. Ainsi, l’Assemblée devient le centre politique de l’Organisation. Elle s’efforce, parallèlement à la décolonisation, de promouvoir un « Nouvel ordre économique international » d’esprit solidariste pour lutter contre le sous-développement. Dans ce contexte, le Conseil, encore largement paralysé, est marginalisé par l’Assemblée générale. Elle lui impose ses objectifs et aspire à en faire son organe exécutif. Elle lutte, par exemple, contre l’apartheid en Namibie et en Afrique du Sud, ou contre l’indépendance unilatérale de la Rhodésie du Sud. Il s’agit de transformer l’ordre international antérieur plutôt que de gérer sa stabilité.
– La quatrième période est celle du réveil et renverse la tendance précédente. Elle s’ouvre avec la chute de l’URSS, au tournant de la décennie 90. Elle est marquée par la mobilisation du Conseil lors de l’annexion du Koweït par l’Iraq en 1990. Alors son activité et sa créativité se développent, et il semble en mesure de remplir les missions qui lui ont été confiées par la Charte. Il adopte de grandes résolutions qui sont un saut qualitatif dans sa pratique. Il autorise le recours à la force armée contre l’Iraq (Résolution 678 du 30 novembre 1990). Après le succès de la coalition militaire, il édicte les conditions du cessez-le-feu et place l’Iraq sous un régime étroit de surveillance (Résolution 687 du 3 avril 1991). Dans le cadre du conflit yougoslave, il crée un tribunal pénal international spécial, le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie chargé de juger les auteurs de crimes internationaux commis durant le conflit. On note toutefois la brièveté de ce réveil, et le fait qu’il engendre des mesures non formellement prévues par la Charte : l’autorisation de recours à la force au profit d’États ; la création de tribunaux pénaux internationaux.
– La cinquième période s’ouvre avec la crise yougoslave au cours des années 90. Elle est celle du stop and go. Les difficultés des Nations Unies lors de l’éclatement de la Yougoslavie, l’impuissance relative de la FORPRONU malgré l’ampleur des moyens déployés font douter de la capacité d’action du Conseil. L’échec parallèle de l’ONUSOM en Somalie, en dépit de l’implication américaine, aggrave le tableau. A la fin de la décennie et du siècle, l’intervention occidentale au Kosovo semble d’abord se passer du Conseil avant de le réintégrer pour reconstruire la paix. La période est cependant caractérisée par l’activité du Conseil dans deux domaines. D’un côté, la lutte contre le terrorisme international, déjà après 1992, et des attentats contre l’aviation civile, et surtout après les attentats du 11 septembre 2001 ; la Résolution 1369 du 12 septembre 2001 autorise ainsi les États-Unis à recourir à la force armée ; la Résolution 1373 du 28 septembre 2001 établit un programme général universel et obligatoire, préventif et répressif, contre le terrorisme. D’un autre côté, la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive au profit d’acteurs non étatiques, qui atteint indirectement les États (Résolution 1540 du 28 avril 2004). Quant à l’Assemblée générale, elle reste marginalisée face à un Conseil en majesté intermittente.
– La sixième période dure encore. On pourrait la définir par un patinage décisionnel. Le Conseil adopte certes des résolutions, plus de trois cents en cinq ans, elles se réfèrent souvent au Chapitre VII, mais elles impriment peu sur le terrain. C’est que les tensions entre les membres permanents, voire entre pays occidentaux eux-mêmes se sont développées. Le Conseil se trouve paralysé dans différents conflits – Iraq 2003, Géorgie 2008, Syrie 2013, Ukraine 2014, Yémen 2014. Un tournant décisif provient de l’intervention en Libye de 2011, d’abord franco-britannique puis appuyée par l’OTAN. Elle est certes autorisée par une résolution du Conseil, la Résolution 1973 du 17 mars 2001 qui est une première application de la responsabilité de protéger. Mais sa mise en œuvre déborde largement de l’autorisation, qui n’impliquait pas le changement de régime et la mort du colonel Kadhafi. La conséquence en est la méfiance durable au sein du Conseil entre les membres occidentaux d’un côté, la Russie et la Chine de l’autre. On n’est pas encore sorti de cette situation, au cours de laquelle prolifèrent les actions unilatérales. Il n’y a guère qu’en Afrique que le Conseil conserve une véritable capacité, à condition d’être épaulé par des États qui agissent avec son autorisation, et d’abord la France au Sahel.
Ce rapide survol montre d’abord la capacité de survie du Conseil, ensuite sa capacité d’adaptation, enfin les cycles de son efficacité. Au cours de ses sept décennies d’existence, l’institution a bougé. Mais elle ne l’a pas fait par révisions déchirantes, plutôt par petites touches qui ont maintenu ses traits fondamentaux, petites touches parfois de grande portée.”
Le Conseil de sécurité a en réalité été conçu comme un organe restreint, capable d’agir au nom de l’ensemble des États d’une manière rapide et efficace, car il régit la paix et la sécurité internationales.
alexandra novosseloff
Peut-on dire qu’une autre phase s’est ouverte dans les relations internationales ? Celle-ci pourrait être caractérisée par deux choses. D’abord, l’échec de l’hypothèse expérimentée en Afghanistan puis en Iraq par les États-Unis. Ensuite, l’intensité de la rivalité entre les États-Unis et la Chine. Pensez-vous que nous sommes devant des transformations qui trouveront une représentation dans l’institution telle qu’elle est aujourd’hui ou s’agit-il de phénomènes trop profonds pour être représentés à l’intérieur du Conseil de sécurité ?
Il est vrai que le Conseil de sécurité a toujours été le miroir de l’état des relations internationales, ce que je montre également dans ce livre. C’est un fait et c’est une chose inéluctable puisque c’est l’organe décisionnel le plus important en termes de sécurité, il est donc forcément le reflet de la coopération ou de la non coopération entre les États. Quand le Conseil prend des résolutions, il faut un accord de tous ou une décision à la majorité qualifiée, mais on a considéré depuis plusieurs décennies qu’une résolution était plus efficace, mieux suivie si elle était prise à l’unanimité. C’est un point de vue, et il est vrai que si toutes les résolutions se valent, y compris celles qui n’ont que 11 voix, les résolutions acceptées à l’unanimité bénéficient d’une légitimité politique plus importante.
Le Conseil de sécurité a été bousculé pendant la rivalité entre les États-Unis et l’URSS et maintenant, de même, il se divise à travers la rivalité sino-américaine. La France et le Royaume-Uni essaient de faire en sorte que la machine ne se grippe pas plus et mettent de l’huile dans ses rouages en étant à l’initiative de beaucoup de projets de résolution ; les membres non permanents jouent également leur rôle en s’investissant[1] sur des thèmes (liés à l’environnement, à la santé, à la place des femmes, etc.) qui permettent au Conseil de s’adapter. Il y a quelques années, la Chine se cachait souvent derrière la Russie, plus velléitaire, plus audacieuse quand il s’agissait de s’opposer aux autres pays membres. Aujourd’hui, la Chine se démarque de la Russie et affirme nettement ses positions.
Il est vrai que si toutes les résolutions se valent, y compris celles qui n’ont que 11 voix, les résolutions acceptées à l’unanimité bénéficient d’une légitimité politique plus importante.
alexandra novosseloff
Cependant, ni la Russie ni la Chine n’ont d’intérêt à affaiblir plus que nécessaire le Conseil de sécurité. D’ailleurs, aujourd’hui, si nous nous trouvons dans un contexte d’extrême tension entre certains membres permanents, il y a tout de même plus de résolutions adoptées qu’à certains moments de la Guerre froide. Mais le mode d’adoption des résolutions rejoint sur certains points celui de cette période. Il y a ainsi l’idée que le Conseil de sécurité de l’ONU est également une tribune pour chaque État et qu’aller au Conseil pour exprimer ses désaccords face aux Russes ou aux Chinois en séance plénière est bon pour son image vis-à-vis de son opinion publique. Pendant la première partie de la Guerre froide, le Conseil servait véritablement de tribune et n’a adopté que très peu de résolutions (par exemple 2 seulement en 1954) ; ne travailler qu’en réunion publique n’est pas la bonne méthode pour permettre des conciliations ou parvenir à des compromis. C’est alors que progressivement, les membres du Conseil se sont mis à utiliser les consultations informelles pour débloquer le processus décisionnel.
Aujourd’hui, nous nous situons dans un entre-deux. Ces consultations informelles fonctionnent toujours et permettent l’adoption des résolutions mais cette tendance à utiliser les séances publiques pour s’opposer vigoureusement à la Chine ou à la Russie s’est accentuée, et cela a un impact sur le processus décisionnel du Conseil et sur sa capacité à prendre en compte de nouveaux sujets, malgré tous les efforts des diplomates et les bonnes relations qu’ils s’efforcent d’entretenir en eux, au-delà des positions prises par leur État. Les consultations informelles sont là pour favoriser les bonnes relations entre ces acteurs qui sont les artisans des résolutions adoptées par le Conseil.
Avez-vous l’impression que le Covid et les contraintes sanitaires ont joué un rôle dans ces relations interpersonnelles ?
Une des choses importantes en diplomatie est la relation que l’on peut nouer avec ses homologues. Se parler en tête à tête, se faire des confidences, élaborer des tactiques en petit comité est primordial dans ce domaine. Le Covid a compliqué tout cela et a donc rigidifié d’une certaine manière les négociations, il les a bureaucratisées, car s’entretenir par téléphone ou à travers une plateforme de communication n’est absolument pas le cadre idéal, d’autant plus la confidentialité des échanges des diplomates ne peut être garantie de manière absolue dans ce contexte.
En mars-avril 2020, il y a eu par ailleurs des tensions extrêmes entre Chinois et Américains à propos de l’origine du virus et de la gestion de la crise sanitaire, ce qui a grandement ralenti le processus de décision du Conseil de sécurité.
La diplomatie écologique est aujourd’hui un sujet relativement nouveau, qui pourrait faire l’objet de convergences ou de divergences prochaines. Pensez-vous qu’elle pourrait avoir un rôle dans le Conseil de sécurité ?
Cela a pris du temps pour le Conseil de sécurité de s’investir sur cette question car que peut-il faire concrètement contre le dérèglement climatique en dehors de prendre des positions très générales ? Le Conseil peut certes demander aux casques bleus de mettre en place une action pour limiter l’impact écologique de leur déploiement. Ces mesures ont été prises depuis plusieurs années maintenant par le Secrétariat.
Le Conseil de sécurité peut également affirmer que le dérèglement climatique a un effet sur les conflits, qu’il peut en générer, notamment autour de la gestion et de la possession de l’eau, et que les « migrants climatiques », qui partent des zones trop inondées comme le Bangladesh pourraient, dans le processus de leur relocalisation, provoquer des tensions. Mais ce sont là des affirmations et des constatations d’ordre global, même si le Conseil de sécurité, dont la fonction est d’assurer la paix et la sécurité internationales, devra à l’avenir sans doute de plus en plus s’occuper des conséquences du changement climatique.
Ni la Russie ni la Chine n’ont d’intérêt à affaiblir plus que nécessaire le Conseil de sécurité.
alexandra novosseloff
Sur ce sujet, le Conseil de sécurité ne semble pas encore uni. En décembre dernier, la Russie a par son veto empêché l’adoption d’un texte présenté par l’Irlande et le Niger, et soutenu par 113 États membres, et dont l’ambition était d’analyser les conflits en « intégrant des données sur les répercussions des changements climatiques sur la sécurité ». L’idée était que le Conseil puisse formellement reconnaître les changements climatiques comme multiplicateurs des facteurs d’instabilité. Avec la Russie, l’Inde s’est opposée à ce texte et la Chine s’est abstenue. Le positionnement du Conseil dans ce contexte devra être scruté de près en faisant attention à ce que le déclaratoire ne l’emporte pas sur l’opérationnel.
Quels sont à votre avis les points de réforme ou de métamorphose qui attendent le Conseil de sécurité dans les prochaines années ?
Je ne vois pas trop ce que pourraient être les métamorphoses, parce que la réforme dont nous parlons est complètement bloquée par les Américains et les Chinois, qui en sont les premiers opposants. De plus, une position comme celle de l’Afrique (qui revendique un droit de veto pour ses représentants à un siège de membre permanent), va à l’encontre de ce qu’avaient accepté, à l’origine, les membres permanents du Conseil. La question de la réforme suscite non nombre de rivalités entre États d’une même région, même si toutes veulent que le Conseil soit élargi.
La question de la réforme du Conseil de sécurité est le serpent de mer des Nations Unies, mais ce n’est pas cela qui l’a empêché d’avancer et l’empêchera de le faire à l’avenir. Ce dernier progresse quand il y a une entente, une coordination entre les membres permanents et avec les membres non permanents. C’est cela la condition de son succès dans sa prise de décision. C’est ainsi qu’il a été conçu, comme dépendant fondamentalement de la conciliation entre ses États membres, et le veto est une espèce de soupape de sécurité par rapport à tout cela qui permet à l’ONU de survivre aux aléas de la paix et de la guerre dans le monde.

