« Constituer une culture commune en temps de crise », une conversation avec Pierre Charbonnier
Quel est l'objectif de Culture écologique ? Dans son dernier livre, Pierre Charbonnier revient sur ce que la prise de conscience écologique veut dire.
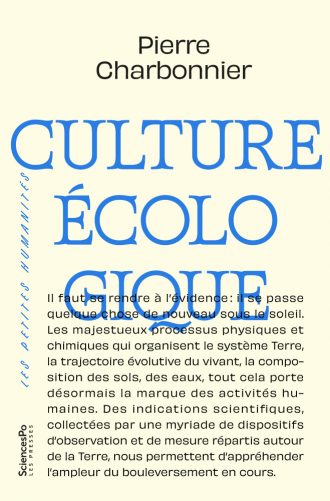
Qu’est-ce qu’une « culture écologique » ? Est-ce un outil intellectuel, politique ? Et quel est le but de ce livre ?
Le livre s’inscrit dans une collection qui est en train de se construire aux Presses de Sciences Po. Le livre de Dominique Cardon, Culture numérique 1, y a déjà paru et il y aura sans doute d’autres volumes dans cette série. Cela correspond à un dispositif intellectuel que l’on peut comprendre de deux manières. D’abord, essayer de proposer à un public élargi une synthèse sur des travaux qui ont été réalisés depuis une ou deux décennies en histoire environnementale, en sociologie des sciences et des techniques, en histoire économique d’une certaine manière, en anthropologie de la nature, c’est-à-dire dans tous les domaines des sciences sociales qui essaient de relire notre histoire et notre actualité sous l’angle des relations collectives au milieu naturel. Et montrer que cela a un sens philosophique et politique.
Ensuite, il y a un aspect pédagogique. Ce livre est le résultat et l’accompagnement de cours que je donne à Sciences Po, donc il peut jouer un rôle d’introduction didactique pour les étudiants, pour les militants, les journalistes, les politiques, administrateurs, les scientifiques, les enseignants, etc. Mais plus généralement, c’est une interrogation sur ce qui peut constituer une culture commune en ces temps de crise politique et climatique. On dit souvent à tort que l’écologie politique gagne du terrain, mais ça n’est pas si évident. Et on peut imaginer qu’une des raisons pour lesquelles elle ne gagne pas de terrain, même si le problème climatique est bien une préoccupation collective, c’est que les moyens par lesquels on construit de la citoyenneté et du savoir commun ne sont pas du tout indexés sur ce type de problème mais plutôt sur le récit national et la recherche de la productivité. Les gens que l’on promeut socialement aujourd’hui ne sont pas ceux qui s’intéressent à l’écologie, ce sont en fait des innovateurs, des cost killers, des « premiers de cordée ». Une étape qui manque est alors peut-être de construire un savoir collectif qui lie la coexistence politique et la coexistence dans un monde avec des caractéristiques écologiques et matérielles singulières. Mon livre ne permet pas à lui seul de faire cela, évidemment, et il y a beaucoup de gens qui mènent et qui ont mené des efforts similaires aux miens. Mais on peut essayer d’envisager les problèmes historiques, économiques, politiques, liés aux relations à la nature comme un pilier de la socialisation démocratique, de la citoyenneté à venir.
Il y a donc dans ce livre la synthèse d’une recherche collective interdisciplinaire et une tentative de poser une base, peut-être pas d’éducation populaire car le livre n’est sans doute pas suffisamment accessible pour cela mais je pourrais dire d’alphabétisation écologique.
Il y a donc l’idée que la culture générale de tout honnête homme du XXIe siècle ne peut plus se cantonner aux humanités et aux sciences, mais qu’elle doit aussi faire place à de nouveaux pans comme le numérique ou l’écologique ?
On peut considérer que ce qui a organisé jusqu’à présent à la fois les savoirs des sciences sociales et d’une certaine manière la construction du pouvoir, ce sont deux choses. D’un côté la construction de l’État moderne, dans son aspect bureaucratique, réglementaire et en tant qu’il accompagne l’approfondissement de la culture démocratique. C’est l’État de droit, ses procédures, ses faillites, ses contradictions. Et de l’autre côté, le capitalisme, c’est-à-dire l’édification d’un ensemble de règles qui organisent l’initiative industrielle, le profit, le travail, et la science économique qui va avec. Si vous voulez partir à la conquête du pouvoir, par exemple, il est assez judicieux de bien connaître les rouages de l’État et les règles du commerce international. C’est ce que l’on enseigne à Sciences Po habituellement et même les sciences sociales, y compris critiques, sont adossées à ces deux grands piliers. Or on peut considérer que ce qui est oublié dans cette organisation des savoirs et des pouvoirs, ce sont les liens permanents qui se construisent entre les institutions sociales et le monde extérieur, le monde naturel, les ressources et les territoires.
Ce qui est oublié dans cette organisation des savoirs et des pouvoirs, ce sont les liens permanents qui se construisent entre les institutions sociales et le monde extérieur, le monde naturel, les ressources et les territoires.
pierre charbonnier
Ce n’est pas inconnu bien sûr, je n’invente rien, je ne fais que mettre en forme des savoirs établis, mais ce n’est pas ce qui revêt un caractère structurant et organisateur. Or à travers toutes ces nouvelles disciplines et sous-disciplines intéressées par la question environnementale, dont je parlais tout à l’heure, on peut imaginer qu’il y a une contestation de ces deux piliers ou peut-être la proposition d’un troisième. Il peut donc être intéressant de présenter ce mouvement interne à l’organisation des savoirs et la façon dont il affecte les formes de pouvoir et de contre-pouvoir à un public un peu plus large que le public universitaire.
Il est intéressant de voir qu’une institution comme Sciences Po compte mettre les études environnementales au centre de ses enseignements. Est-ce une tendance générale dans les universités du monde entier ?
L’une des particularités de Sciences Po est d’être à la fois une université et le lieu de formation des élites, des classes dirigeantes ou dominantes selon le lexique que vous voulez employer. Dans la mesure où l’on ne considère pas d’emblée que toute élite est socialement toxique mais qu’elle doit justifier auprès du peuple et même de l’histoire la position qui lui est accordée, alors mieux vaut qu’elle soit bien formée. C’est un problème de légitimité, à mes yeux : prétendre diriger quoi que ce soit, prétendre incarner le bien commun, sans avoir en tête les contradictions écologiques de notre mode de production, de nos régimes politiques, c’est purement et simplement un abus de pouvoir. Mais pour que les élites, en France ou ailleurs, aient le sens de leurs responsabilités, il faut de nouveaux instruments d’analyse, de nouvelles références, de nouveaux repères historiques. Encore une fois, ce travail est collectif, il mobilise tous les domaines du savoir, mais j’essaie d’y contribuer. J’ajoute que la raison d’être de ces cours c’est aussi qu’il y a une forte demande des étudiants, qui très souvent précède l’offre pédagogique. Il s’agit donc aussi de répondre à cette demande.
Je n’ai pas fait le tour de l’Europe ou du monde pour savoir ce qui a été fait mais cela devient quelque chose d’assez répandu. En France, l’Université Paris-Dauphine le fait déjà mais il est évident qu’il y a un mouvement général dont Sciences Po n’est qu’une partie.
Dans le livre, vous revenez sur ce que vous appelez le mythique néolithique pour montrer que la rupture que constitue un basculement d’un régime socio-écologique à un autre est une simplification et que le passage du chasseur-cueilleur au fermier est en réalité plus souple que les représentations qui en sont faites. Comment ce mythe a-t-il fondamentalement structuré notre vision des questions écologiques ?
Pour écrire ce livre, je me suis intéressé à des choses qui ne font habituellement pas partie de mon domaine de spécialité en tant que chercheur – c’est ce qu’il faut faire quand on écrit un ouvrage à large spectre, d’introduction générale. En particulier, cette question de l’histoire de la domestication. C’est une question passionnante d’abord parce qu’elle a fait l’objet de remaniements scientifiques assez importants depuis quelques années ou décennies. Le grand partage que l’on faisait autrefois entre les sociétés de chasseurs-collecteurs et les sociétés de producteurs (d’un côté, un rapport de prédation à la nature et de l’autre un rapport régi par l’organisation productive, intentionnelle du milieu) n’est pas aussi simple que l’on avait pu l’imaginer. Il existe beaucoup de cas intermédiaires entre prédation et production, et un bon nombre de nos institutions politiques et de nos repères sociaux ont été forgés dans cet intermédiaire plutôt que dans un paradigme productif bien établi. Il est important de reconnaître que les sciences archéologiques ont évolué, car cela remet en question un imaginaire politique, dont Rousseau est l’exemple le plus connu, qui établit ce grand partage entre prédation et production, et la sacralisation de la propriété privée.
Cette idée a joué un rôle central dans la construction de la conscience de soi collective moderne, et une partie des critiques écologiques actuelles du paradigme modernisateur vont puiser dans ces recherches d’archéologie et d’anthropologie pour concevoir des modes de relation au monde qui sont en rupture avec cette fascination pour la production.
Vous soulevez également un paradoxe intéressant. Alors que les sociétés modernes ont de plus en plus invoqué la rationalité, en s’appuyant sur des cadastres, sur le calcul, sur les savoirs scientifiques, elles ont négligé l’impact environnemental de leurs pratiques, amenant dès lors à une surexploitation des corps, des esprits et des terres. Comment expliquer ce paradoxe d’une rationalité à la fois exacerbée et incomplète voire inconséquente car pas poussée jusqu’au bout ?
On pourrait objecter à votre question qu’une rationalité est toujours incomplète, que l’horizon de l’action humaine n’est jamais totalement débarrassé de contradictions et d’épreuves.
Néanmoins, il y a un aspect intéressant de la question. Pourquoi l’organisation de la raison scientifique et politique moderne a à ce point laissé dans l’ombre les effets qu’elle avait sur le milieu ? Si l’on écarte l’hypothèse d’une remise en question intégrale du processus de rationalisation du monde comme le proposaient Adorno, Horkheimer ou certaines critiques radicalement antimodernistes, on est amenés à avoir des hypothèses plus tempérées. Est-ce que, par exemple, et c’est l’hypothèse que certains historiens de l’environnement font aujourd’hui, il y a une affinité structurelle entre le progressisme techno-scientifique et le pouvoir, qui fait passer sous silence les alertes, les questions, les doutes, les risques. C’est la thèse que défend par exemple Jean-Baptiste Fressoz dans ses travaux : le pouvoir a tendance à entretenir ce qu’il appelle la désinhibition face aux risques, parce qu’à la clé, il y a du profit et une source de légitimité politique.
Le grand partage que l’on faisait autrefois entre les sociétés de chasseurs-collecteurs et les sociétés de producteurs n’est pas aussi simple que l’on avait pu l’imaginer.
pierre charbonnier
Le livre Culture écologique ne défend pas spécialement une thèse sur ce sujet, j’essaie plutôt d’en illustrer plusieurs. J’envisage celle évoquée à l’instant, mais j’envisage aussi une interprétation plus classiquement marxiste de l’incapacité de la logique du profit à voir ses externalités sur les humains ou sur le milieu : l’ordre productif surexploite ses biens les plus précieux, et repousse dans le temps le moment de la confrontation avec ces limites matérielles. Et je développe aussi une idée qui est peut-être celle que je favoriserais car c’est celle que je défends dans Abondance et Liberté, qui est l’idée que l’angle mort environnemental du développement de la raison scientifique et politique moderne est aussi suscité par des demandes qui viennent d’en bas. Des demandes de développement, de réponse à des attentes de justice, de bien-être, d’abondance en quelque sorte et qu’il n’y a pas forcément de clivage net entre dominant et dominé mais un point de jonction entre certaines formes de gouvernement, d’administration de la vérité, certaines constructions idéologiques du progrès, et certaines demandes sociales, tout cela convergeant dans des grands projets de développement industriel à l’intérieur desquels la relativisation des risques, des menaces, des incertitudes est assez largement acceptée – du moins temporairement.
C’est pour cela que je fais pas mal de développements sur les pays du Sud ou les situations postcoloniales car lorsque l’on prend l’exemple de l’Inde, de la Chine ou de l’Amérique latine, l’inclusion de la question sociale dans les grandes entreprises de développement technoscientifiques, agraires, industrielles, indique bien une coalition d’intérêts entre certaines formes de gouvernement et certaines attentes sociales qui fait passer sous silence les risques environnementaux. C’est une réflexion sur l’histoire du capitalisme, de l’État, des formes de domination, de la question sociale en général – un processus qui est loin d’être derrière nous. Et pour bien développer cette culture écologique, il faut essayer d’avoir un regard un peu large sur toutes les dimensions du problème.
Vous revenez d’ailleurs sur les critiques du progrès et du modernisme en insistant sur leur diversité.
C’est important parce que très souvent, lorsqu’on s’intéresse à ces questions du strict point de vue du monde occidental, on peut avoir tendance à établir une opposition un peu sommaire entre les promoteurs de la modernisation et les objecteurs, ou les technocritiques comme les appelle François Jarrige. Et l’idée serait que, comme nous n’avons pas entendu les technocritiques, nous avons provoqué une crise climatique, environnementale. Je pense que le schéma est un peu plus compliqué, d’abord parce que la critique du développement industriel, scientifique, de la massification de la production, a émané de secteurs sociaux et idéologiques très variés, parmi lesquels des secteurs très réactionnaires. J’en cite quelques exemples dans le livre, mais ils sont assez célèbres pour certains, car ils n’ont de cesse de revenir dans l’histoire : l’exaltation de la terre, du local, de l’appartenance à une communauté fermée. Il y avait l’idée que l’émergence d’une société civile urbaine, émancipée, qui fait droit à l’égalité entre les hommes et les femmes, en tant que résultat de l’industrialisation de la société, menaçait l’ordre clérical, mais aussi les hiérarchies raciales.
Il peut donc y avoir des alliances entre la critique du schéma de développement industriel et la préservation d’une idéologie conservatrice, et l’abondance actuelle de travaux sur ce qu’on commence à appeler « l’écofascisme » confirme cette alliance possible.
Mais la critique du progrès prend un visage assez différent si on sort du monde occidental. Parmi les mouvements de contestation les plus intéressants du dit paradigme du progrès, il y a ceux qui viennent du Sud. C’est pour cela que je fais un développement assez long sur Gandhi et les débats qui ont agité l’Inde au moment de l’indépendance, au sujet du modèle ou du contre-modèle que pouvait constituer le développement historique de l’Empire britannique, de son aspect industriel. Je pense que la critique qu’élabore Gandhi de la civilisation moderne du train, de la médecine, dès les années 1910, permet d’avoir une conception plus riche des contestations du progrès que ce que l’on pourrait avoir si l’on s’en tient au conflit interne aux modernités occidentales. Gandhi est à ma connaissance le seul qui a essayé de construire un projet réellement politique autour de ce qu’on appelle aujourd’hui la décroissance, autour du refus du développement. Et ce n’est pas du tout le cas des mouvements antimodernes occidentaux. L’influence du gandhisme, et de son opposition aux choix politiques de Nehru après l’indépendance, se retrouve jusque dans les travaux remarquables de l’histoire environnementale indienne, de Ramachandra Guha à Dipesh Chakrabarty, en passant bien sûr par des personnalités comme Vandana Shiva.
Toute une part des critiques de la modernité technoscientifique invoquent la responsabilité du capitalisme, préférant parler d’un Capitalocène plutôt que de l’Anthropocène. Que vous inspire cette vision des choses ?
Je pense que ce genre de débat terminologique peut aider à soulever des questions intéressantes. Mais je ne pense pas que ce soit un débat que l’on puisse trancher en optant pour l’un ou l’autre des deux mots. Anthropocène est un terme effectivement limité car comme l’ont signalé plusieurs chercheurs à juste titre, ce n’est pas n’importe quel anthropos qui est en cause, le problème ne se situe pas au niveau de la constitution spécifique, biologique de l’espèce humaine, car évidemment l’anthropocène intervient bien après l’émergence de l’humain.
Mais derrière l’idée de promouvoir le terme de capitalocène plutôt qu’anthropocène, il y a l’idée tout à fait fausse qu’il n’y a absolument aucune spécificité à la crise climatique : ce serait juste la continuation des crises du capitalisme telles que définies au XIXe siècle. La situation actuelle dans laquelle nous vivons de transformation cataclysmique de la composition chimique de l’atmosphère, des sols et des océans, ce n’est pas une crise standard, ce n’est pas une contradiction ordinaire, interne, du capitalisme. C’est évidemment en lien avec le développement du capitalisme. Mais ça l’est tout autant avec le développement du socialisme et de toutes les idéologies politiques qui ont accompagné et poussé le développement matériel. Il n’y a pas que le capitalisme qui a accompagné le développement matériel, même s’il a évincé tous les autres systèmes. D’ailleurs, on peut tout à fait imaginer que le triomphe d’une révolution communiste mondiale au XXe siècle nous laisserait avec un « bilan carbone » encore pire que celui constaté aujourd’hui, tout simplement parce que ses performances productives et développementales auraient été bien meilleures.
Gandhi est à ma connaissance le seul qui a essayé de construire un projet réellement politique autour de ce qu’on appelle aujourd’hui la décroissance, autour du refus du développement.
pierre charbonnier
Le terme de capitalocène n’est donc guère plus satisfaisant que celui d’anthropocène. Et je pense que, comme disait Spinoza, cela ne sert à rien d’inventer les mots, il faut utiliser les anciens en leur donnant de nouvelles significations. Je n’aime pas faire des propositions sémantiques. J’accepte la discussion sur l’ensemble des qualificatifs de cette crise mais ce qui me gêne est le dogmatisme des différents promoteurs de ces termes. Dans la situation contemporaine, il y a des éléments qui sont liés à l’histoire du capitalisme, des éléments qui sont liés à l’histoire de l’espèce humaine, il y a des éléments qui sont liés à l’histoire des entreprises coloniales et impériales, à l’histoire des rapports de genre : il y a beaucoup de composants. Dire alors qu’il n’est pas possible de comprendre la situation contemporaine si l’on ne lie pas toute son analyse au concept de capitalisme ou à un autre ne me semble pas judicieux.
C’est ce qui est intéressant dans la question écologique. Nous avons affaire à un grand nombre d’acteurs historiques et institutionnels qui sont liés à l’organisation de la connaissance, du pouvoir, des machines, du droit. Et je ne vois pas pourquoi l’un ou l’autre aurait une priorité absolue sur les autres.
Vous identifiez trois grandes « matrices » qui structurent la relation entre les sociétés « modernes » et la nature : l’activité scientifique, la notion de progrès et la conquête territoriale. Comment s’articulent ces matrices dans l’histoire de nos sociétés modernes ?
Un des chapitres de mon livre est assez ambitieux car j’essaie de faire une synthèse en quelques dizaines de pages des spécificités du rapport à la nature tel qu’il prévaut dans les sociétés modernes. L’entreprise est un peu périlleuse mais on peut essayer de faire des synthèses. C’est en effet un certain rapport à la vérité, au temps et à l’espace. Le rapport à la vérité est dominé par l’idéal épistémologique de l’objectivité et du développement des sciences expérimentales, qui s’appliquent in fine à la société elle-même. Le rapport au temps est dominé par la construction idéologique ou presque mythique de l’idée de progrès, d’accomplissement historique d’une société qui se donne ses règles à travers le contrôle de la nature. Et le contrôle de l’espace est dominé par le schème de la conquête, qui peut prendre une forme coloniale – qui est la plus spectaculaire mais n’est pas la seule : c’est l’idée d’une frontière géographique entre les terres incultes et barbares, et les terres soumises à l’encadrement rationnel de l’État et du capital.
Rapport à la vérité, au temps et à l’espace. C’est pour moi une manière de renvoyer la balle à ceux qui ont, avant moi, tenté ce genre de synthèse, comme Philippe Descola. Et c’est aussi une manière d’indiquer, par effet de renvoi historique, que s’il y a un réajustement de nos organisations normatives contemporaines en face du problème climatique, il doit concerner en même temps notre rapport à la vérité, au temps et à l’espace. C’est cela l’idée que j’avais et l’idée était aussi de dire que le capitalisme est un effet second de ces trois grandes matrices. Il est lié aux trois, mais il s’agit peut-être plus d’une conséquence historique de ces trois matrices que d’une réalité véritablement structurante, qui aurait en elle-même sa force motrice et sa logique historique. Mais je consacre tout de même, par la suite, un chapitre sur le capitalisme car comme ce modèle d’économie politique s’est largement imposé, il est intéressant de répondre à la question que l’on me pose toujours qui est : est-ce que le capitalisme est-il compatible avec l’écologie ?
Peut-on donc selon vous trouver des solutions à cette crise écologique sans rompre avec le capitalisme ?
On me demande parfois si le capitalisme est compatible avec la démocratie. Si l’on prend le problème de manière sommaire, on est obligé de répondre non. Le capitalisme, dans sa version pure, abstraite, sauvage, c’est-à-dire faire du profit et regarder comme étant dénué de valeur la simple vie des personnes et la simple réalité du monde, c’est franchement incompatible avec la démocratie. Mais il se trouve qu’historiquement, comme le dit Kojève dans un texte fameux sur Marx et Ford, l’organisation capitaliste de l’économie a fini par trouver une issue, selon ses propres termes, à cette contradiction entre le profit et la vie, en fournissant un compromis aux travailleurs, et donc en sauvant sa peau tout en acceptant à contrecœur une forme de démocratisation. Cela ne signifie pas qu’il n’y a plus de contradiction entre capitalisme et démocratie mais qu’il y a un arrangement stratégique entre deux formes institutionnelles qui se stabilisent temporairement.
L’organisation capitaliste de l’économie a fini par trouver une issue, selon ses propres termes, à cette contradiction entre le profit et la vie, en fournissant un compromis aux travailleurs, et donc en sauvant sa peau tout en acceptant à contrecœur une forme de démocratisation.
Pierre charbonnier
Le rapport entre capitalisme et écologie est assez similaire. On peut dire d’abord que de la même manière que le capitalisme surexploite et dévalorise une ressource qui lui est indispensable, c’est-à-dire le travail, il surexploite et dévalorise une autre ressource qui lui est tout aussi indispensable, le sol, la terre, le milieu, ou comme on dit parfois les biens communs. Il est incapable de se reproduire par ses propres moyens et donc il a besoin de béquilles régulatrices, et en particulier des béquilles « environnementales », sans lesquelles les gens et les milieux dépérissent très rapidement. La période que l’on vit aujourd’hui nous met face à cette question. Est-ce que ce qui est en jeu est une abolition de toute modalité de l’économie du profit ou est-ce que ce qui est en jeu est un réajustement de ce régime économique, de la même manière qu’il a fait l’objet d’un réajustement après la Seconde Guerre mondiale pour rendre tolérable la démocratie ? Est-ce qu’on est face à un réajustement régulateur du capitalisme qui vise à le sauver en même temps que la planète, au sens où il se donnerait à nouveau un avenir, comme lorsqu’on a inventé la Sécurité sociale et les congés payés ?
Je n’ai pas de doctrine sur cette question. Comme nous tous, je traverse cette période en me posant la même question que vous, sans vouloir lui donner d’issue dogmatique. Si un mouvement majoritaire se construit et parvient dans l’épreuve climatique, à abolir toutes les relations sociales capitalistes, j’en serais ravi. Si un mouvement social majoritaire parvient à imposer une régulation à la fois environnementale et démocratique du capitalisme, un peu comme ce que proposait Polanyi – démarchandisation totale des secteurs clefs : travail, monnaie et terre-, je suis content également. On est tellement loin de l’un ou l’autre de ces objectifs que je crois qu’il ne faut pas être trop sélectif. On peut, sur un mode purement spéculatif, faire des plans, des listes d’envies idéologiques mais cela ne m’intéresse pas.
Lorsque vous affirmez que le capitalisme a su prendre à sa charge la démocratie, c’est parce qu’il y avait une menace, la peur du communisme. La menace de l’effondrement, le spectre du collapse, peuvent-ils jouer aujourd’hui le même rôle ?
L’analogie historique est intéressante. Le capitalisme ne s’est pas démocratisé tout seul mais sous la menace de l’hypothèse communiste et également dans une conjoncture historique où la classe propriétaire s’est beaucoup compromise, notamment avec l’occupant allemand pendant la guerre.
A-t-on aujourd’hui l’équivalent historique de cette menace susceptible de créer un rapport de force bénéficiaire à la majorité sociale qui travaille et supporte les conséquences de la crise écologique et climatique ? Je ne suis pas sûr qu’on l’ait, et je ne suis surtout pas sûr que le collapse puisse jouer ce rôle. Je pense que l’URSS était beaucoup plus efficace pour tirer quelque chose de la classe propriétaire occidentale que ne l’est Extinction Rebellion ou la collapsologie pour faire bouger les rapports de force. C’est la stratégie, plus largement, dite de la « génération climat » : il y aurait un groupe social qui désigne le grand monstre climatique qui vient frapper à la porte et tout emporter, et la pression morale qu’elle exerce sur les classes dirigeantes serait suffisante pour faire bouger des lignes véritablement politiques. Mais ce récit est trop idéaliste à mes yeux.
On peut, sur un mode purement spéculatif, faire des plans, des listes d’envies idéologiques mais cela ne m’intéresse pas.
pierre charbonnier
Il manque quelque chose qui se situe au niveau de l’expérience immédiate de la domination, de l’aliénation, de la dégradation de la qualité de vie de la majorité. On entre ici dans un débat véritablement politique, à savoir : a-t-on les moyens concrets pour réaliser une coalition d’intérêts sociaux capable de renverser le statu quo politique et économique ? Ce ne sont pas des questions que je traite dans le livre car j’essaie dans cet ouvrage d’être à un niveau moins polémique. J’essaie plutôt de poser les éléments du terrain plutôt que de rentrer là-dedans : j’essaierai de faire cela dans d’autres publications et d’autres contextes.
Il est nécessaire en tout cas, pour que cette coalition d’intérêts se forme dans un avenir proche, qu’une masse critique de citoyens soit capable de retranscrire son expérience ordinaire, son expérience du travail, de l’aliénation, de l’amoindrissement de ses capacités, en référence à l’histoire et au présent des rapports collectifs à la nature.
Il est souvent affirmé que les préoccupations environnementales émergent principalement dans les années 1960-1970. En réalité, cette « prise de conscience » a des origines lointaines, et très diverses. Finalement, la prise de conscience de l’influence humaine sur l’environnement n’est pas si récente ?
Non seulement elle n’est pas récente, mais en plus on peut contester même – comme je le fais dans mon chapitre sur le mouvement environnemental – l’idée de prise de conscience. Là encore c’est un apport essentiel de l’histoire environnementale. Comme il y a toujours eu de la réflexivité environnementale, c’est-à-dire qu’à chaque fois qu’il y a de l’innovation, l’introduction de nouveaux choix technologiques, il y a de la résistance, des débats, de la controverse, des incertitudes, cette conscience est toujours là. Simplement, elle est soit relativisée, soit remise à plus tard, soit désactivée. Et donc nous voyons plutôt des vagues. Il y a des moments de plus grand optimisme et des moments plus pessimistes. Les moments de la Révolution française ou d’après la Seconde Guerre mondiale sont des grands moments d’optimisme tandis que la période de la fin du XIXe – début XXe marquée par des crises engendre beaucoup de réflexivités environnementales, de même que la période des années 1960-70 où les questions démographiques, de limites, se posent, engendrent plus de réflexivité ou d’angoisses.
C’est donc par vague plutôt qu’un mouvement continu, graduel, de prise de conscience qui aurait pour unique destinée de s’accroître. Encore une fois, la réflexivité environnementale n’a pas que des bons côtés : elle peut alimenter des idéologies de repli et des instincts malthusiens, elle peut jeter le doute sur des apports utiles des sciences, elle a donc aussi ses dérèglements.
À cela s’ajoute qu’il y a des discontinuités dans la forme de la conscience environnementale. Dans les années 1950-1960, par exemple, la question environnementale est massivement structurée par l’internationalisme de l’ONU et l’idée d’un consensus scientifique uniforme : c’est une question dont on considère qu’elle convoque l’humanité en général, sa capacité à faire la paix, à surmonter les conflits d’intérêts entre nations – c’est un environnementalisme humanitaire, internationaliste, qui est mû par de grands universaux un peu abstraits.
La réflexivité environnementale n’a pas que des bons côtés : elle peut alimenter des idéologies de repli et des instincts malthusiens, elle peut jeter le doute sur des apports utiles des sciences, elle a donc aussi ses dérèglements.
pierre charbonnier
Aujourd’hui, cette rhétorique humanitaire, universaliste, a beaucoup reculé dans le mouvement environnemental et fait place à une rhétorique plus franchement sociale où l’on voit une convergence entre la question des inégalités, de la justice, des rapports de domination et la problématique écologique. C’est un bon signe car on se rapproche de la vérité de ce qu’est cette crise, mais cela peut aussi n’être qu’une période parmi d’autres dans les régimes de réflexivité environnementale, et encore une fois un environnementalisme plus réactionnaire peut tout à fait revenir et s’imposer.
Sur quel terreau se fonde donc l’écologie politique ? N’est-ce qu’une forme moderne de la réflexivité environnementale ou peut-on quand même dire que la naissance de l’écologie politique est un tournant voire une rupture dans l’histoire de celle-ci ?
L’écologie politique tire profit de la logique démocratique et les partis collectent des aspirations collectives qu’ils trouvent dans certains secteurs de la société afin de les faire avancer dans le jeu de la rivalité électorale. Donc l’écologie politique, entendue comme structuration en parti des questions environnementales, est l’une des formes que prend la réflexivité environnementale dans la conjoncture actuelle. Mais elle est continuellement en train d’émerger. Cela fait cinquante ans que l’on dit que l’écologie politique est en train d’émerger, mais peut-être qu’en regardant les sondages qui sortent, nous pourrions penser à sortir de cette idée. Elle n’émerge pas mais elle stagne, précisément parce que son point de jonction avec la question sociale n’a pas encore été réellement atteint. Elle est proclamée, annoncée mais pas effectuée.
Nous en avions discuté dans une de vos conférences du mardi avec Paul Magnette, Chantal Mouffe et Ulysse Lojkine 2, et c’est le constat que faisait ce dernier en introduction de cette conférence : il ne semble pas y avoir d’alignement parfait entre conflit social – le conflit de classe – et le conflit d’intérêts au sujet de la crise climatique. Beaucoup de segments de la classe populaire, ouvrière, sont carbon captured, pour reprendre le titre d’un livre intéressant sur la question 3, ils sont sous le pouvoir du prix des énergies fossiles nécessaires pour travailler, se déplacer, parce que les énergies fossiles peu chères sont aussi un des aspects du pouvoir d’achat. Il y a donc une capture objective de certains segments de la société et donc de l’électorat par le statu quo fossile.
C’est ce que les sociologues Mark Blyth et Thomas Oatley appellent la carbon coalition qui rassemble les grands industriels de la filière et certains segments des classes populaires 4. Réussir à briser cela est difficile, et d’autant plus que ce qui est face à cette coalition, la coalition post-carbone, ce sont les gens comme vous et moi, des urbains, qui ont bénéficié de structures éducatives de qualité qui sont de plus en réservées à une portion congrue de la population et qui n’ont pas trop envie de perdre ces privilèges. Nous pouvons ou pensons pouvoir nous permettre l’abandon du statu quo carbone parce que c’est notre intérêt. Cela crée un jeu de rivalités avec les classes populaires. Je pense donc que la seule manière de s’en sortir est qu’un groupe politique créé artificiellement l’alliance entre des groupes sociaux pour l’instant encore opposés les uns aux autres et de réaligner la question sociale avec la question climatique. Mais pas grand monde ne sait quel sera le vecteur de ce réalignement.
L’écologie politique, entendue comme structuration en parti des questions environnementales, est l’une des formes que prend la réflexivité environnementale dans la conjoncture actuelle.
pierre charbonnier
On peut penser que la clé se trouve dans l’attitude à l’égard des migrations. Puisque celles-ci sont et seront accélérées par la crise climatique, accentuant notre appartenance globale, voire planétaire, plutôt que nationale, et puisque la conception sociale de la solidarité et de la liberté a généralement dans l’histoire été de pair avec le pluralisme culturel, alors on peut imaginer que la coalition majoritaire post-fossiles trouvera son équilibre en tant que réponse aux diverses formes que prend en ce moment l’obsession nationale et identitaire. J’emprunte une formule à Clément Sénéchal, qui me disait récemment que la figure du migrant pourrait être le code d’accès à la construction d’une politique climatique réellement progressiste.
Ce n’est donc pas simplement un problème de déficit de « culture écologique » populaire ?
En effet, mais les formes de connaissance sont toujours impliquées dans la construction d’une coalition sociale. Ce n’est donc pas qu’une question triviale de condition de vie, de budget, de salaire. C’est également la manière dont on perçoit notre situation dans des rapports d’autorité, de pouvoir, de connaissance, dans des rapports à l’avenir.
Nous avions discuté avec Paul Guillibert de l’alliance possible entre mouvements écologistes et classes populaires, ouvrières qui ferait partie de cette coalition carbon-captured. L’exemple de la raffinerie de Grandpuits, où les écologistes se sont mobilisés pour la défense des intérêts de travailleurs a montré la possibilité de l’émergence d’une nouvelle coalition. Est-ce que c’est dans le sens de cette alliance que pourrait ou devrait se faire une nouvelle coalition ?
C’est un bon exemple, mais qui a surtout une portée géopolitique. Les travailleurs du fossile ne sont pas si nombreux en France, à l’échelle européenne un peu plus, notamment avec le cas de la Pologne, mais c’est surtout une question internationale. C’est pourquoi les questions de transferts de fonds du Nord au Sud dans le dernier cycle de la COP étaient si importantes. Il y a la question de l’adaptation, il faut leur donner de l’argent afin de les aider à s’adapter à des conséquences immédiates du changement climatique, ce qui coûte cher. Mais il y a également la question du financement de la transition pour des pays qui n’en ont pas encore les moyens tout en devant l’essentiel de leur prospérité aux énergies fossiles bon marché. Donc ce qui est en jeu est le découplage de l’appareil d’État indien et / ou chinois du charbon ou du pétrole, et peut-être que cela vaut le coup de leur proposer quelques milliards afin de pouvoir payer l’assurance-chômage de ceux qui travaillent dans les mines.
Vous distinguez deux critiques radicales du capitalisme liées à des préoccupations environnementales, l’idée de décroissance et le projet écoféministe ou intersectionnel. Pourquoi avoir choisi ces deux types de contestations en particulier ?
Dans l’avant-dernier chapitre du livre, j’essaie de faire un tour d’horizon des différentes propositions de réajustement de l’économie politique sous la contrainte écologique et climatique. Je parle du capitalisme vert, des propositions comme le Green New Deal, donc néo-keynésiennes, et j’essaie aussi de faire place à des critiques plus radicales d’inspiration décroissante, écoféministe, d’écologie postcoloniale. Ce sont des courants de pensée et d’activisme qui témoignent de l’effet tache d’huile culturelle de la question écologique. On voit aujourd’hui des gens, par exemple dans les milieux féministes, qui affirment que la question écologique et la question des rapports de genre sont indissociables. Et l’argument principal c’est la dévalorisation du travail de reproduction, d’entretien de la société, qui va de pair avec la survalorisation du travail productif : puisque ce contraste suit les contours de la division sexuelle du travail, la subordination du travail des unes au travail des autres s’inscrit bien dans la dévalorisation de tout ce qui relève de l’entretien, de la perpétuation ou de la reproduction sociale.
C’est une manière très intéressante d’établir des liens historiques, critiques, entre les deux causes. Mais il y a un autre phénomène, tout aussi intéressant, qui est le fait que le caractère presque unanime de la préoccupation pour l’écologie et le climat incite certaines activistes féministes à se mettre sur les rails de cette critique pour obtenir de la reconnaissance et pour créer des alliances. De la même manière avec la critique d’inspiration décoloniale des systèmes politiques, économiques. Donc à mes yeux, la dynamique de coalition, encore une fois, entre différents mouvements critiques qui ont à peu près les mêmes ennemis, est aussi intéressante que l’établissement d’une vérité historique, voire dogmatique, sur la coïncidence absolue entre domination masculine et destruction de la nature. On dit parfois que l’on ne peut être écologiste que si on est aussi féministes ou décoloniaux, mais peut-être que la construction de passerelles intellectuelles, critiques, idéologiques, militantes entre différentes sphères de préoccupations n’implique pas nécessairement une intransigeance dogmatique qui affirmerait que l’on ne peut être X que si l’on est Y. Car, par exemple, nous pourrions imaginer que ce ne soit pas entièrement judicieux de subordonner toute la critique féministe de la société à des considérations écologiques, qu’une partie de ce programme intellectuel est autonome dans ses instruments d’analyse et ses finalités politiques. En tout cas deux choses sont certaines : l’écologie, le féminisme et l’anti-impérialisme ont en commun de s’attirer les foudres des réactionnaires et nationalistes, ce qui les rassemble de facto dans une alliance des énergies émancipatrices ; et ce sont des questions qui font l’objet de beaucoup de questionnements de la part des étudiants, donc nous n’avons pas d’autre choix que d’y réfléchir.
Sources
- Dominique Cardon, Culture numérique, Presses de Sciences Po, 2019, 430 p.
- L’écosocialisme peut-il devenir une force politique européenne ?, Conférence du 30 novembre 2021
- Matto Mildenberger, Carbon Captured : How Business and Labor Control Climate Politics, MIT Press, 2020, 368p.
- Thomas Oatley et Mark Blyth, The Death of the Carbon Coalition, Foreign Policy, 12 février 2021

