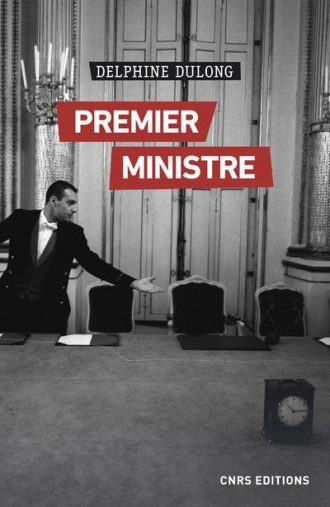Premier ministre
Le rôle de Premier ministre en France est une construction sociologique et historique. Si le couple Président-Premier ministre est conçu par la Constitution comme une dyarchie, c'est la pratique, plus que le droit, qui a façonné la fonction. Nous publions les bonnes feuilles de l'ouvrage, paru aux éditions du CNRS.
Introduction
Dans un des tout premiers commentaires sur la Ve République, le politologue Maurice Duverger soulevait un problème qui fait étrangement écho soixante ans plus tard :
« Le Premier ministre existe-t-il ? Ce n’est pas sûr. […] Le Premier ministre devrait être d’abord l’organisateur des “publics relations” entre l’exécutif et le Parlement. Exposer aux chambres la politique du gouvernement, défendre devant elle ses projets, répondre aux questions de politique générale ; désarmer ses adversaires, rallier et convaincre les hésitants, galvaniser les partisans ; tenir sur les points essentiels, céder à l’occasion sur les points secondaires et définir les compromis nécessaires […]. Le Premier ministre devrait être, d’autre part, le leader de la majorité parlementaire, son chef reconnu, respecté, obéi. Il ne l’est point. […] Il n’est point non plus un chef de gouvernement, respecté de tous les ministres, il n’a d’autorité que sur très peu d’entre eux […]. La plupart, pour toutes les questions importantes, cherchent à établir un contact direct avec le Président de la République. Ils préfèrent s’adresser à Dieu plutôt qu’à St Pierre […]. On n’hésite, cependant, à accabler M. Michel Debré. Il n’est pas l’homme de son rôle, certes. Mais le rôle est-il tenable ? Un autre jouerait-il mieux1 ? »
L’histoire a depuis tranché : de Pierre Messmer, dont « l’insignifiance [aurait] dépouillé de ses derniers restes d’existence politique le poste de Premier ministre » selon L’Express (14 août 1972), à Jean Castex dont les interventions publiques sont la risée de tous les réseaux sociaux, peu d’acteurs politiques ont endossé ce rôle politique avec succès. Et ceux qui semblaient y parvenir, comme dernièrement Édouard Philippe, ont vite été remerciés par le Président de la République. La crise générée par la pandémie du COVID‐19 en 2020 ne fait à cet égard que mettre en lumière un problème aussi ancien que central dans la vie politique française, celui de la dyarchie du pouvoir exécutif.
Beaucoup l’ignorent en effet mais la Constitution française n’établit pas de hiérarchie claire entre le Président et le Premier ministre. Si elle confie au Président un certain nombre de pouvoirs, c’est avant tout pour arbitrer et non pour gouverner. Il n’y a que dans les régimes présidentiels, très minoritaires, que les Présidents gouvernent. Ces derniers n’ont alors pas de Premier ministre. Dans les autres régimes démocratiques, c’est le Parlement ou plus souvent le chef du gouvernement – « Premier ministre » en Grande Bretagne, « Chancelier » en Allemagne, « Président du Conseil » en Italie, etc. – qui dirige la politique de la nation. Conformément à cette tradition, l’article 21 de la Constitution de 1958 confie au Premier ministre le soin de diriger le gouvernement. Situé au sommet de l’État, au point d’intersection de tous les espaces sociaux, il doit ainsi « faire fonctionner le gouvernement, les relations avec le Parlement, les administrations, recevoir les syndicats, les représentants des collectivités locales, les personnalités de l’outre-mer, les dirigeants étrangers2 ». Cependant, en vertu d’une règle coutumière établie très tôt pour régler le problème de la dyarchie, le Premier ministre doit en même temps s’effacer devant le Président. La singularité du Premier ministre français est là, dans cette contradiction majeure entre ses fonctions constitutionnelles et le rôle qu’il doit performer pour rendre sensible à tous sa position subordonnée vis-à-vis du Président3. Vu sous cet angle, le Premier ministre n’apparaît dès lors pas si insignifiant que cela, bien au contraire, il s’analyse, pour reprendre les mots d’Olivier Duhamel, comme la véritable « clé de voûte » du régime.
Rôle pivot dont dépend pour partie la prééminence du Président, le Premier ministre est en effet particulièrement heuristique pour éclairer le fonctionnement de la Ve République. Pour la science politique, l’enjeu n’est pas nul. Car si elle a su développer une approche originale des institutions politiques, elle ne les appréhende le plus souvent que de manière isolée4. La connaissance qui en résulte sur le régime politique est par conséquent segmentée et néglige par trop les relations interinstitutionnelles. Or, comme on le verra, c’est par et dans ses relations avec les autres institutions politiques que se construit le Premier ministre.
Il ne s’agit toutefois pas seulement de revenir à nouveau frais sur la présidentialisation du régime en se plaçant du côté des « perdants ». Le Premier ministre est aussi intéressant à étudier en raison de la faible codification juridique du poste. La Constitution, en effet, ne lui consacre que deux articles contre quinze pour le Président. Elle prévoit en outre un partage flou des tâches entre Matignon et l’Élysée qui a trois conséquences importantes : la division du travail au sein du pouvoir exécutif, partant les définitions des rôles respectifs du Premier ministre et du Président, sont largement interdépendantes ; cette délimitation repose moins sur le droit que sur la pratique des acteurs ; elle est donc potentiellement variable d’une configuration politique à une autre. En d’autres termes, ceux de Maurice Duverger, « si le Président de la République gouverne, le Premier ministre est réduit à l’impuissance ; si le Premier ministre gouverne, le Président de la République s’efface5 ».
Au flou qui entoure la définition de l’institution et la condamne à l’impressionnisme – d’ailleurs revendiqué par un Premier ministre6 – s’ajoute la faible objectivation juridique du travail gouvernemental. Le Premier ministre peut certes s’appuyer sur un stock de connaissances stabilisées pour coordonner l’action du gouvernement. Il peut compter sur le Secrétariat général du gouvernement qui est en quelque sorte la mémoire du gouvernement7 ; il peut s’appuyer sur les règles du protocole ou certaines routines institutionnelles qui se sont mises en place avec le temps – le Conseil des ministres le mercredi, la division du travail entre chef de cabinet et directeur de cabinet, etc. Mais l’organisation du travail gouvernemental n’est pas plus figée dans le marbre du droit que le rôle de Premier ministre8. Il n’y a pas de règlement intérieur des travaux du gouvernement comme celui qui avait été adopté en 1947. Le nombre de ministères n’est pas prédéterminé puisque la décision relève du pouvoir réglementaire, tout comme les attributions des ministères9 – lesquelles sont d’autant plus floues et imprécises qu’elles sont de potentielles sources de conflits10. Et si la composition des cabinets ministériels est davantage encadrée par le droit11, celle du cabinet du Premier ministre lui échappe. Par conséquent, l’organisation du travail gouvernemental repose sur la personne même du chef de gouvernement qui en décide librement dans les limites que lui imposent le Président et les contraintes partisanes.
On comprend dans ces conditions qu’on ait pu penser que « le sujet se prête mal aux développements théoriques12 ». Ce défaut d’objectivation juridique explique certes le peu d’études consacrées à cette institution en droit13. En revanche, il n’explique pas l’indifférence des sciences humaines et sociales14. Car si on sait pourquoi la subordination du Premier ministre au Président est devenue une prescription majeure de ce rôle politique, on ne sait pas comment. Or la question se pose d’autant plus que la conformation à cette prescription de rôle place les Premiers ministres en situation de double bind et du même coup dans une grande insécurité : leur autorité sur le gouvernement et la majorité ne peut s’affirmer que dans les limites du respect de la prééminence présidentielle.
Ces injonctions contradictoires soulèvent par ailleurs d’autres questions. Comment fait-on pour performer ce type de rôle ? Quelles dispositions faut-il pour tenir ensemble ces attentes contradictoires ? La réponse à ces questions n’a rien d’évident au regard du groupe hétéroclite que composent ceux qui ont successivement endossé le rôle de Premier ministre. Certains sont issus d’une famille bourgeoise, d’autres de milieux modestes. Certains sont de droite, d’autres de gauche, et d’autres encore sont sans attaches partisanes. Ils n’ont pas tous le même type d’expérience professionnelle : les uns sont hauts fonctionnaires, les autres des professionnels de la politique. Surtout, ils ne sont pas toujours de « fidèles » compagnons de route du Président.
Malgré toutes ces différences, la manière dont ils rendent sensible aux autres leur position converge sur des points essentiels. Excepté les périodes de cohabitation, tous affichent leur subordination au Président, même quand ils sont fortement dotés en capitaux (comme Michel Rocard). Avec bien sûr plus ou moins de succès, ils s’efforcent d’assurer l’unité du gouvernement, même quand il s’agit d’un gouvernement de coalition (comme pour Lionel Jospin). Ils mènent la bataille contre l’opposition au Parlement et les campagnes électorales, même lorsqu’ils n’ont aucune expérience du militantisme politique (Georges Pompidou, Raymond Barre, Dominique de Villepin). Enfin, ils font tous sauf exception un usage limité des armes juridiques qu’ils possèdent pour discipliner les parlementaires. Il y a donc bien eu « un processus de structuration relativement durable d’un collectif autour de comportements routiniers et de conceptions partagées15 ». Comment l’expliquer ? Comment se fait-il qu’un rôle aussi peu codifié et cohérent ait pu s’institutionnaliser au point de s’imposer à des acteurs aux dispositions variables et parfois mal ajustées ?
Plusieurs postulats et partis pris épistémologiques ont guidé la recherche qui a présidé aux réponses que l’on apporte à ces différentes questions dans les pages qui suivent. Le premier découle des constats précédents. Si le droit fait défaut, cela signifie que le rôle s’est construit avant tout en actes, plus précisément dans la relation du Premier ministre avec les autres acteurs de la vie la politique dont il est la cheville ouvrière. C’est ce que démontrent les quatre parties qui composent ce livre. La première éclaire le dispositif (pour reprendre la notion de Michel Foucault) que les Présidents ont mis en place pour discipliner leurs Premiers ministres. La deuxième déplace la focale vers le gouvernement et montre comment le Premier ministre est devenu, selon les mots de Matthieu Caron, un primus inter pares à défaut de pouvoir en revendiquer le leadership politique. Dans la troisième partie, c’est le travail de mobilisation de la majorité qui est mis au jour ainsi que sa principale conséquence, la politisation du rôle. Enfin, la dernière partie a pour principal objectif d’interroger ce que le rôle fait aux acteurs, et traite simultanément du contrôle social qu’exercent les journalistes sur la conduite des Premiers ministres.
Cette approche relationnelle n’est pas sans danger. Dans un monde aussi agonistique qu’est le champ politique, elle conduit à hypertrophier les enjeux de pouvoir au détriment des conditions les plus prosaïques du travail gouvernemental16 et des représentations subjectives des acteurs. Ce faisant, elle expose au travers commun des récits journalistiques et autobiographiques, celui de l’illusion héroïque de l’acteur rationnel décidant seul. Bien sûr, ici plus qu’ailleurs les acteurs anticipent, calculent et déploient des stratégies. Mais ils ne le font pas dans un univers vide de contraintes et n’en maîtrisent jamais entièrement les conséquences.
C’est là un autre postulat sur lequel repose l’analyse qui suit. Elle porte une attention soutenue aux ressources et contraintes qui pèsent sur la conduite des Premiers ministres, à l’instar des entourages qui influent à la fois sur la perception que les Premiers ministres ont des problèmes ainsi que sur la définition des solutions. L’analyse part aussi du principe que les jeux de pouvoir dans lesquels ils sont pris n’interdisent pas d’interroger les valeurs au nom desquelles ils se battent. Car quoi qu’on en dise, un Premier ministre socialiste n’est pas interchangeable avec un Premier ministre de droite : ils peuvent parfois partager des priorités en matière d’action publique, ils n’ont cependant pas exactement la même conception de l’ordre gouvernemental ni le même rapport à leur majorité parlementaire. Ce parti pris en entraîne un autre : la socialisation des acteurs est ici envisagée comme un élément clé du rapport au poste, ce qui n’empêche pas ce rapport d’évoluer par un effet de socialisation propre à l’institution gouvernementale qu’on aura l’occasion de montrer.
Prendre au sérieux toutes ces variables dans l’analyse ne signifie pas pour autant que l’on verse dans une sociologie déterministe. La sociologie qui inspire ce livre s’efforce au contraire de tenir à égale distance l’idée que les acteurs sont de purs stratèges et son antithèse, l’idée qu’ils sont agis. Conformément au postulat qui fonde la sociologie des institutions en France, selon lequel la relation entre « l’acteur et le système » est de type dialectique17, elle s’efforce de comprendre à quelles conditions le rôle s’impose aux acteurs mais aussi dans quelle mesure chacun d’eux prend part à sa construction et à son institutionnalisation.
La sociologie qui inspire ce livre est en outre attentive à la temporalité des processus étudiés. Si le temps long est son horizon, elle ne néglige pas les différentes configurations politiques dans lesquelles les Premiers ministres s’inscrivent, ne serait-ce que parce que ces configurations informent en grande partie leurs préférences. Le fait de disposer ou non, en tant que Premier ministre, d’une majorité confortable, solide et cohérente à l’Assemblée nationale n’est pas anodin : cela conditionne sa marge de liberté. Par ailleurs, dans un champ pour partie régi par les élections, le calendrier électoral pèse très fortement sur les anticipations des acteurs et donc sur leur décision, leur conduite et bien sûr sur le destin des Premiers ministres. Enfin, s’il faut être attentif aux questions de temporalité ici c’est que le stock de connaissances sur le rôle et, de manière plus générale, sur les règles tacites du régime politique ne sont pas les mêmes en 1959 et en 2021. Autrement dit, ce n’est pas la même chose d’endosser le rôle aujourd’hui et dans les années 1970. Non seulement le rôle du Premier ministre et celui du Président ont évolué mais l’espace du possible et du pensable n’est pas identique : des « précédents » ont été peu à peu établis comme autant d’œillères qui orientent le sens pratique des acteurs.
Un dernier choix reste à préciser. Tout au long de la recherche s’est posée la question des modalités de sa restitution. Pour des raisons qui tiennent aussi bien à l’ampleur du terrain d’étude qu’au caractère parcellaire des sources18 ou encore à la lisibilité du propos19, nous avons opté pour un exposé hybride, mêlant échelle temporelle courte sur des études de cas et échelle temporelle longue portant sur tout ou partie du groupe. Dans chaque partie, l’analyse s’arrête ainsi plus particulièrement sur un ou plusieurs cas, ce qui pourrait donner l’impression au lecteur épris d’histoire d’un exposé impressionniste, à l’image du rôle étudié. On voudrait donc tout d’abord rappeler ici que le propos du livre n’est pas de restituer l’histoire des Premiers ministres sous la Ve République mais de comprendre comment s’est construit puis objectivé le rôle20. On voudrait ensuite préciser que le choix des cas développés dans tel ou tel chapitre n’a rien d’arbitraire. Le cas du gouvernement Michel Debré est systématiquement convoqué pour expliquer l’intention originelle des constituants. Si l’on développe celui de Georges Pompidou dans la première partie, c’est entre autres parce qu’il est un moment clé dans la bascule des rapports entre Président et Premier ministre. Creuser le cas du premier gouvernement socialiste Pierre Mauroy dans la partie suivante est pertinent pour mesurer l’institutionnalisation du rôle. Il ne l’est pas en revanche pour démontrer la politisation qu’engendre inévitablement le dialogue avec la majorité parlementaire et la bataille contre l’opposition. Sur ce point, Raymond Barre est bien plus démonstratif dans la mesure où il n’a aucune expérience partisane ou élective lorsqu’il devient Premier ministre. En résumé, le choix des cas développés s’est fait sur le fondement de leurs propriétés démonstratives et/ou représentatives du groupe (ou d’un sous-groupe), à chaque fois explicitées en début d’analyse.
Par ailleurs, lorsque cela était possible, i.e. dès lors que nous dispositions d’éléments de comparaison suffisants, nous avons procédé à une analyse générale, parfois objectivée par des statistiques descriptives. Au total, tous les Premiers ministres de la Ve République, de 1959 à 2021, sont traités dans ce livre. Certains sont plus minutieusement analysés que d’autres mais c’est bien normal : entre Bernard Cazeneuve, qui est resté moins d’un an pour achever le quinquennat de François Hollande, et Georges Pompidou ou François Fillon, qui sont respectivement restés six et cinq ans, l’importance accordée ne pouvait être la même. Édith Cresson, qui est la seule femme du groupe et celle qui est restée le moins longtemps, méritait qu’on s’arrête sur son cas à plus d’un titre. Jacques Chirac également dès lors qu’il est l’un des rares Premiers ministres à avoir démissionné de son plein gré, à avoir endossé le rôle à deux reprises (dont une fois en période de cohabitation) et à avoir conquis l’Élysée. Ces choix ne reflètent évidemment pas la valeur que l’on accorde aux personnes mais l’intérêt heuristique de leur expérience21.
Chapitre 5
Les socialistes et « la force des institutions »
Indépendamment des multiples contraintes qu’ils rencontrent dans l’exercice de leur fonction, les Premiers ministres sont inégalement disposés à devenir « chef du gouvernement ». Comment prétendre avoir une autorité politique sur les ministres quand on a, comme certains, moins de capital politique qu’eux ? Comment acquiert-on ce sens de l’État si fondamental à l’exercice du pouvoir exécutif quand on n’est pas énarque et qu’on méconnaît totalement l’ordre gouvernemental ? Comment revendiquer enfin le titre de chef auprès de ses « camarades » quand on a un ethos militant et un rapport collectif aux activités politiques ?
Le cas de Pierre Mauroy permet de répondre à ces questions tout en éclairant un moment clé de l’institutionnalisation du rôle. En effet, l’alternance de 1981 promeut au gouvernement des élites « roses » vierges de tout exercice du pouvoir exécutif. Beaucoup ont une expérience du pouvoir local, aucun n’a été ministre. Les viviers dans lesquels les membres du gouvernement puisent leurs collaborateurs ne sont pas non plus les mêmes que dans les gouvernements précédents : la part des hauts fonctionnaires, qui maîtrisent les rouages de l’administration, recule face aux enseignants du supérieur ou du secondaire plus souvent formés aux études littéraires que juridiques22. Ces élites roses, par ailleurs, sont bien plus imprégnées des logiques partisanes que ne l’étaient avant eux leurs homologues giscardiens et gaullistes23. Elles ont une vision plus collective de la vie politique doublée d’un rapport méfiant pour ne pas dire hostile à l’appareil d’État centralisateur – comme en attestent les lois de décentralisation de 1982 et 1983.
En somme, rien ne les dispose à se conformer à un ordre institutionnel qu’elles veulent au contraire transformer. Et pourtant, dès 1985 Pierre Birnbaum constate :
« les ministres, qu’ils soient socialistes ou communistes, se comportent, à l’image du Président de la République lui-même, en fonction des prérogatives qui leur sont conférées par un État tout puissant doté d’un régime semi-présidentiel ; les membres des cabinets ministériels les plus engagés politiquement paraissent eux aussi se conformer au service public et préférer recourir à des arguments techniques plutôt qu’à des considérations strictement politiques […] n’est-ce pas en définitive souligner la force des institutions ?24 »
Reste à comprendre à quoi tient cette « force des institutions ». Comme on va le voir au travers de l’expérience des premiers gouvernements socialistes, cette force est avant tout le produit d’une socialisation informelle25 qui opère par des interactions plus ou moins insignifiantes dans le quotidien du travail gouvernemental et, comme le dit Pierre Mauroy, « sous la pression du commandement », via certains membres de l’entourage. Cette socialisation n’a rien d’un long fleuve tranquille. Elle est plutôt chaotique et non linéaire car l’apprentissage de l’ordre gouvernemental procède par tâtonnements, à coups d’épreuves et de sanctions positives ou négatives26. Elle demeure par ailleurs sous la dépendance de la socialisation primaire de chaque Premier ministre et varie selon leur contexte d’action. Elle n’empêche pas, enfin, les socialistes de marquer durablement l’ordre gouvernemental.
Pierre Mauroy et « la pression du commandement »
Étudier le cas du gouvernement Mauroy c’est porter l’éclairage sur ce que signifie très concrètement apprendre « sur le tas » l’exercice du pouvoir exécutif. Bien sûr, Mauroy n’est pas un « bleu » en politique. Il est loin d’être dépourvu de capitaux. Cet allié de poids du Président, qui a soutenu la motion Rocard contre celle de Mitterrand au congrès de Metz en 1979, dirige l’une des fédérations les plus puissantes du Parti socialiste (la fédération du Nord) et anime son propre courant. Cependant, à l’instar de Georges Pompidou, rien dans sa trajectoire ne l’a vraiment préparé à diriger le gouvernement : ni ses origines sociales modestes (son grand-père était bucheron et son père instituteur), ni ses études (le conduisant à intégrer le corps des professeurs de l’enseignement technique du secondaire), ni même sa carrière « d’apparatchik » qui pourtant l’amène à diriger un syndicat enseignant (de 1955 à 1959), puis à devenir secrétaire général adjoint de la SFIO (1966) et secrétaire national à la coordination du Parti socialiste (1971‐1979). Si ces expériences militantes font de lui le « numéro 2 » du PS, elles ne font pas de lui le numéro 1 du gouvernement : d’une part son expérience du pouvoir exécutif est limitée au pouvoir local27, d’autre part l’ethos militant qu’il s’est forgé durant toutes ces années le pousse à avoir un rapport au poste très différent de celui de ses prédécesseurs et en particulier de celui qui l’a conçu et endossé le premier, Michel Debré. Cependant, sa volonté de gouverner autrement se heurte d’emblée à l’ordinaire routinisé du travail gouvernemental. Porter l’éclairage sur ce premier gouvernement socialiste, c’est de fait aussi mettre en lumière l’importance dans les processus d’institutionnalisation de ce que Michel Rocard appelle « la technique d’organisation du système28 » – i.e. les règles procédurales et la temporalité qu’elles imposent aux acteurs. Celles-ci ne pèsent toutefois qu’au travers des rappels à l’ordre incessants de certains collaborateurs du Premier ministre qui, avec l’aide des élections intermédiaires, vécues comme des sanctions, jouent un rôle majeur dans la socialisation de Pierre Mauroy à l’ordre gouvernemental.
Sources
- Maurice Duverger, « Monsieur Debré existe-t-il ? », La NEF, juillet-août 1959.
- Raymond Barre, dans Raphaëlle Bacqué, L’Enfer de Matignon, Paris, Albin Michel, 2008, p. 195.
- Sur la notion de rôle en science politique, voir Jacques Lagroye, « On ne subit pas son rôle », Politix, no 38, 1997, p. 7‐17 ; et Christian Le Bart, Les Maires. Sociologie d’un rôle, Lille, Presses Universitaires du Septentrion, 2003. Ce décalage entre la position centrale qu’occupe objectivement le Premier ministre dans le champ du pouvoir et le rôle subordonné qu’il doit performer pour donner à voir la prééminence présidentielle en fait à cet égard une étude de cas très pertinente pour éclairer la notion de rôle telle qu’elle a été retravaillée par Jacques Lagroye, l’un des fondateurs de la sociologie des institutions en France.
- Sur cette approche, voir : Jacques Lagroye, Michel Offerlé (dir.), Sociologie de l’institution, Paris, Belin, 2011 ; et Delphine Dulong, Sociologie des institutions politiques, Paris, La Découverte, 2012
- Maurice Duverger, « Monsieur Debré existe-t-il ? », art. cité.
- « À Matignon on peint impressionniste, à l’Élysée, on a besoin de ligne claire » (Édouard Philippe, Gilles Boyer, Impression et lignes claires, Paris, JC Lattès, 2021, p. 363).
- Celui-ci supplée en tout cas à la doctrine juridique. Ainsi, à défaut de règlement intérieur, le Secrétariat général du gouvernement a élaboré en 1985 un « dossier du travail du gouvernement » qui comporte une série de fiches sur son fonctionnement concret. Mais ce document, qui n’a jamais été validé en Conseil des ministres, n’est pas régulièrement mis à jour. Sur cette institution, voir : Jean-Michel Eymeri-Douzans, Michel Mangenot, « Rouage ou centre de l’État ? Genèse et institutionnalisation du SGG », Revue française d’administration publique, no 171, 2019, p. 603‐627
- Par exemple, entre 1961 et 1986, le nombre de comités interministériels permanents n’a pas cessé de changer d’une année sur l’autre à quatre exceptions près. Sur cette faible routinisation du travail gouvernemental, voir Jacques Fournier, Le Travail gouvernemental, Paris, Presses de la FNSP, 1987.
- Marc-Antoine Granger, « Les décrets portant attributions des membres du Gouvernement », Revue française de droit constitutionnel, no 94, 2013, p. 335‐355.
- Dans son rapport de 1985 « Structures gouvernementales et organisation administrative », le Conseil d’État critique en effet le flou et l’imprécision des formules souvent utilisées dans les décrets d’attribution et de délégation des ministères, ainsi que la pratique courante du renvoi à des textes antérieurs qui oblige à remonter parfois fort loin dans la chaîne des décrets pour trouver celui qui définit concrètement les compétences du ministre.
- Frédéric Edel, « Les réformes de l’encadrement juridique des cabinets ministériels en France : quelle amélioration de la transparence et de la probité ? », Éthique publique, vol. 20, no 1, 2018.
- Jacques Fournier, Le Travail gouvernemental, op. cit., p. 13.
- Sauf exception (voir Alain Claisse, Le Premier ministre de la Ve République, Paris, LGDJ, 1972), les travaux juridiques existants décrivent de manière formelle les services, procédures et outils de l’action gouvernementale ; ils n’éclairent pas le rôle politique du Premier ministre.
- Il faut mettre à part les historiens qui ont largement alimenté la connaissance sur le sujet – et la mienne en particulier – mais sous la forme de monographies qui, si elles sont passionnantes, ne cherchent pas à comprendre comment s’est construit le rôle. Voir la bibliographie en fin d’ouvrage.
- Julien Fretel, Militants catholiques en politique. La nouvelle UDF, thèse de doctorat, Université Paris 1, 2004.
- Didier Demazière, Patrick Le Lidec, « Analyser le travail politique », introduction à Les Mondes du travail politique. Les élus et leurs entourages, Rennes, PUR, 2014, p. 11‐34.
- Cf. Peter Berger, Thomas Luckmann, La Construction sociale de la réalité, Paris, Méridiens Klincksieck, 1986 ; Jacques Lagroye, Michel Offerlé (dir.), Sociologie de l’institution, op. cit. ; Delphine Dulong, Sociologie des institutions politiques, op. cit.
- Voir la note méthodologique en fin d’ouvrage.
- Par exemple, pour permettre au lecteur de découvrir les biographies de tous les Premiers ministres sans que cela ne soit trop fastidieux, celles-ci sont exposées de manière séparée, lorsque cela servait le mieux l’analyse.
- Cet exposé casuistique reflète à cet égard le rapport singulier que les sciences sociales entretiennent avec l’histoire. Pour celles-ci, l’histoire n’est pas une fin en soi mais un outil au service d’une problématique particulière. Sur ce point, voir : Pierre Bourdieu, « Esprit d’État. Genèse et structure du champ bureaucratique », Actes de la recherche en sciences sociales, no 96‐97, 1993, p. 49‐62 ; et Delphine Dulong, « Le Premier ministre en actes et en coulisses. L’histoire comme outil et objet d’analyse sociologique des institutions politiques », dans Michel Offerlé, Henry Rousso (dir.), La Fabrique interdisciplinaire. Histoire et science politique, Rennes, PUR, 2008, p. 47‐58.
- Certains documents sur lesquels s’appuie l’analyse ne sont pas reproduits dans le texte faute de place. On pourra cependant les trouver sur le site du CESSP.
- Pour plus de détails sur les propriétés sociales des ministres socialistes entre 1981 et 1985, voir : Brigitte Gaïti, « “Politique d’abord” : le chemin de la réussite ministérielle dans la France contemporaine », dans Pierre Birnbaum (dir.), Les Élites socialistes au pouvoir (1981‐1985), Paris, PUF, 1985, p. 53‐86.
- Françoise Dreyfus, « Les cabinets ministériels : du politique à la gestion administrative », dans Pierre Birnbaum (dir.), Les Élites socialistes au pouvoir, op. cit, p. 87‐104. Sur le personnel des cabinets socialistes, voir : Pierre Mathiot, Frédéric Sawicki, « Les membres des cabinets ministériels socialistes en France (1981‐1993) : recrutement et reconversion. 1) Caractéristiques sociales et filières de recrutement », Revue française de science politique, vol. 49, no 1, p. 3‐30.
- Voir : Pierre Birnbaum (dir.), Les Élites socialistes au pouvoir, op. cit., p. 309.
- Sur ce type de socialisation propre aux activités politiques, voir : Lucie Bargel, Jeunes socialistes et jeunes UMP. Lieux et processus de socialisation politique, Paris, Dalloz, 2009.
- Cela n’est toutefois pas propre à l’ordre gouvernemental. Voir : Martin Baloge, « Le député débutant. Apprentissage et assimilation de l’ethos parlementaire au Bundestag », Politix, no 113, 2016, p. 201‐222.
- En tant que maire de Lille (depuis 1973) et Président du conseil régional du Nord-Pas-de-Calais (depuis 1974). Mauroy souligne lui-même cette « impréparation » dans ses mémoires : « Ma mairie de Lille m’avait beaucoup appris, rien de comparable cependant à cette agression permanente, cette précipitation et les nombreuses décisions à prendre. Pas davantage la direction du Parti socialiste avec François Mitterrand ! À Matignon on ressent rapidement la chape des contraintes et des pres‐ sions » (P. Mauroy, Vous mettrez du bleu au ciel, op. cit, p. 179).
- Michel Rocard, Si la gauche savait, op. cit., p. 277.