La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre
Une leçon d’épistémologie géographique militante
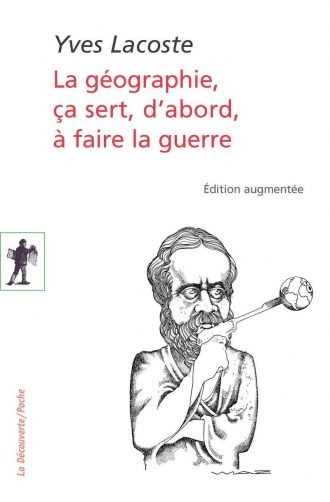
Réédité en 2012 par La Découverte, dans une édition portant une longue introduction (« Trente-six ans après », pp. 5–52) et des ajouts nombreux à la fin de presque chaque chapitre, le livre d’Yves Lacoste, La géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre (1976), ne cesse de proposer une leçon d’épistémologie géographique militante.
La première version, reproduite telle quelle, fait toujours état d’un moment fondamental dans le développement de la géopolitique. Elle montre l’offensive lacostienne, dans ses multiples visées théoriques : conduire la réflexion géographique au dépassement des impasses de l’idéologie de la « géographie des professeurs », du « concept-obstacle » vidalien : « la région » (pp. 95–148) ; permettre de lutter contre l’aliénation technicienne de la New Geography où la « prolétarisation » du géographe est l’effet de l’absence de « communisme scientifique » (R. K. Merton), du manque de partage de données, de propriété intellectuelle et de recul épistémologique (pp. 163–194). Cette visée théorique se nourrit de la tentative militante et pratique de libérer les citoyens d’une « myopie et somnambulisme » (pp. 85–94) résultat d’un d’analphabétisme géographique dangereux pour des groupes évoluant toujours plus à l’intérieur d’un espace différentiel, demandant la capacité, géopolitique, de penser selon des échelles différentes (pp. 119–130) ; de rompre les illusions de « la géographie-spectacle”, du « beau paysage », du « tourisme géographique » (pp. 69–78) ; de démocratiser, enfin, en restituant à la communauté, la propriété sur les moyens de domination du savoir stratégique jusque là « laissés aux mains de quelques uns » (pp. 79–84 ; 195–234).
Lacoste ne cache pas son ascendant althusserien (p. 125). La théorie de Louis Althusser de l’engagement entendu comme « lutte de classe dans la pensée » et « lutte pour la domination théorique » est puissamment revendiquée. Il s’agit, en somme, pour Lacoste, de démontrer que la géographie sert, avant tout, à faire la guerre afin de pouvoir, par la suite, décider, en conscience pour le scientifique, démocratiquement pour les citoyens, à qui confier et comment gérer ce savoir hautement stratégique, éminemment dominant, si « dangereux » (p. 196). Le chapitre « Ces hommes et ces femmes qui sont ‘objet’ d’étude » (pp. 195–206) représente en ce sens l’apogée de la réflexion sur la démocratisation de la méthode géographique. Il s’agit, en effet, de penser la recherche sur le terrain en des termes tout autres : essayant de rendre actifs les groupes rendus par une géographie pieusement convaincue de son objectivité scientifique et de sa neutralité fondamentale des « [simples] objets soumis à l’enquête, observés, sondés, questionnés en fonction d’une problématique qu’ils ignorent. (…) De ce fait exposés aux agissements de forces économiques et politiques puissamment organisées. » (p. 198)
Mais qu’est-ce que, alors, « faire la guerre » ? Il est regrettable que, en raison sans doute de l’économie encore pamphlétaire du livre, on ne possède pas une formalisation explicite de ce syntagme (même si quelques explications d’allure trop anecdotiques sont fournies dans la nouvelle introduction pp 9–10). Le traitement constant d’exemples et de cas pratiques, pourrait pourtant conduire un lecteur attentif au dégagement d’une dynamique. Il ne fait pas de doute que guerre est ici à entendre dans le sens de lutte pour le pouvoir et la maîtrise. La distinction weberienne entre violence (lutte explicite pour la maîtrise) et domination (lutte implicite conduite selon les formes de l’autorité) pourrait fournir le critère pour l’explicitation du problème.
Nous aurions ainsi d’un côté une géographie de la violence : « géographie des états-majors » (69 sqq.) du conflit explicite et évident, des armées régulières ou des groupes armés terroristes (voir la belle analyse de Fidel Castro évoluant sur la Sierra Maestra, ou de Guevara échouant dans sa dernière mission par manque de réflexion géopolitique, pp. 223–232). La géographie est ici la connaissance capable de fournir les moyens pour se mouvoir efficacement dans un espace pour y combattre afin d’obtenir le pouvoir, d’où l’importance des services de renseignements américains et la censure cartographique dans les pays soviétiques.
La géographie est ici la connaissance capable de fournir les moyens pour se mouvoir efficacement dans un espace pour y combattre afin d’obtenir le pouvoir
Lacoste constate que cette forme violente de la géographie se trouve dans une forclusion du discours universitaire de la science pour la science.
De l’autre côté, nous trouvons une géographie de la domination refoulée dont les contours violents sont plus flous, moins discernables, parce que caractérisée par une épistémologie absente ou illusoire. Apparaissant dans les termes neutres de « géographie active », sous le traitement technique de la New Geography, ce type de géopolitique est pratiquée par des géographes ne doutant pas de son caractère de domination ; si bien que dans une grande mesure, comme le démontre Lacoste dans le chapitre XIV (p. 187–194), ce sont des marxistes purs et durs ceux qui se placent le plus souvent au service de leur cible prétendue.
De l’autre côté, nous trouvons une géographie de la domination refoulée dont les contours violents sont plus flous, moins discernables, parce que caractérisée par une épistémologie absente ou illusoire
En effet elle ne montre pas son caractère polémique, son essence dominatrice qui conduit à l’exploitation de ce savoir par des groupes d’élites. Elle va de l’aménagement du territoire à la cartographie à grande échelle, des grandes thèses qui fourniront les données permettant de mieux organiser l’appareil d’Etat, aux études de terrain jamais science abstraite, mais toujours sollicitées par des intérêts de pouvoir (cfr. p. 17 où Lacoste raconte s’être vu changer le sujet de thèse « car, sur un massif ancien, il n’y avait aucune chance de trouver du pétrole ») . Elle comporte la maîtrise d’un territoire ou d’un groupe. A l’époque de Lacoste la relation entre la géographie et la domination était caractérisée par le refoulement (cfr. les pages dédiées à retracer l’histoire de ce refoulement, pp. 56–67).
Il faut comprendre cette polarisation entre violence et domination dans une continuité : guerre implique depuis l’intuition de Clausewitz la fusion continuelle de l’agir politique (domination) et de l’agir polémique (violent). Ce sera à partir de ce schéma qui rend raison de ce qu’est « faire la guerre » pour la géographie, que nous allons pouvoir comprendre clairement tout l’intérêt du raisonnement géopolitique esquissé dans le livre.
« L’enquête sur le bombardement du fleuve Rouge » (pp. 38–43 et pp. 62–64) a représenté pour Lacoste l’acte fondateur de l’intérêt institutionnel et social pour le raisonnement géopolitique. Il est à l’origine de la revue qui articulera la pensée géopolitique française, Hérodote, fondé par l’initiative de Maspero, l’éditeur de référence de la pensée de gauche des années ‘70, persuadé par l’enquête vietnamienne de l’efficacité de cette discipline. Essayons de comprendre cette dynamique de l’intérieur. Il ne fait pas de doute que le bombardement par l’aviation américaine de digues dans la visée de produire une inondation destructrice dans la pleine du delta du fleuve Rouge pose un problème d’ordre épistémologique.
Si c’est une démarche géographique qui a permis de démasquer le Pentagone, c’est bien parce que sa stratégie et sa tactique reposaient essentiellement sur une analyse géographique
(p. 62)
Comment qualifier, en effet, à l’intérieur de notre polarisation (violence — domination refoulée), ce bombardement de digues (acte de guerre, participant explicitement de la violence) visant à produire par un raisonnement scientifique (théoriquement mené par des géographes) une catastrophe naturelle lors de la prochaine crue ? C’est que, la géographie, la géographie prétendument neutre, dont on a refoulé tout caractère dominateur, est, d’abord, un outil de pouvoir, au service de la violence ou de la domination ; ça sert, admirablement bien, à faire la guerre. En effet : « Si c’est une démarche géographique qui a permis de démasquer le Pentagone, c’est bien parce que sa stratégie et sa tactique reposaient essentiellement sur une analyse géographique. » (p. 62).
Telle est la visée épistémologique de Lacoste : faire sortir la géographie de l’illusion de la neutralité de la scientificité universitaire (de la science pour la science), de l’idéologie pieuse de la « géographie des professeurs » (p. 73), pour rendre les géographes conscients des effets de leurs raisonnements. En ce sens, parmi les nombreuses polémiques épistémologiques conduite par Lacoste, particulièrement importante est celle menée contre la région vidalienne, concept-obstacle car elle conduit à accepter comme un fait naturalisé un fait provoqué par des logiques de pouvoir (la limitation de frontières internes), produisant même une légitimation idéologique dans la recherche de l’individualisation et de la caractérisation régionale. Pour s’extraire de cette conception de l’espace cloisonné, « un peu comme une série de boîtes, formées de régions placées sur un même plan les unes à côté des autres » (p. 220), le raisonnement géographique doit se fonder sur « le choix entre plusieurs niveaux d’analyse spatiale » (p. 62).
Telle est l’ampleur de la révolution lacostienne : il s’agit de considérer l’espace toujours comme un corrélat d’un choix. En cela que tout choix engage une volonté, un pouvoir, une intention et toute prétention à la naturalité et à la neutralité sera donc comprise en tant que duperie, illusion ou mauvaise foi. Mais si l’espace est le produit d’une série de choix, alors il ne saurait y avoir d’espace homogène.
Le diatope constitue la véritable clef méthodologique de la pensée géopolitique française
Dès lors il s’agira de fonder le raisonnement géographique sur plusieurs niveaux d’analyse, rendant compte chacun de plusieurs dynamiques se développant sur plusieurs niveaux d’échelle. On comprend donc la centralité de la théorie du diatope (dia, à travers — topos, lieu) placée ici dans les Annexe. Elle constitue la véritable clef méthodologique de la pensée géopolitique française. On comprend aussi l’articulation entre géographie, (« raisonnement qui sert à penser les complexités de l’espace terrestre à différents niveaux d’analyse »), et géopolitique (« rivalité de pouvoir sur un territoire ») : une compréhension réfléchie, donc objectivante, du raisonnement géographique (plusieurs échelles constituant un territoire) comme expression d’une volonté de domination (rivalité).
Sur la nouvelle édition du livre
La partie écrite en 2012 est inévitablement réduite au bilan historique. Cependant elle ne manque pas de poser plusieurs problèmes de type épistémologique : d’abord, elle se présente sous une forme résolument autobiographique. Le problème de la mémoire et de l’histoire se pose donc ici : le récit risquant parfois de raturer l’objectivité qui serait requise pour tenir un discours d’épistémologie historique, paraissant se charger bien plus de régler des comptes avec les adversaires, plutôt que de faire un bilan serein de l’état de l’épistémologie géographique. Il serait néanmoins gauche de ne pas apprécier la richesse des quelques passages théoriques importants (voir, entre tous, la définition de la géographie et de la géopolitique p. 231) ou de ne pas savourer les nombreuses anecdotes concernant la formation aventureuse de Lacoste.
Certes, dans ces trente-six ans le monde a changé radicalement et l’on peut suivre avec étonnement la transformation d’une théorie géopolitique extrêmement fructueuse, prise quelque part dans un autre concept-obstacle, la nation. Le changement est net dans les outils techniques, d’abord : pensons aux révolutions naturalisée de Googlemaps (tout homme ayant une connexion internet dispose aujourd’hui du plan à grande échelle de Pyongyang) ou du TomTom (contribuant encore plus à l’insomnie différentielle, à l’aliénation de l’homme géographique ?) et à au bouleversement de la configuration politique du monde : l’éclatement du monde socialiste avec le repositionnement du marxisme de science cybernétique à courant parfois nostalgique. Force est de constater que, face à ces changements dont d’autres sciences humaines peinent à prendre la mesure, la proposition théorique de Lacoste demeure essentielle.
A l’époque du drone, nul ne saurait en douter, la géographie, ça sert, d’abord, à faire la guerre

